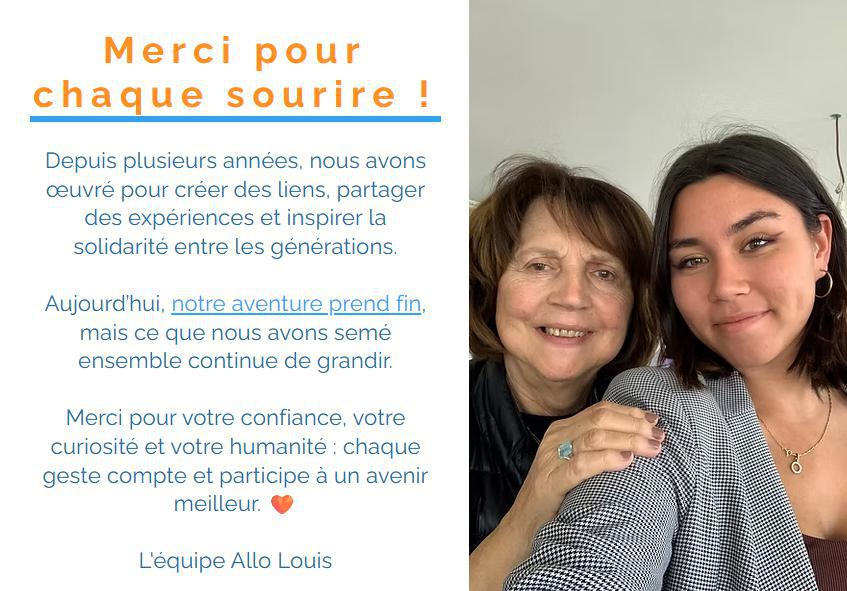Début août 2024, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), en partenariat avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), a lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour sélectionner les conseils départementaux qui expérimenteront de nouvelles modalités de financement du volet aide des Services Autonomie à Domicile (SAD). L’objectif est de remplacer tout ou partie du financement horaire par un financement global ou forfaitaire, pouvant intégrer des éléments populationnels. Cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre de l’article 21 de la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Publié le 26 août 2024 17:13 © Canva
© CanvaActualités du secteur
Réforme du financement de l'aide à domicile : les départements au cœur de l'expérimentation
Mis à jour le 28 août 2025 14:51
Ce que dit la législation
Pris en application de l’article 21 de la loi du 8 avril 2024, c’est un décret du 7 juillet 2024, publié au Journal Officiel du juillet 2024, qui définit les modalités d’organisation, de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation concernant les modalités de financement des services autonomie à domicile (SAD) au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement. Le décret prévoit que l’expérimentation sera menée par 10 départements au plus, à compter du 1er janvier 2025, et prendra fin, au plus tard, le 31 décembre 2026. Les départements seront sélectionnés, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) organisé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), par un comité de sélection composé du Directeur Général de la Cohésion Sociale (DGCS), du Directeur de la Sécurité Sociale (DSS) et du directeur de la CNSA. Les conseils départementaux intéressés doivent transmettre leur candidature avant le 4 novembre 2024.
Dans l'appel à manifestation d’intérêt, la CNSA indique que l'appel en question permet d’organiser l’expérimentation de nouvelles modalités de financement du volet aide des services autonomie à domicile sur des territoires diversifiés et d’expérimenter plusieurs modèles de financement à l’échelle nationale. Chaque conseil départemental devra proposer un modèle de financement à tester pendant toute la période de l'expérimentation et avoir identifié des services volontaires pour expérimenter ce modèle. Pour faciliter la phase de conception d’un modèle à tester, l’AMI comprend en annexe une boîte à outils discutée avec les conseils départementaux et les fédérations entre mai et juillet 2024. Elle fournit quelques pistes d’inspiration pour un nouveau modèle de financement tout en soulignant le cadre dans lequel devra s’inscrire le modèle proposé.
En offrant la possibilité aux départements de tester et d'ajuster de nouvelles approches, l'AMI ouvre la voie à une meilleure prise en charge des personnes en perte d'autonomie, avec des services plus personnalisés et mieux adaptés aux réalités locales. Si les résultats sont concluants, ils pourraient conduire à une refonte du système de financement des SAD, avec des impacts positifs pour les bénéficiaires, les professionnels du secteur, et les collectivités locales. Les usagers pourraient ainsi bénéficier d'une aide plus réactive, mieux ciblée, et plus en phase avec leurs besoins réels, tout en renforçant leur capacité à vivre de manière autonome à domicile.
Dans l'appel à manifestation d’intérêt, la CNSA indique que l'appel en question permet d’organiser l’expérimentation de nouvelles modalités de financement du volet aide des services autonomie à domicile sur des territoires diversifiés et d’expérimenter plusieurs modèles de financement à l’échelle nationale. Chaque conseil départemental devra proposer un modèle de financement à tester pendant toute la période de l'expérimentation et avoir identifié des services volontaires pour expérimenter ce modèle. Pour faciliter la phase de conception d’un modèle à tester, l’AMI comprend en annexe une boîte à outils discutée avec les conseils départementaux et les fédérations entre mai et juillet 2024. Elle fournit quelques pistes d’inspiration pour un nouveau modèle de financement tout en soulignant le cadre dans lequel devra s’inscrire le modèle proposé.
En offrant la possibilité aux départements de tester et d'ajuster de nouvelles approches, l'AMI ouvre la voie à une meilleure prise en charge des personnes en perte d'autonomie, avec des services plus personnalisés et mieux adaptés aux réalités locales. Si les résultats sont concluants, ils pourraient conduire à une refonte du système de financement des SAD, avec des impacts positifs pour les bénéficiaires, les professionnels du secteur, et les collectivités locales. Les usagers pourraient ainsi bénéficier d'une aide plus réactive, mieux ciblée, et plus en phase avec leurs besoins réels, tout en renforçant leur capacité à vivre de manière autonome à domicile.
Le contexte et les enjeux de l’appel à manifestation d'intérêt (AMI)
L'accompagnement des personnes en situation de dépendance, qu'il s'agisse de personnes âgées ou en situation de handicap, est un enjeu majeur pour les politiques publiques en France. Le vieillissement de la population et la volonté croissante de vieillir à domicile exigent une adaptation des services d'aide et de soins à domicile (SAD) pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires.
Le financement de ces services constitue un point clé pour garantir leur efficacité et leur accessibilité. Actuellement, les modalités de financement des SAD sont parfois jugées rigides et peu adaptées aux spécificités des différents territoires ou aux besoins diversifiés des usagers. C'est dans ce contexte que la CNSA et la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) ont décidé d'expérimenter de nouvelles approches, avec pour objectif de mieux cibler les besoins et d'optimiser les ressources allouées.
En effet, dans l’appel à manifestation d'intérêt, la CNSA explique qu’aujourd’hui, les prestations d’aide et d’accompagnement des services autonomie à domicile sont majoritairement financées sur la base des heures d’interventions réalisées auprès des usagers. Dans la majorité des cas, le Conseil départemental définit un tarif par service tarifé et un tarif pour les services non habilités à l’aide sociale, sur la base duquel un financement est versé au service pour chaque heure d’intervention réalisée auprès de bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). Le financement à l’heure présente l’intérêt de la simplicité, tant pour le service à domicile que pour l’usager, dans la mesure où il épouse strictement la forme du contrat conclu pour la prestation de service en application d’un plan d’aide APA ou PCH. Il crée en outre une claire incitation à accroître le volume d’activité.
Cependant, le modèle de financement horaire, spécialement quand il est exclusif d’autres formes de financements, présente deux fragilités. Premièrement, il implique que la recette horaire perçue par le service pour chaque heure d’intervention couvre bien son coût de revient moyen. Autrement dit, elle doit être calculée en intégrant correctement les coûts d’environnement (structure, encadrement, formation, transport…). Si cela ne pose pas de problème en principe, il rend en pratique l’équilibre économique des opérateurs particulièrement sensible à l’écart entre les heures rémunérées au personnel et les heures facturées, alors même que les temps de formation, de supervision et de coordination sont essentiels à la qualité du service rendu, et que la problématique des coûts de transport et de la rémunération des personnels pendant les temps d’inter-vacation est tout particulièrement prégnante dans le secteur. Pour s’assurer que son coût de revient est couvert par les recettes qu’il reçoit, le service peut être incité à augmenter le volume des heures facturées au détriment d’autres dimensions plus qualitatives de l’activité (formation, encadrement) ou de l’organisation du travail (qualité de vie au travail pour les salariées). Deuxièmement, la recette horaire est la même quelles que soient les caractéristiques de l’intervention. Autrement dit, dès lors que certains accompagnements sont relativement plus coûteux que d’autres (personnel plus qualifié, intervention à deux, éloignement géographique de l’usager, fractionnement des interventions, etc.), la recette horaire correspond à un coût moyen, qui conduit le service à servir à perte certains usagers, et à compenser ces pertes en réalisant par ailleurs des interventions relativement moins coûteuses.
De manière générale, le financement sur base horaire est difficile à articuler avec des coûts décorrélés des volumes d’interventions réalisés. L’instauration de la dotation complémentaire permet en théorie de pallier cette difficulté, puisqu’elle permet aux départements de verser aux services un financement forfaitaire, en fonction d’engagements de qualité du service rendu.
Le financement de ces services constitue un point clé pour garantir leur efficacité et leur accessibilité. Actuellement, les modalités de financement des SAD sont parfois jugées rigides et peu adaptées aux spécificités des différents territoires ou aux besoins diversifiés des usagers. C'est dans ce contexte que la CNSA et la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) ont décidé d'expérimenter de nouvelles approches, avec pour objectif de mieux cibler les besoins et d'optimiser les ressources allouées.
En effet, dans l’appel à manifestation d'intérêt, la CNSA explique qu’aujourd’hui, les prestations d’aide et d’accompagnement des services autonomie à domicile sont majoritairement financées sur la base des heures d’interventions réalisées auprès des usagers. Dans la majorité des cas, le Conseil départemental définit un tarif par service tarifé et un tarif pour les services non habilités à l’aide sociale, sur la base duquel un financement est versé au service pour chaque heure d’intervention réalisée auprès de bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). Le financement à l’heure présente l’intérêt de la simplicité, tant pour le service à domicile que pour l’usager, dans la mesure où il épouse strictement la forme du contrat conclu pour la prestation de service en application d’un plan d’aide APA ou PCH. Il crée en outre une claire incitation à accroître le volume d’activité.
Cependant, le modèle de financement horaire, spécialement quand il est exclusif d’autres formes de financements, présente deux fragilités. Premièrement, il implique que la recette horaire perçue par le service pour chaque heure d’intervention couvre bien son coût de revient moyen. Autrement dit, elle doit être calculée en intégrant correctement les coûts d’environnement (structure, encadrement, formation, transport…). Si cela ne pose pas de problème en principe, il rend en pratique l’équilibre économique des opérateurs particulièrement sensible à l’écart entre les heures rémunérées au personnel et les heures facturées, alors même que les temps de formation, de supervision et de coordination sont essentiels à la qualité du service rendu, et que la problématique des coûts de transport et de la rémunération des personnels pendant les temps d’inter-vacation est tout particulièrement prégnante dans le secteur. Pour s’assurer que son coût de revient est couvert par les recettes qu’il reçoit, le service peut être incité à augmenter le volume des heures facturées au détriment d’autres dimensions plus qualitatives de l’activité (formation, encadrement) ou de l’organisation du travail (qualité de vie au travail pour les salariées). Deuxièmement, la recette horaire est la même quelles que soient les caractéristiques de l’intervention. Autrement dit, dès lors que certains accompagnements sont relativement plus coûteux que d’autres (personnel plus qualifié, intervention à deux, éloignement géographique de l’usager, fractionnement des interventions, etc.), la recette horaire correspond à un coût moyen, qui conduit le service à servir à perte certains usagers, et à compenser ces pertes en réalisant par ailleurs des interventions relativement moins coûteuses.
De manière générale, le financement sur base horaire est difficile à articuler avec des coûts décorrélés des volumes d’interventions réalisés. L’instauration de la dotation complémentaire permet en théorie de pallier cette difficulté, puisqu’elle permet aux départements de verser aux services un financement forfaitaire, en fonction d’engagements de qualité du service rendu.
Les nouvelles modalités de financement
L’AMI donne plus de liberté aux départements dans la gestion des financements. Ainsi, la CNSA précise que l’article 21 de la loi dite Bien Vieillir vise à expérimenter des modèles de financement susceptibles de pallier certaines limites du modèle de financement actuel, en permettant aux départements de mettre en place des financements par dotation globale ou forfaitaire, en remplacement partiel ou total du financement horaire.
Il est également prévu que les départements puissent expérimenter une dotation populationnelle de manière complémentaire à d’autres modalités de financement. Autrement dit, il s’agit, pour la partie “accompagnement” de l’activité des SAD, d’identifier des unités de mesure alternatives au volume horaire réel facturé, afin d’asseoir des financements se substituant entièrement, ou partiellement, au financement horaire.
L’article 21 prévoit que les modèles de financement expérimentés doivent améliorer la qualité de prise en charge, l’équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels. Il est également prévu dans le décret d’application que les modèles expérimentés ne doivent pas aboutir à une augmentation du reste-à-charge des usagers, à volume d’heures prestées donné.
Par conséquent, l’évaluation des modèles expérimentés portera également sur l’impact de ces derniers sur la participation financière et le reste-à-charge extra-légal supportés par les usagers. La performance d’un modèle de financement sera également appréciée au regard des possibilités qu’il confère en termes de pilotage des dépenses publiques et du secteur de l’aide à l’autonomie, d’incitation à la rationalisation des coûts et d’articulation entre les prestations d’aide et de soins au sein des services mixtes d’autonomie à domicile.
Il est également prévu que les départements puissent expérimenter une dotation populationnelle de manière complémentaire à d’autres modalités de financement. Autrement dit, il s’agit, pour la partie “accompagnement” de l’activité des SAD, d’identifier des unités de mesure alternatives au volume horaire réel facturé, afin d’asseoir des financements se substituant entièrement, ou partiellement, au financement horaire.
L’article 21 prévoit que les modèles de financement expérimentés doivent améliorer la qualité de prise en charge, l’équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels. Il est également prévu dans le décret d’application que les modèles expérimentés ne doivent pas aboutir à une augmentation du reste-à-charge des usagers, à volume d’heures prestées donné.
Par conséquent, l’évaluation des modèles expérimentés portera également sur l’impact de ces derniers sur la participation financière et le reste-à-charge extra-légal supportés par les usagers. La performance d’un modèle de financement sera également appréciée au regard des possibilités qu’il confère en termes de pilotage des dépenses publiques et du secteur de l’aide à l’autonomie, d’incitation à la rationalisation des coûts et d’articulation entre les prestations d’aide et de soins au sein des services mixtes d’autonomie à domicile.
Une expérimentation suivie d’une enquête
L’expérimentation à proprement parler sera couplée à une enquête approfondie de coûts sur le secteur de l’aide à domicile. La CNSA dispose que cette enquête, visant la représentativité à l’échelle nationale, portera sur plusieurs centaines de services. Elle permettra de recueillir des données quantitatives et qualitatives auprès des départements participants, des services concernés, et des bénéficiaires. Elle a vocation à approfondir la connaissance du niveau et de la structure des coûts, ainsi que les caractéristiques des usagers, de la structure ou des accompagnements fournis qui influencent ces coûts. En cela, l’enquête de coûts apportera au secteur et aux décideurs publics les moyens d’objectiver les coûts des opérateurs, et de mieux comprendre leur modèle économique.
L’enquête de coûts sera également utilisée pour modéliser et calibrer les modèles de financement expérimentés à grande échelle. Les modalités de la réalisation de l’enquête de coûts et de recrutement des services participants seront précisées ultérieurement.
Source des données : Appel à manifestation d'intérêt de la CNSA.
L’enquête de coûts sera également utilisée pour modéliser et calibrer les modèles de financement expérimentés à grande échelle. Les modalités de la réalisation de l’enquête de coûts et de recrutement des services participants seront précisées ultérieurement.
Source des données : Appel à manifestation d'intérêt de la CNSA.
Partager cet article :
Commentaires
Il n'y a pas de commentaires pour le moment
Nos ressources pour les professionnels

Comment optimiser un recrutement humain et structuré ?
Témoignage - Agence AXEO Services Vallée de Chevreuse
voir le témoignage
EHPAD : Comment optimiser son processus de recrutement ?
Témoignage - EHPAD Le Clos des Cèdres
voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros