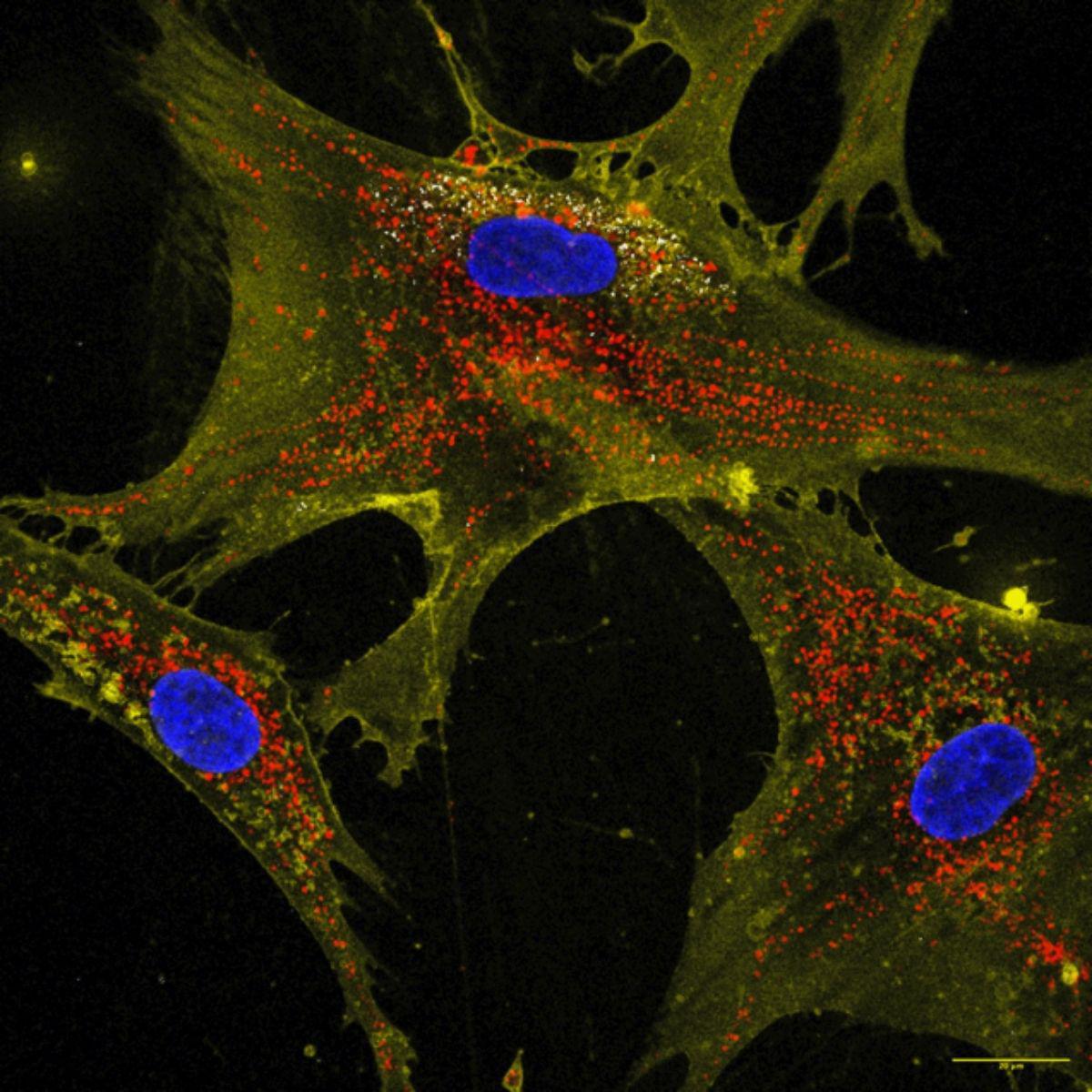La question du grand âge et de la perte d’autonomie est au cœur du débat public depuis plusieurs années. Une nouvelle étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient apporter un éclairage précieux : près de trois quarts des Français déclarent préférer rester chez eux si un jour ils perdaient en autonomie, plutôt que d’intégrer un établissement spécialisé. Derrière cette préférence massive, l’étude révèle aussi des attentes fortes vis-à-vis des services à domicile et un regard parfois inquiet sur les solutions actuelles.
Publié le 22 septembre 2025 08:30
Perte d’autonomie : trois quarts des Français préfèrent rester à domicile
Le domicile, premier choix des Français
Selon l’enquête, 74 % des personnes interrogées choisiraient le maintien à domicile en cas de perte d’autonomie. Seuls 18 % se projettent en établissement, tandis que 8 % n’ont pas exprimé de préférence. Ce résultat confirme une tendance déjà observée dans d’autres travaux : le domicile reste le cadre privilégié, car il incarne la continuité de la vie personnelle et affective.
Ces résultats sont détaillés dans la dernière étude de la DREES, qui analyse en profondeur les préférences des Français face à la perte d’autonomie et les conditions nécessaires pour rendre possible le maintien à domicile.
Comme le souligne la DREES, « la volonté de rester chez soi est partagée par toutes les générations, y compris les plus âgées ». Autrement dit, il ne s’agit pas d’un idéal théorique porté par les plus jeunes, mais bien d’un souhait profond qui traverse l’ensemble de la population.
Pourquoi ce choix du domicile ?
L’attachement au domicile repose sur plusieurs facteurs :
- Le confort et les repères familiers : rester dans son logement, c’est conserver son cadre de vie et ses habitudes.
- La proximité des proches : beaucoup craignent que l’entrée en établissement entraîne un isolement social.
- Le souhait de liberté : rester maître de son quotidien, même en situation de dépendance, reste un objectif majeur.
Un participant interrogé dans le cadre de l’étude confie : « Mon appartement, c’est ma vie. Je préfère qu’on m’aide ici plutôt que de devoir tout quitter pour une chambre impersonnelle. »
Des freins bien identifiés
Si les Français souhaitent rester à domicile, ils sont conscients des difficultés que cela implique. L’étude relève plusieurs freins :
- Le coût des services à domicile, parfois jugé trop élevé.
- Le manque de professionnels disponibles, surtout dans certaines zones rurales.
- Les aménagements nécessaires dans les logements, souvent complexes ou coûteux à mettre en place.
Comme nous l’avions montré dans notre analyse de la démographie des infirmières et aides-soignantes, la pénurie de professionnels constitue déjà un frein majeur au maintien à domicile.
Une femme de 68 ans citée par la DREES témoigne : « Je veux rester chez moi, mais je sais que sans aide régulière et sans travaux d’adaptation, ce sera difficile. »
L’importance des services à domicile
L’étude met en lumière le rôle central des services à la personne. Aide au ménage, préparation des repas, soins infirmiers, téléassistance… autant de dispositifs indispensables pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles.
Cependant, la DREES note que beaucoup de Français doutent de la capacité actuelle du système à répondre à la demande croissante. La pénurie de personnel, déjà ressentie dans les Ehpad, touche aussi le secteur du domicile.
Du côté pratique, des dispositifs comme le CESU facilitent déjà l’accès aux services à domicile, en simplifiant les démarches administratives et financières pour les particuliers.
Et les proches aidants ?
Autre enseignement de l’étude : la place des proches dans le maintien à domicile. Une majorité de Français estime que la famille sera mise à contribution. Or, cette perspective inquiète, car de nombreux aidants se sentent déjà épuisés. L’étude souligne le besoin urgent de mieux reconnaître, soutenir et accompagner les aidants.
Des solutions à inventer
Pour répondre à ce souhait largement partagé de rester à domicile, plusieurs pistes sont évoquées :
- Le développement des services de proximité et la formation de nouveaux professionnels.
- Le soutien financier accru pour les familles, afin de couvrir une partie des frais.
- L’adaptation du logement grâce à des aides à la rénovation.
- L’innovation technologique, avec la domotique et les objets connectés, pour renforcer la sécurité.
Ces leviers pourraient permettre d’offrir une alternative crédible à l’entrée en établissement.
L’innovation ne concerne pas seulement le logement : les véhicules adaptés et aides à la mobilité montrent aussi comment la technologie peut favoriser l’autonomie au quotidien.
Cette réflexion rejoint les travaux que nous avons menés dans notre Livre blanc Ehpad 2030, où nous plaidons pour un modèle de bien-être durable adapté aux besoins des résidents et de leurs familles.
Un enjeu sociétal majeur
Le vieillissement de la population rend ces questions incontournables. En 2050, près d’un tiers des Français aura plus de 60 ans. La demande en solutions de maintien à domicile va mécaniquement exploser. Pour la DREES, il s’agit donc d’anticiper dès maintenant, en adaptant les politiques publiques et en renforçant les dispositifs existants.
La publication de cette étude constitue un signal fort : il ne suffit pas de constater la préférence des Français pour le domicile, il faut rendre cette préférence réaliste et soutenable.
En parallèle, les grands groupes d’Ehpad continuent d’occuper une place importante dans le paysage, mais peinent à convaincre face au souhait massif de rester à domicile.
En conclusion
La nouvelle étude de la DREES rappelle une évidence : le domicile est et restera le lieu de vie privilégié des Français en perte d’autonomie. Mais pour que ce choix ne soit pas une source d’angoisse ou une option réservée aux plus favorisés, il faut repenser l’accompagnement, soutenir les aidants et investir dans les services à la personne. Entre attachement au chez-soi et réalités économiques et sociales, le défi est immense. Il engage l’ensemble de la société : pouvoirs publics, professionnels, familles et associations. Car permettre à chacun de vieillir dignement chez soi, c’est un projet collectif qui nous concerne tous.
Partager cet article :
Nos ressources pour les professionnels

Comment optimiser le recrutement ?
Témoignage - Centre services Bourgoin Jallieu
Voir le témoignage
Optimiser son temps de recrutement
Témoignage - EHPAD Résidence La Méridienne
Voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros