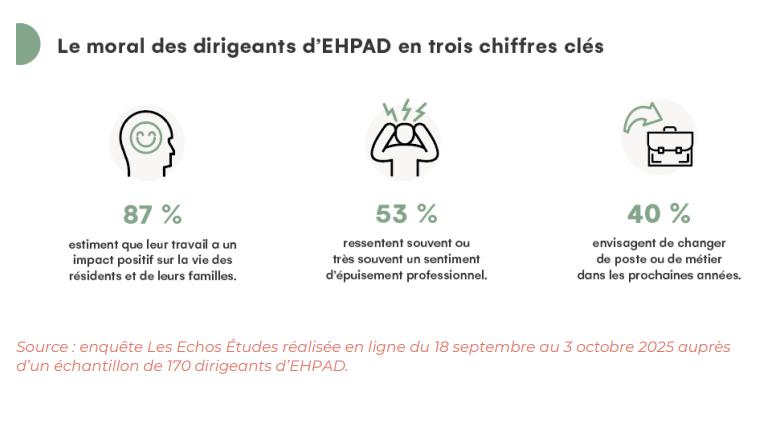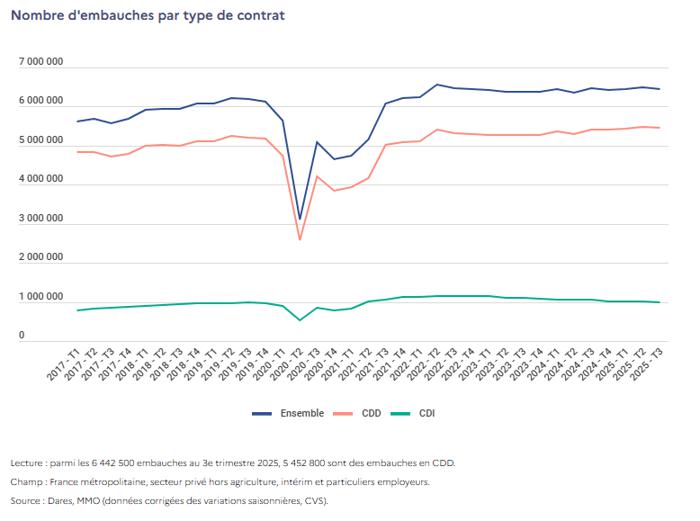A bas les préjugés sur la vieillesse et les seniors
Sans s'en rendre compte, on peut avoir tendance à ne regarder les plus vieux que comme des êtres fragiles plus vraiment à même de s'occuper d'eux. On peut avoir tendance à les infantiliser et à les dévaloriser. Une forme d'âgisme ordinaire qui s'insinue dans nos relations les plus intimes et dont les conséquences sont loin d'être anodines.
Les préjugés ont la vie dure. Ceux sur la vieillesse n’y font pas exception et l’emportent parfois sur d’autres considérations. Il est normal de tenir compte de l’âge des plus âgés dans nos relations avec eux mais attention à ne pas se laisser aveugler par les préjugés sur la vieillesse. Ces attitudes peuvent être lourdes de conséquences tant pour les autres que pour nous-mêmes, souligne Véronique Cayado dans son livre. Elle parle à ce titre de : comportements discriminatoires, d'infantilisation, d’atteinte à l’intégrité psychique, d’altération des capacités, de baisse de l’estime de soi, de biais de perception, de mémorisation de jugement…
L'auteure nous invite à modifier notre façon de penser et de voir le vieillissement. Aux pages 135 à 138, elle écrit : On ne peut changer le regard sur la vieillesse qu’en changeant aussi le regard sur la vulnérabilité, la dépendance et la perte d’autonomie. Ce n’est qu’ainsi qu’on évitera le phénomène de sous-typage, ce n’est qu’ainsi qu’on évitera de construire une vieillesse à deux visages, une face présentable et une autre cachée car portant les stigmates de l’abjecte vérité.
Véronique Cayado avance des pistes concrètes de changement : (...) Nombreux sont les penseurs et les professionnels qui militent pour une autre prise en soin des personnes plus dépendantes afin de maximiser l’autonomie et l’expression de leurs capacités, plutôt que de se centrer sur les limitations. Nombreux aussi sont ceux qui pensent que l’on peut accompagner les aînés en perte d’autonomie sans forcément réduire leur existence à celle d’un malade ou d’un patient : remise en question de la blouse en tant qu’uniforme parce qu’elle n’aurait pas sa place dans un environnement de vie normal, questionnements sur la dialectique "lieu de travail ou lieu de vie", réflexion sur la portée du langage professionnel lorsque, par exemple, on présente une personne âgée en utilisant les termes de "dément déambulateur, fugueur, résistant au soin”.
L’âgisme, qu’est-ce que c’est ?
On appelle “âgisme” tous ces biais liés à nos croyances sur le vieillissement qui affectent, non seulement nos relations quotidiennes avec les plus vieux, mais aussi notre propre vieillissement en santé. Les enjeux ne sont donc pas qu’éthiques, ils sont aussi de santé publique. Chacun est ou sera confronté, familialement ou professionnellement, aux problèmes de l’accompagnement de la vieillesse. Ce manuel anti-préjugés de 160 pages à l’usage de tous permet de comprendre les idées préconçues qui nous conditionnent face au grand âge et de commencer à nous en libérer.
Voici un extrait du livre (pages 48-49) parlant avec le “langage bébé”, un langage souvent adopté par les
aidants professionnels face aux seniors :
Le "langage bébé" est une forme de communication qui a été observée à l’égard des plus vieux. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un langage plutôt simpliste où l’on va utiliser des mots simples, des phrases courtes, en adoptant également une communication non verbale exagérée : la voix est transformée, souvent plus aiguë, on va se mettre à parler plus fort ou plus lentement, on va avoir tendance à se rapprocher de la personne avec des mimiques plus prononcées, etc…
En gros, on exagère pour être sûr de bien se faire comprendre, comme on le ferait avec un bébé ou un jeune enfant qui n’aurait pas encore complètement acquis les compétences langagières. C’est une forme de communication qui a été observée chez les professionnels soignants, généralement dans le but de favoriser la compréhension et le rapprochement avec la personne âgée. L’objectif est donc plutôt sain et bienveillant. Le "langage bébé" part d’un bon sentiment de professionnels inconscients de la charge de préjugés négatifs qu’il véhicule par ailleurs. Leur comportement leur paraît maternant et bien intentionné. Ils ne cherchent pas à nuire, mais à répondre aux besoins plus spécifiques des individus dont ils ont la charge de prendre soin. Voilà toute l’ambivalence et l’ambiguïté de ces comportements. Sans que leurs auteurs en aient pleinement conscience, ces "bonnes intentions" procèdent de considérations d’ordre général sur le vieillissement. C’est parce qu’on sait avant de connaître que l’on peut devancer les besoins d’une vieille personne ; ses caractéristiques individuelles sont comme occultées par son âge avancé. Cela peut être d’autant plus pernicieux que ces comportements sont adoptés à l’égard de personnes présentant effectivement un signe de fragilité ou une pathologie se prêtant aux stéréotypes âgistes.
Le fait qu’une personne présente déjà un stigmate de fragilité ouvre chez son interlocuteur un tiroir mental qui pourrait porter l’étiquette "vieux dépendant". Il se produit alors ce qu’on appelle un "biais d’association" : notre cerveau s’appuie sur un élément tangible observable pour convoquer nombre d’autres informations qui, elles, ne sont pas réelles. Ces informations ne caractérisent pas réellement la personne mais lui sont attribuées par généralisation de toutes les caractéristiques présentes dans ce fameux tiroir mental "vieux dépendant". C’est cela l’âgisme : des erreurs de lecture qui entraînent des comportements déplacés et discriminants.

Qui est Véronique Cayado, quel est son parcours ?
Véronique Cayado est docteure en psychologie et membre de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie. Ingénieure de recherche à l’Institut Oui Care, elle est spécialiste du bien vieillir et publie régulièrement des tribunes dans la presse, des articles sur le site Oui Care et des vidéos sur sa chaîne YouTube qui sensibilisent le grand public à l’âgisme. Véronique Cayado est formée MDH-PPH (Modèle de Développement Humain - Processus de Développement de Handicap) avec le RIPPH (Réseau international sur le processus de production du handicap), certification en cours.

 Véronique Cayado
Véronique Cayado