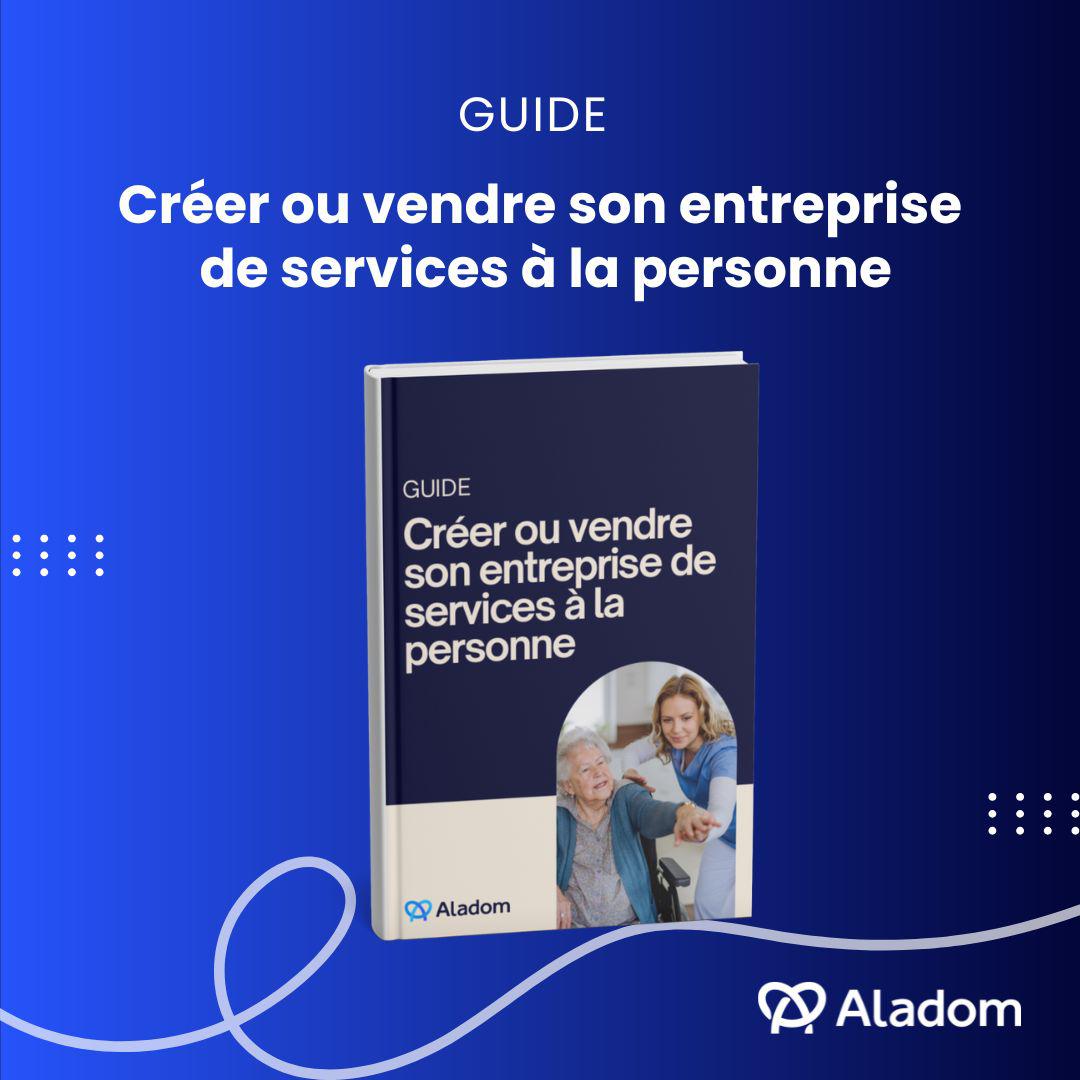Les Français déclarent en grande majorité vouloir vieillir chez eux, et bien souvent, l’admission en l’Ehpad survient en dernier recours, lorsque la personne n’est plus autonome, et que les aides à domicile et les soins à domicile ne suffisent pas.
Un résident en Ehpad a en moyenne 86 ans, et 40 % des résidents sont atteints d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Mais il arrive aussi que les Ehpad accueillent des personnes beaucoup plus jeunes. C’est en grande partie à ces résidents à partir de 60 ans qu’est dédiée cette nouvelle étude de la Drees parue la semaine dernière, intitulée
« Qui vit à domicile, qui vit en établissement parmi les personnes de 60 ans ou plus ? - Une comparaison à partir des enquêtes Care-Ménages et Care-Institutions ».Il apparaît que ces « jeunes » résidents en Ehpad ont, surtout jusqu’à 80 ans, des profils bien spécifiques, et très différents de leurs homologues qui vivent encore chez eux :
ils sont plus isolés (ils ont moins d’enfants que la moyenne), plus pauvres, et avec des limitations motrices et cognitives particulièrement importantes pour leur âge : ils sont moins autonomes, et ils sont plus souvent en situation de handicap de longue date.
Ils ont donc besoin de beaucoup plus d’aide que les seniors de leur âge à domicile (qui ont en moyenne 72 ans).
Les résultats sont issus des enquêtes Capacités, aides et ressources des seniors (Care) menées en 2015 et 2016. Près de 14.000 « observations » ont été menées, auprès de personnes vivant en établissement (un quart des personnes interrogées), et auprès de personnes vivant à domicile (les trois autres quarts).
Résidents les plus jeunes en Ehpad : leurs caractéristiques
Selon la Drees (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), par rapport aux seniors vivant chez eux,
les résidents les plus jeunes vivant en Ehpad (moins de 75-80 ans) : - sont plus souvent sans enfant
Pourcentage des seniors n’ayant aucun enfant en vie :
En établissement :
72 % des 60-64 ans ;
59 % de 65-69 ans ;
38 % des 70-74 ans ;
35 % des 75-79 ans.
A domicile, seuls entre 10 % et 11 % des seniors de ces mêmes tranches d’âge n'ont aucun enfant en vie.
- sont plus souvent célibataires
Plus de la moitié des résidents en Ehpad de moins de 70 ans sont célibataires : 74 % des 60 à 64 ans (à domicile, ils sont près de 10 %) ;
54 % des 65-69 ans (à domicile, ils sont 7 %).
Ensuite, l’écart reste important, mais il diminue cependant.
- sont plus défavorisés économiquement
Le niveau de vie annuel médian jusqu’à 75 ans des résidents en Ehpad est de 13 000 et quelques euros, contre 21 000 et quelques euros pour les personnes qui vivent à domicile.
Les anciens ouvriers sont sur-représentés parmi les hommes de moins de 80 ans résidant en établissement.
- sont plus souvent sous protection juridique :
Plus d’un résident de moins de 75 ans sur deux fait l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle. Cela concerne :
79 % des 60-64 ans ;
72 % des 65-69 ans ;
65 % des 70-74 ans ;
39 % de 75-79 ans.
En revanche, seules 1 % ou 0 % des personnes des mêmes tranches d'âge vivant à domicile sont concernées.
- présentent plus de difficultés pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne
C’est le cas de
45 % des 60-64 ans ;
52 % de 65-69 ans ;
52 % des 70-74 ans ;
53 % des 75-79 ans vivant en établissement.
En revanche, seules 1 % des personnes des mêmes tranches d'âge vivant à domicile déclarent la même chose. Puis, pour ces dernières, cela augmente progressivement, pour atteindre 29 % après 95 ans ou plus.
D'une façon générale, ils présentent des limitations fonctionnelles beaucoup plus importantes.
- présentent une plus forte prévalence des troubles cognitifs et moteurs
Par exemple, 45 % des 60-64 ans vivant en Ehpad ont beaucoup des difficultés ou une impossibilité à marcher sur 500 mètres sur un terrain plat (c'est seulement 4 % des personnes à domicile) ;
Cela concerne 58 % des 65-69 ans (contre 4 % à domicile), et 66 % des 70-74 ans (7 % à domicile).
Après 80 ans, les différences de situation entre les personnes âgées qui vivent en Ehpad et celles qui vivent à domicile sont moins marquées.
À l’heure où le « virage domiciliaire » constitue une orientation majeure des politiques publiques du grand âge, ce dossier de la Drees met en lumière les questions posées par la volonté de « désinstitutionnalisation » des personnes âgées, estiment les rapporteurs.
Si la proportion de personnes résidant en institutions restait inchangée à chaque âge et à chaque degré de perte d'autonomie, il faudrait pouvoir accueillir 108 000 personnes âgées supplémentaires en établissement d'ici à 2030.
Mais comme la politique actuelle s’oriente vers un virage domiciliaire, il est nécessaire d’anticiper « les conditions économiques et sociales de leur maintien à domicile et du soutien à leur autonomie » indique la Drees.
Elle souligne l’importance d’un secteur de l’aide à domicile viable économiquement avec des services tels que l’aide au ménage, au repas et à la toilette, mais aussi une prise en charge médicale et paramédicale à domicile, qui correspondrait aux tâches assurées aujourd’hui par le personnel sanitaire des Ehpad.
Or, pour l'instant, les secteurs de l'aide à la personne sont en crise et manquent de personnel.
Vous cherchez à recruter une auxiliaire de vie, ou vous cherchez un emploi dans les services aux personnes âgées ? Aladom, la plateforme de référence de mise en relation dans les services à la personne, propose des emplois près de chez vous dans toute la France.

Pour aller plus loin :
Voir l'enquête de la Drees : « Qui vit à domicile, qui vit en établissement parmi les personnes de 60 ans ou plus ? »

 La Drees souligne l'importance des services à la personne pour le maintien à domicile des jeunes seniors les plus en difficulté.
La Drees souligne l'importance des services à la personne pour le maintien à domicile des jeunes seniors les plus en difficulté.