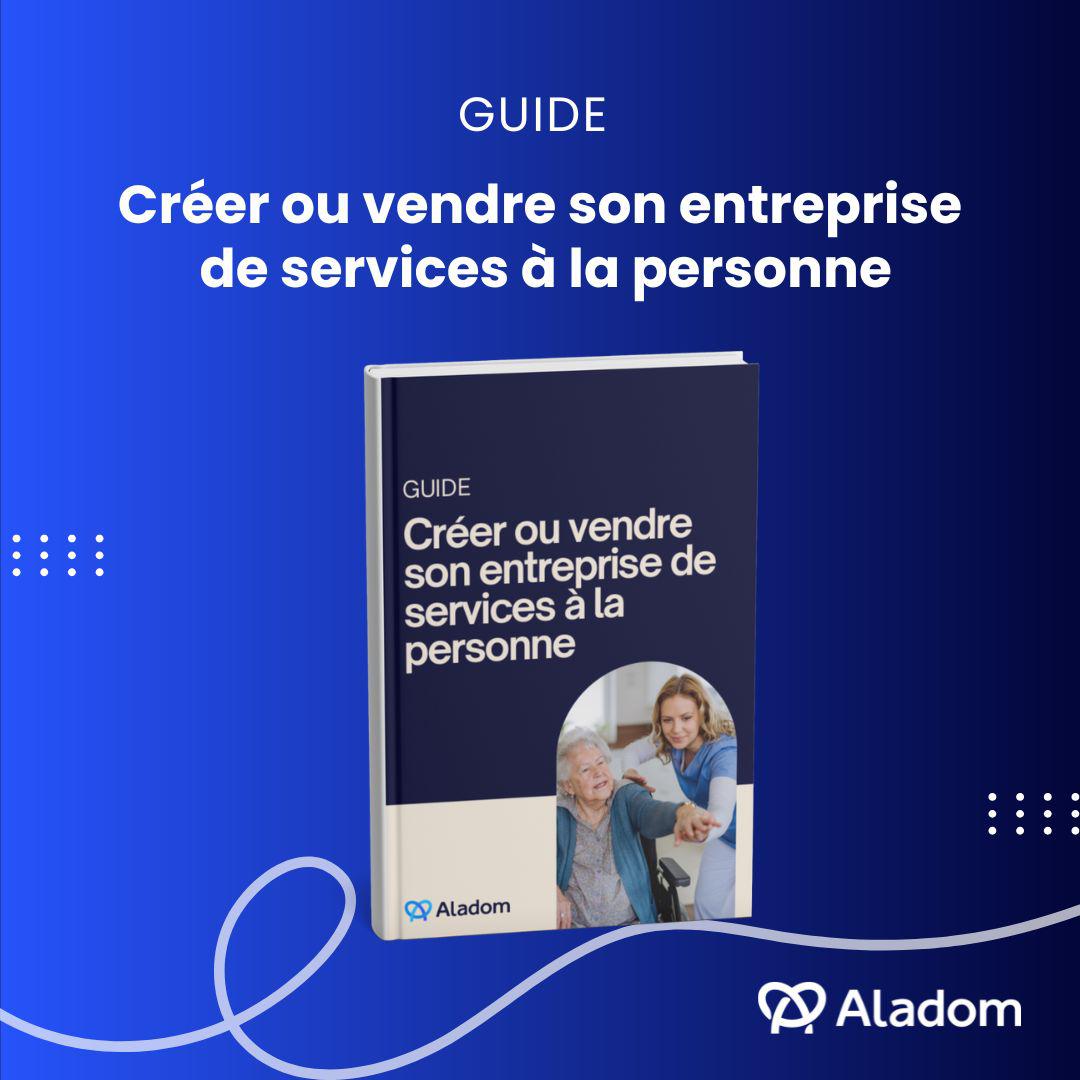L’explosion du nombre de salariées dans les services à la personne, un corollaire à l’augmentation de la discrimination dans cette branche ?
Diligentée par le Défenseur des droits et l’OIT (Organisation Internationale du Travail), l'enquête portant sur le secteur des services à la personne a été réalisée en ligne par l’institut Ipsos au mois de juin 2022. Elle a pour but d’améliorer la connaissance sur les discriminations, souvent peu visibles, vécues par les salariées du secteur de l’aide à la personne et de mettre ce sujet au cœur du débat public, afin que soient proposés des leviers d’action à la hauteur des enjeux soulevés.
Un secteur ségrégé à forte prépondérance féminine
En France, le secteur des services à la personne représente l’un des secteurs d’activité qui a connu la plus forte croissance depuis les années 1990. En 2015, il compte 1,3 million de salariées, soit environ 5,5 % de l’emploi salarié total. Le développement de ce secteur, soutenu par les pouvoirs publics, est la résultante de besoins grandissants liés notamment au vieillissement de la population française. Il contribue quasiment à lui seul à la croissance du salariat non qualifié ces quinze dernières années.
Le secteur des services à la personne se caractérise par une forte ségrégation professionnelle, regroupant principalement des métiers précaires et historiquement à prédominance féminine. En effet, les salariées sont majoritairement des femmes (87,3 % en 2015 selon la DARES - Direction de l’Animation de la Recherche des Études et des Statistiques), peu diplômées (seulement 7,5 % ont un diplôme supérieur au Baccalauréat contre 38,4 % de l’ensemble des actifs occupés) et avec une moyenne d’âge supérieure à celle de la population active (46 ans contre 41 ans).
Avec des revenus faibles et variables, elles sont souvent les seules pourvoyeuses de revenus dans leur ménage, soit parce que leur conjoint est au chômage, soit parce qu’elles sont à la tête d’une famille monoparentale.
On constate également une surreprésentation des salariées nées à l’étranger dans ce secteur (14,5 % en 2015 contre 5,5 % dans la population globale en emploi) et des salariées dont au moins un des parents est né à l’étranger (32,9 % contre 24,7 %). Les salariées du secteur sont enfin plus touchées par des problèmes de santé durables (28,6 % d’entre elles contre 19,9 % pour le reste de la population active) et plus souvent en situation de handicap ou de perte d’autonomie (5,9 % contre 3,6 %).
Les conditions de travail dégradées et le caractère subalterne de ces métiers se manifestent à de nombreux égards : faibles revenus, prédominance du temps partiel, fragmentation du temps de travail, horaires flexibles, multiplicité des employeurs, forte pénibilité physique et émotionnelle, proportion élevée d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous-valorisation symbolique et statutaire (l’activité n’étant pas reconnue comme qualifiée).
Nouvelles figures du salariat non qualifié, les employées des services à la personne se situent au croisement d’inégalités liées au genre, à la classe sociale et à l’origine.
Des salariées victimes de discrimination sur leur lieu de travail
Les discriminations sont largement observées par les salariées du secteur de l’aide à domicile dans le cadre professionnel. Près d’un tiers (30 %) du personnel des services à la personne déclare avoir été, au moins une fois, témoin de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de son emploi.
Les professionnelles des services à la personne observent davantage ces discriminations dans leur travail au quotidien, par comparaison avec la population active globale (61 % de celles ayant été témoins d’une discrimination, contre 53 % pour l’ensemble de la population active).
Les discriminations relatives à l’apparence physique, à l’origine ou la couleur de peau et au fait d’être une femme sont les plus observées par les professionnelles des services à la personne et davantage rapportées que dans la population active globale, reflétant l’importance des normes et pratiques de dévaluation sexiste et raciste dans ce secteur. Parmi les personnes ayant été témoins d’une discrimination dans l’emploi, près d’une sur deux (47 %) la rattache au motif de l’apparence physique (contre 32 % pour l’ensemble de la population active), 36 % à l’origine ou la couleur de peau (contre 33 %) et 31 % au fait d’être une femme (contre 24 %).
Comme l’ont montré les recherches de Christelle Avril, les aides à domicile perçues comme noires ou arabes sont fréquemment concernées par ces différences de traitement, moins visibles, qui les maintiennent de fait dans une position subalterne au sein de la population active du secteur. Par leur répétition, ces traitements différenciés et formes de stigmatisation peuvent être constitutifs en droit d’un harcèlement discriminatoire et conduire la salariée à une forme de démission contrainte.
Dans le secteur des services à la personne, le critère de l’apparence physique semble renvoyer principalement à des comportements sexistes, racistes et/ou grossophobes. Dans cette même perspective, on constate que les critères socioculturels qui peuvent être apparentés à l’origine (nationalité, difficultés à s’exprimer en français, religion) et au sexe (la grossesse ou la maternité, la situation familiale) sont aussi fréquemment cités.
Une proportion importante des salariées des services à la personne rapporte également avoir été témoin de discriminations liées à l’orientation sexuelle (20 % de celles ayant été témoins d’une discrimination) et à l’état de santé (19 %). En effet, l’orientation sexuelle est un facteur fortement associé au risque de déclarer une discrimination dans le secteur des services à la personne : 44 % des salariées lesbiennes, bisexuelles ou d’une autre orientation sexuelle déclarent ainsi avoir vécu une discrimination dans leur emploi, contre 21 % des personnes hétérosexuelles.
Des discriminations massives liées à l’origine et à la nationalité
Des travaux sociologiques sur les salariées des services à la personne (aides à domicile, nourrices) ont permis de documenter la prégnance des préjugés et discriminations raciales dans ce secteur d’activité, notamment au sein des grandes villes. Le profil des travailleuses immigrées ou originaires des outre-mer est différent du reste de la population active du secteur : une partie d’entre elles est plus diplômée et exerçait parfois des emplois qualifiés avant de migrer. Lors de leur recrutement en tant qu’aide à domicile ou une fois dans leur emploi, les candidates subissent souvent des épreuves implicites de sélection auxquelles ne sont pas confrontées les candidates blanches : elles sont moins souvent à temps plein car soumises à une période d’essai implicite, on leur attribue davantage des personnes âgées jugées plus difficiles, elles font l’objet d’une surveillance accrue et sont plus facilement licenciées que les collègues blanches.
La complexité à faire renouveler une carte de séjour favorise également les situations de harcèlement, d’exploitation ou d’esclavage moderne des travailleuses domestiques sans papiers.
Enfin, les salariées du secteur sont souvent confrontées à des propos ou préjugés racistes, que ce soit de la part du personnel de l’organisme qui les emploie ou des bénéficiaires des services. L’observation d’entretiens de recrutement des nourrices reflète le rôle décisif de l’origine et de la couleur de peau dans l’évaluation professionnelle (les Maghrébines perçues comme sévères mais responsables, les Africaines nonchalantes mais maternelles, les Colombiennes dociles mais sournoises etc.).
Ce qu'engendre la discrimination systémique sur le comportement des employeurs
Les discriminations relevées revêtent un caractère multidimensionnel et systémique, puisqu’elles s’imbriquent et se cumulent avec d’autres formes d’inégalités professionnelles, d’attitudes hostiles dans l’emploi, et de rapports de domination spécifiques à ce secteur d’activité. Les discriminations systémiques résultent ainsi d’un système discriminatoire, c’est-à-dire d’un ensemble de phénomènes dont les sources et les acteurs sont divers, hétérogènes, mais qui se cumulent pour fabriquer de la discrimination et une relégation professionnelle qui maintiennent certaines catégories de salariés en bas de la hiérarchie sociale.
Des préjugés tenaces à l’origine de violences sexistes et sexuelles dégradantes
Le domicile comme lieu de travail accroît le risque de reproduire des schémas de la domination sociale et patriarcale qui trouvent leurs racines dans l’héritage de la domesticité du XIXème siècle : relation asymétrique entre une femme précaire et un employeur historiquement masculin et souvent plus aisé ; imaginaire de la "petite bonne" au service de ses maitres et contrainte d’avoir des relations sexuelles avec les "bourgeois de l’immeuble" ; préjugés sur la disponibilité sexuelle de la salariée du fait des tâches domestiques qu’elle prend en charge etc. Un tiers des professionnelles de l’aide à la personne ont ainsi fait l’objet de remarques gênantes sur leur tenue ou physique, 20 % d’entre elles ont déjà reçu des propos, écrits ou images à caractère sexuel dans le cadre de leur activité professionnelle et 8 % d’entre elles ont déjà subi des pressions dans leur emploi pour obtenir un acte de nature sexuelle.
Les résultats de l’étude témoignent d’une surexposition des professionnelles de l’aide à la personne aux violences sexistes et sexuelles par rapport à la population active globale. Dans ce secteur d’activité, environ une personne sur cinq (22 %) s’est vu imposer des contacts physiques légers (contre 18 % dans la population active globale), environ une sur six (16 %) s’est déjà vu toucher les seins, les fesses, le sexe ou le haut des cuisses au travail (contre 12 %) et 8 % rapportent avoir été embrassées de force sur la bouche.
Des demandes illégales
Dans le secteur des services à la personne, 40 % des salariées ont déjà été confrontées à des propos stigmatisants, 25 % à des demandes illégales lors d’un entretien pour un poste ou une promotion. Les attentes illicites des employeurs et employeuses se traduisent principalement par des incitations ou pressions pour que la candidate change sa manière de se présenter (coiffure, maquillage, etc.), renonce à ou diffère un projet de grossesse ou prenne ou perde du poids.
Des actes et situations de dévalorisation
Les conditions de travail (intervention dans l’intimité d’un domicile, précarité de l’emploi, relation asymétrique avec l’employeur) et la sous-valorisation de ces métiers (activité non reconnue comme qualifiée, souvent "au contact de la souillure ou de la saleté" et au "service de personnes") constituent un terrain propice à des injonctions sexistes, au harcèlement sexuel et/ou à des agressions sexuelles caractérisées.
Plus d’un quart de la population du secteur de l’aide à la personne déclare avoir déjà connu une ou plusieurs situations de dévalorisation au cours de sa vie professionnelle (sous-estimation des compétences, attribution de tâches ingrates, dévalorisation injuste du travail, etc.).
Ces situations de dévalorisation peuvent se coupler avec des propos ou comportements gênants, insultants ou humiliants liés à un critère prohibé de discrimination. À l’instar des discriminations rapportées, ils relèvent principalement de normes et pratiques sexistes (critères de l’apparence physique et du sexe), validistes (critères de l’état de santé) et âgistes (critère de l’âge).
Les conséquences professionnelles et psychologiques de la discrimination sur les salariées des services à la personne
Les discriminations (remarques ou "blagues" déplacées, injonctions illégales, propos et comportements stigmatisants ou humiliants, traitement inégal, harcèlement moral et/ou sexuel, etc.) ont des répercussions multiples sur la confiance en soi des salariées qui en sont victimes mais aussi, sur les relations avec l’entourage professionnel et les proches.
Une rupture de contrat anticipée
Deux tiers des professionnelles des services à la personne ayant vécu une discrimination ont connu des répercussions sur leur vie professionnelle à la suite des faits. Du fait de la précarité des contrats dans ce secteur, les discriminations vécues se traduisent davantage que dans la population active par une rupture du contrat de travail, que ce soit à l’initiative de l’employeur ou de la personne victime : 22 % des salariées ayant vécu une discrimination dans le secteur des services à la personne ont décidé de démissionner ou de négocier une rupture conventionnelle (contre 16 % pour l’ensemble de la population active) et 17 % ont été licenciées ou ont vu leur contrat non renouvelé à la suite des faits (contre 7 % pour l’ensemble de la population active).
Une dégradation de la santé mentale
La discrimination et le harcèlement discriminatoire peuvent avoir des conséquences délétères sur les individus, leur parcours et leur santé, que ce soit au moment des faits ou durablement. Par leur caractère systémique et répété, ils ne se traduisent pas seulement par le refus d’un poste, d’une promotion ou d’une augmentation salariale, mais par des conséquences de long terme sur la carrière des individus (obtention de postes en dessous des compétences, déclassement social, carrières amputées avec de longues périodes de chômage ou de travail précaire) et/ ou sur la santé et le bien-être (découragement, perte de confiance en soi, altération de la santé mentale et des relations sociales, etc.).
Dans le secteur des services à la personne, les sentiments de colère, de peur, de tristesse et de honte affectent souvent les individus ayant vécu une discrimination dans l’emploi, parfois longtemps après les faits : 86 % des personnes qui ont vécu une discrimination ressentent de la colère au moment des faits, et la moitié d’entre elles éprouve ce ressentiment durablement.
Après avoir vécu une discrimination, près de 70 % des professionnelles du secteur reconnaissent avoir traversé une période où leur santé mentale s’est dégradée (tristesse, fatigue, dépression, peur, sentiment d’isolement) et 38 % ont subi ces répercussions psychologiques sur le long terme.
Les discriminations peuvent aussi affecter les relations avec l’entourage professionnel ou les proches : la moitié des répondantes ayant vécu une discrimination a eu des relations perturbées avec le collectif de travail à la suite des faits, un tiers avec sa famille et un quart avec ses amis.
Une tendance naturelle à s’autocensurer
L’anticipation de discriminations éventuelles peut également conduire à des comportements d’autocensure. La moitié des travailleuses des services à la personne ayant été victimes de discrimination dans l’emploi pense qu’il est probable ou certain qu’elles soient à nouveau discriminées à l’avenir. Et plus d’un quart (26 %) de celles qui n’ont jamais vécu de discrimination au travail considèrent qu’il est probable ou certain que cela leur arrive au cours de leur vie professionnelle.
Par conséquent, près d’un quart (24 %) des professionnelles interrogées, qu’elles aient été discriminées ou non, se sont déjà autocensurées lors de la recherche d’un emploi, en ne répondant pas à des offres d’emploi qui correspondaient pourtant à leurs compétences.
Trop peu de dénonciations face à tant d’injustices
Deux tiers (67 %) des salariées victimes de discrimination dans ce secteur en ont parlé ou ont entrepris des démarches à la suite des faits (contre 72 % dans l’ensemble de la population active). Cependant, la plupart d’entre elles en ont surtout parlé à des proches (36 %).
Par rapport à la population active globale, une plus faible proportion en a parlé à des collègues (18 % contre 26 %) ou alerté la médecine du travail ou son médecin traitant (17 %), la direction ou l’encadrement (16 % contre 26 %) ou les syndicats et les représentants du personnel (12 %). Par rapport à la population active globale, les professionnelles de ce secteur engagent enfin beaucoup moins de recours auprès de l’inspection du travail (7 % contre 13 %) ou des juridictions (3 % contre 9 %).
Une aide à domicile livre ce témoignage bouleversant : "Vous savez il y a des groupes Facebook et j’étais inscrite dans un groupe Facebook d’aides à domicile et des fois on échange, parce qu’on travaille presque seules en gros, donc on échange sur les façons de travailler etc. et je me suis aperçue que j’étais pas la seule [à avoir subi des discriminations], dans ce milieu-là, c’est incroyable le jugement des gens qu’il peut y avoir !"
Une salariée des services a témoigné du fait suivant : "Ce que je regrette c’est de ne pas avoir posé plainte contre lui parce que je sais qu’il y a quand même une sacrée protection au niveau de la justice par rapport au harcèlement au travail, y a une sacrée protection. Et heureusement !"
Par ailleurs, un quart des professionnelles confrontées à la discrimination (24 %) n’ont rien dit à la suite des faits. Ce non recours s’explique notamment par le fait que les victimes pensaient que cela n’aurait rien changé (50 % d’entre elles), ne savaient pas quoi faire (24 % d’entre elles) ou avaient peur des représailles (24 %). Il résulte aussi de la quasi-absence de collectifs de travail, la dissémination des salariées auprès de différents bénéficiaires de services et l’absence parfois de hiérarchie bien identifiée.
Pour conclure
Cette étude prouve, chiffres et témoignages à l’appui, qu’il est impératif que les organisations du secteur protègent leurs salariées. Une attention particulière doit être portée aux mesures de prévention, de protection (accompagnement, prévention des mesures de rétorsion éventuelles, etc.) et de sanction en matière de discrimination, et notamment de harcèlement sexuel, en veillant particulièrement aux catégories de salariées les plus marginalisées de ce secteur d’activité.
Par ailleurs, il est aujourd’hui plus que nécessaire de mettre en œuvre une politique volontariste de revalorisation des métiers des services à la personne et plus largement des métiers à prédominance féminine, qu’il s’agisse des revenus, des conditions de travail, de la protection sociale et juridique, de la formation ou de la reconnaissance statutaire.
Retrouvez la source et l'ensemble de l'étude ainsi que les informations sur le Défenseur des droits ici.