Après plusieurs mois de travail, auditions d’experts, ateliers de concertation (parents, enfants, enseignants, élus locaux…), les 130 citoyens tirés au sort ont rendu un rapport final, avec 20 propositions majeures.
Les propositions phares, ce qui pourrait changer à la rentrée
Une semaine à 5 jours, dès le primaire
- Fin du modèle actuel : selon la convention, l’école se ferait du lundi au vendredi, du primaire au lycée.
- L’objectif : plus de régularité, de stabilité, mais aussi éviter des matinées en semaine inégales (ex : mercredi libre ou non selon les communes).
Des journées repensées : début plus tard, fin plus tôt, volumes allégés
- Pour les collégiens/lycéens : début des cours à 9h.
- Dans le secondaire : des cours réduits de 55 à 45 minutes pour alléger la charge et respecter le rythme de concentration des adolescents.
- Matin : partie théorique (maths, français, histoire…); après-midi : pratique, ateliers, projets interdisciplinaires, activités artistiques, sportives, vie pratique, etc.
- Pause méridienne allongée : 1h30 minimum, avec un temps de repas de 30 à 45 minutes selon l’âge.
Moins de « scolaire », plus d’épanouissement global
- Moins de devoirs à la maison : l’idée est de faire les « devoirs » à l’école, dans des espaces adaptés.
- Moins d’élèves par classe, meilleure détection/accompagnement des enfants avec besoins spécifiques ou en situation de handicap.
- Un socle commun d’apprentissages enrichi : vie pratique, culture, arts, sport, citoyenneté, apprentissages concrets… En bref, un bon mélange entre théorie et réalité de la vie.
Et quand certains enfants préfèrent un cadre plus individualisé, les cours particuliers : un secteur en plein essor, ou un soutien scolaire adapté peuvent venir compléter cette école repensée, sans rupture avec l’idée d’un socle commun.
Vacances & temps libre, un vrai rééquilibrage
- Les 16 semaines de vacances par an sont maintenues.
- Mais le découpage change : les 3 zones actuelles passeront à 2 zones pour les vacances d’hiver et de printemps, afin d’harmoniser les vacances sur le territoire.
- Plus global : la convention ne se limite pas à l’école, elle vise à repenser tous les temps de l’enfant : scolaire, périscolaire, extrascolaire, loisirs, transport, cadre de vie, etc.
« C’est comme un cercle vicieux… »
Lors des ateliers « voix de l’enfant », un adolescent raconte :
« C’est comme un cercle vicieux : on commence tôt, on finit tard, transports, devoirs, coucher... On n’a pas de temps, on se prive, on ne peut pas profiter. »
Ce constat, pas glamour, mais réel, a profondément marqué les citoyens de la convention. L’objectif est clair : redonner du temps aux enfants. Pour apprendre, mais aussi respirer.
Pourquoi c’est important ? Des espoirs et des craintes
Ce que ça pourrait apporter
- Un quotidien moins stressant pour les enfants : des journées raccourcies, des réveils plus doux, des après-midis moins chargés, du temps libre réel.
- Une école plus équilibrée, équilibrant savoirs académiques et compétences de vie, arts, sport, créativité, pour mieux préparer les enfants à la vie.
- Moins d’inégalités : en faisant les devoirs à l’école, certaines disparités liées au soutien parental ou aux conditions de vie seraient atténuées.
- Un vrai souci du bien-être : santé, rythme biologique, sommeil, repos, loisirs. L’enfant redeviendrait au centre du dispositif.
Ce qui risque de coincer (et ce que certains redoutent)
- Un sacré boulot d’organisation : planning, périscolaire, transports, locaux, intervenants… Les collectivités, les écoles, les parents devront s’adapter.
- Des coûts, par exemple pour réduire les effectifs, rénover les bâtiments, financer des intervenants.
- Des désaccords autour de ce qu’est « l’école » : certains craignent que ce glissement vers l’éducation globale affaiblisse les fondamentaux académiques.
- Et, question délicate, la faisabilité politique : comme pour les précédentes conventions citoyennes, rien ne garantit que l’État adopte ces propositions.
Et maintenant… ça donne quoi concrètement ?
À ce stade, ces propositions ne sont que des recommandations citoyennes. À charge pour le gouvernement et les parlementaires de décider s’ils les intègreront dans un projet de loi, ou s’ils préfèrent une autre trajectoire.
Mais ce rapport pose un jalon intéressant : pour la première fois depuis longtemps, l’organisation du temps des enfants est repensée « de l’intérieur », avec des citoyens tirés au sort, des ateliers participatifs, la parole des enfants et des familles, et non simplement redéfinie par des politiques ou des administrations.
Si ces idées se concrétisent, l’école et le temps long de l’enfance pourrait changer profondément. Et pas juste les emplois du temps.
Que peut-on retenir ?
La Convention citoyenne sur les temps de l’enfant pourrait bien provoquer un big bang dans l’organisation scolaire et le quotidien des familles : semaine de 5 jours, journées raccourcies, mix théorie/pratique, devoirs à l’école, vacances repensées, liberté retrouvée… Tout un programme.
Est-ce qu’on est en train d’inventer « l’école du futur » ou juste de rêver un réaménagement de nos vies… ? Probablement un peu des deux. Mais ce genre de réformes mérite qu’on s’y intéresse, qu’on discute et qu’on fasse entendre la voix des enfants, de leurs parents, de ceux qui rêvent d’un quotidien plus humain.
Dans notre dernier épisode du podcast "Servez-vous", nous explorons le sujet de l’école inclusive. Malgré des avancées législatives et des dispositifs dédiés, la scolarisation des enfants en situation de handicap reste un défi quotidien pour les familles, enseignants et élèves.








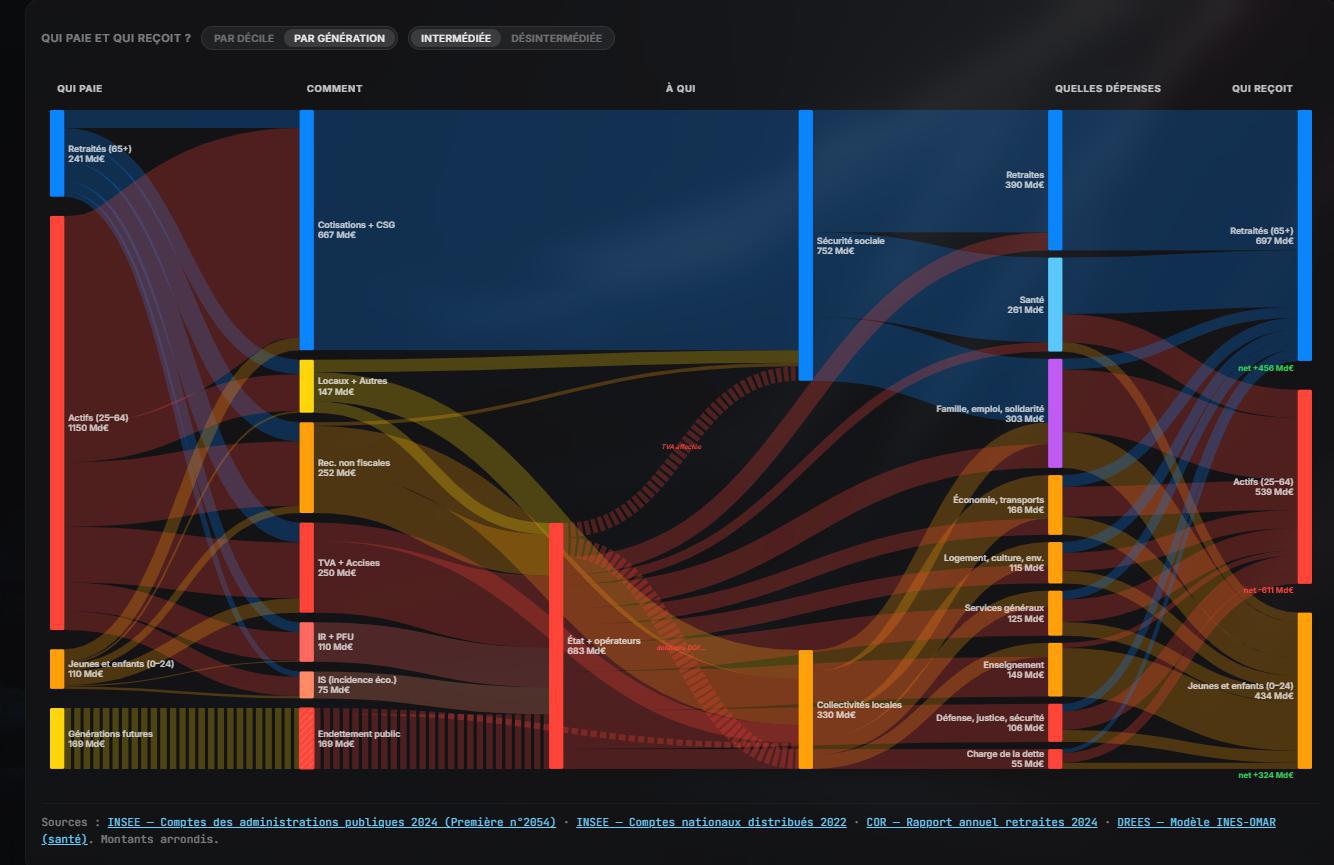
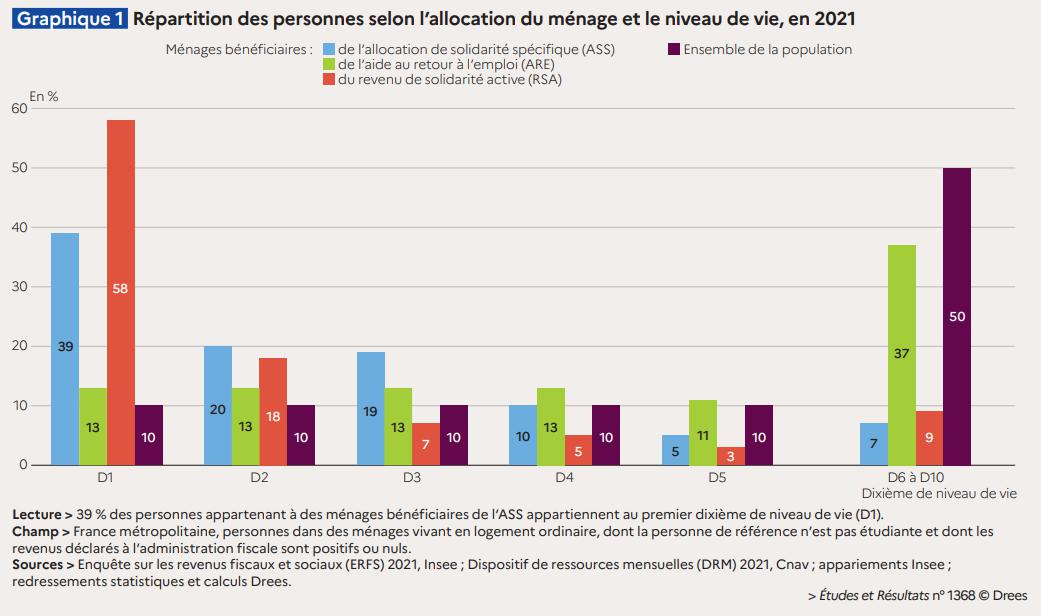

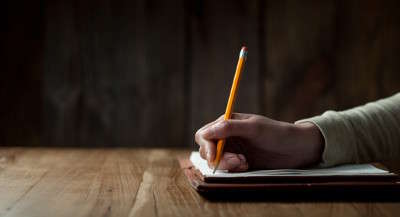
Bonjour Madame/ Monsieur.
Je suis Sultana Nasreen. Je suis interessée et disponible immédiatement .
Merci. Bonne journee.
Cordialement. Sultana
Nous vous invitons à < href="https://www.aladom.fr/monaladom/mes-annonces/service/ajouter/">déposer une annonce gratuitement pour recevoir des demandes et trouver un emploi.
Bon courage pour votre recherche.