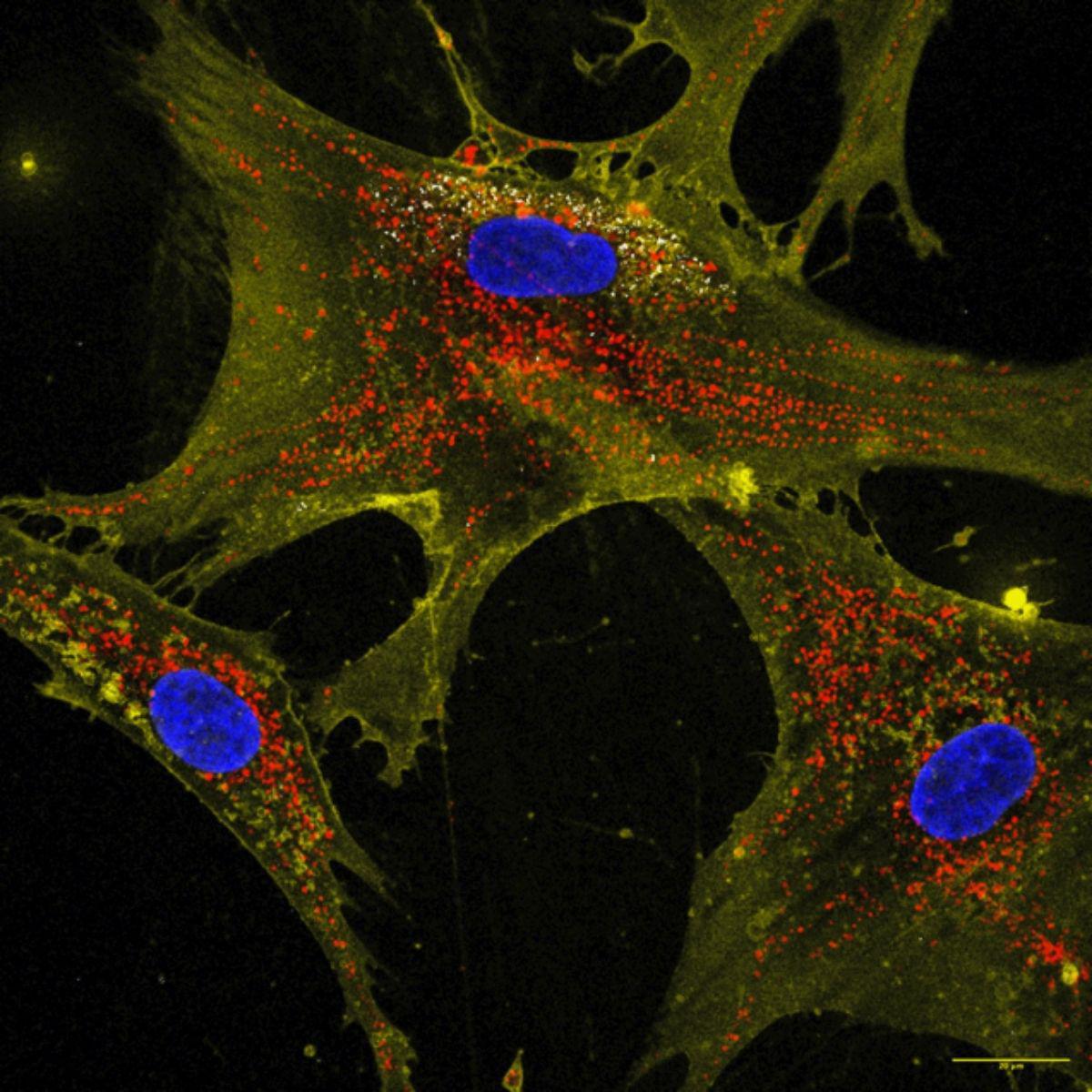Alors que le nombre de lits à l’hôpital continue de diminuer, le domicile s’impose de plus en plus comme un lieu de soins à part entière. Selon les dernières données publiées par la Drees, la capacité d’accueil en hospitalisation à domicile (HAD) a progressé de 5,5 % en 2024, après déjà +4,1 % en 2023.
Publié le 13 novembre 2025 06:10 Évolution du nombre de lits d'hospitalisation et de places
Évolution du nombre de lits d'hospitalisation et de placesActualités du secteur
🏠 Le virage du domicile s’accélère : l’hospitalisation à domicile progresse de 5,5 % en 2024
Mis à jour le 12 novembre 2025 12:38
Un mouvement de fond vers le “virage ambulatoire”
Depuis près de vingt ans, l’organisation des soins en France évolue profondément : l’hospitalisation complète recule, tandis que les alternatives se développent. L’hospitalisation partielle (sans nuitée) et surtout l’hospitalisation à domicile permettent d’éviter des séjours prolongés à l’hôpital, tout en offrant un accompagnement médical équivalent.
Fin 2024, les 2 965 établissements de santé français comptaient :
- 367 300 lits pour l’hospitalisation complète,
- 91 200 places pour l’hospitalisation partielle,
- et 25 400 patients pouvant être pris en charge simultanément à domicile.
L’HAD représente désormais 8,1 % des capacités totales d’hospitalisation complète (hors psychiatrie), contre seulement 2,1 % en 2006.
Moins de lits, mais plus de soins à domicile
La baisse du nombre de lits se poursuit (-0,5 % en 2024), mais à un rythme plus lent qu’au cours des dernières années. Cette évolution traduit à la fois les efforts d’optimisation du système hospitalier et le développement de nouvelles pratiques rendues possibles par les progrès technologiques et médicaux.
Les soins qui nécessitaient autrefois plusieurs jours d’hospitalisation peuvent aujourd’hui être assurés à domicile : perfusions, pansements complexes, suivi post-opératoire, traitements oncologiques ou palliatifs… L’HAD permet de rendre les soins plus humains, tout en allégeant la pression sur les établissements.
Le domicile, un enjeu majeur pour le futur des soins
Ce mouvement s’inscrit dans une transformation plus large du secteur médico-social : les frontières entre hôpital, ville et domicile s’estompent. Le développement de l’HAD s’appuie sur des professionnels de santé formés, mais aussi sur des intervenants à domicile (aides-soignants, auxiliaires de vie, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes…), dont le rôle devient essentiel dans la coordination des parcours de soins.
Pour les personnes âgées ou fragilisées, cette évolution représente une opportunité de rester chez soi plus longtemps, dans un environnement familier, tout en bénéficiant d’un encadrement médicalisé.
Une tendance appelée à se renforcer
Avec la montée en puissance des politiques publiques en faveur du maintien à domicile et le vieillissement de la population, les besoins en soins et accompagnements à domicile devraient continuer à croître.
Si vous avez besoin d'aide concernant le maintien à domicile de vous même ou d'un proche, rendez-vous ici.
Si vous avez besoin d'aide concernant le maintien à domicile de vous même ou d'un proche, rendez-vous ici.
Les acteurs du secteur, qu’ils soient publics ou privés, doivent désormais relever un double défi :
- Renforcer les équipes capables d’intervenir à domicile,
- Garantir la qualité et la continuité des soins sur tout le territoire.
En résumé : la France poursuit sa mutation vers un modèle de santé plus souple, plus proche des patients et plus ancré dans la vie quotidienne. Le domicile n’est plus seulement un lieu de vie : il devient un pilier central de la prise en charge médicale et sociale.
Partager cet article :
Commentaires
Il n'y a pas de commentaires pour le moment
Nos ressources pour les professionnels

Comment optimiser un recrutement humain et structuré ?
Témoignage - Agence AXEO Services Vallée de Chevreuse
voir le témoignage
Comment recruter rapidement des profils intéressants ?
Témoignage - Adhap Poitiers
Voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros