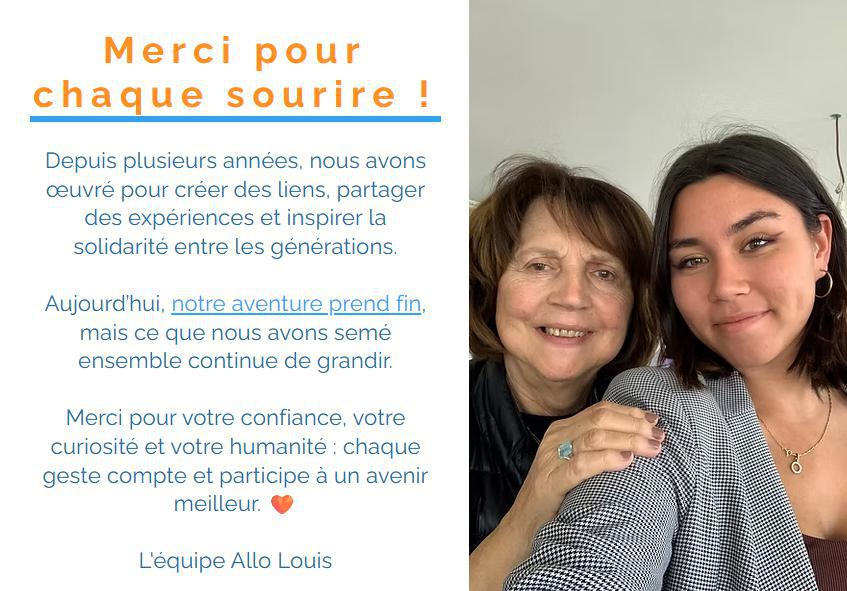La rentrée 2025 a ravivé un sujet qui divise parents, enseignants et élèves : l’interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires. Déjà inscrite dans la loi depuis 2018 pour les écoles et collèges, la mesure a été réaffirmée cette année par le gouvernement, qui souhaite renforcer son application. Mais sur le terrain, entre manque de moyens, inquiétudes des familles et créativité des établissements, la mise en œuvre reste un défi quotidien.
Publié le 8 septembre 2025 09:00
Interdiction du portable au collège : entre fermeté, scepticisme et casse-tête logistique
Une mesure ancienne mais renforcée
Depuis la loi de 2018, les téléphones portables sont interdits à l’école et au collège, sauf usages pédagogiques encadrés. L’objectif affiché : protéger les élèves des distractions numériques, favoriser la concentration et lutter contre le cyberharcèlement. Cet été, la Première ministre Élisabeth Borne a rappelé que cette règle devait être strictement appliquée dès la rentrée : « Il ne s’agit pas d’une option mais d’une obligation », a-t-elle insisté dans un entretien à Ouest-France.
Pour autant, les pratiques restent disparates selon les établissements. Certains privilégient les casiers, d’autres imposent des pochettes individuelles, d’autres encore se contentent d’appels à la vigilance.
Pour accompagner au mieux les élèves, notamment lors de la rentrée, nous avions déjà montré comment la combinaison entre garde d’enfants et soutien scolaire pouvait être un vrai atout.
Des bénéfices mis en avant
À l’international, plusieurs pays qui ont déjà durci leurs règles affichent des résultats encourageants. Une enquête relayée par Challenges souligne une baisse des cas de harcèlement scolaire et une meilleure socialisation des élèves. Dans les cours de récréation, les jeux collectifs reprennent le dessus, et les enseignants observent une amélioration de l’attention en classe.
En France, certains élèves reconnaissent aussi des aspects positifs. « Au moins, je ne risque pas de me le faire voler », confie une collégienne interrogée par Libération, mi-soulagée, mi-sceptique.
Pour les familles qui cherchent un accompagnement concret, nous proposons également un service dédié de soutien scolaire, complémentaire aux dispositifs éducatifs existants.
Mais une application inégale et coûteuse
Sur le terrain, la mise en œuvre soulève des difficultés financières et pratiques. Installer un casier pour chaque élève peut coûter plusieurs millions d’euros à un département : en Haute-Garonne, la facture est estimée à plus de 5,5 millions d’euros. Une dépense que certains conseils départementaux refusent de prendre en charge. Dans la Sarthe, le financement de pochettes individuelles a même été rejeté, comme l’a rapporté France Bleu.
Résultat : chaque établissement bricole avec ses moyens. Dans certains collèges, les élèves déposent leur téléphone à l’entrée dans une boîte commune, dans d’autres, ils doivent le garder éteint au fond du cartable. Des solutions loin d’être idéales.
Et pour les familles monoparentales, la revalorisation de l’allocation de soutien familial représente un coup de pouce important pour mieux gérer ces nouvelles contraintes.
Entre adhésion et scepticisme
L’adhésion des élèves et des parents est loin d’être acquise. Dans le Bocage virois, Ouest-France a recueilli le témoignage d’un enseignant qui souligne la difficulté de contrôler systématiquement les usages : « On passe plus de temps à vérifier les poches qu’à faire cours. »
Certains parents, eux, s’inquiètent de ne pas pouvoir joindre leurs enfants en cas d’urgence. À Nancy, une « pause numérique » reste encore à l’étude, selon France Bleu Lorraine. Une initiative qui permettrait de fixer des moments précis où l’usage du téléphone serait toléré, tout en limitant les excès.
Chez Aladom, on s’est aussi intéressé à cette idée de pause numérique, qui pourrait être une voie médiane pour concilier interdiction et réalité du quotidien des élèves.
Quelles sanctions pour les contrevenants ?
La règle est claire : un élève surpris à utiliser son portable dans l’enceinte de l’établissement s’expose à une confiscation, voire à une sanction disciplinaire. Comme le rappelle Femme Actuelle, ces sanctions peuvent aller de l’avertissement au passage devant le conseil de discipline, selon la gravité de la récidive. Une sévérité qui interroge certains syndicats d’enseignants, craignant une « judiciarisation » excessive de la vie scolaire.
Et maintenant ?
Entre volonté politique ferme et résistances du terrain, l’interdiction du portable au collège reste un sujet inflammable. La promesse d’un cadre plus apaisé pour les élèves se heurte à la réalité des moyens et des usages numériques ancrés dans le quotidien des adolescents.
On le constate chaque année, la rentrée implique aussi une réorganisation familiale, et des services à domicile peuvent aider à trouver le bon équilibre entre école, travail et vie personnelle.
Comme souvent, la réussite de la mesure ne se jouera pas uniquement dans les textes, mais dans l’adhésion collective : celle des élèves, des enseignants et des familles. Et si la rentrée a rappelé les règles, c’est dans les mois qui viennent que se mesurera vraiment leur efficacité.
Chez Aladom, on suit de près l’évolution de ces politiques éducatives qui interrogent notre rapport collectif au numérique. Car derrière la question du portable à l’école, c’est bien celle de l’équilibre entre technologie, apprentissages et vie sociale qui se dessine.
Partager cet article :
Nos ressources pour les professionnels

Comment développer sa clientèle rapidement et durablement ?
Témoignage - Melior Services
Voir le témoignage
Comment développer son portefeuille client avec succès ?
Témoignage - Vamilo
Voir le témoignageSur le même thème
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros