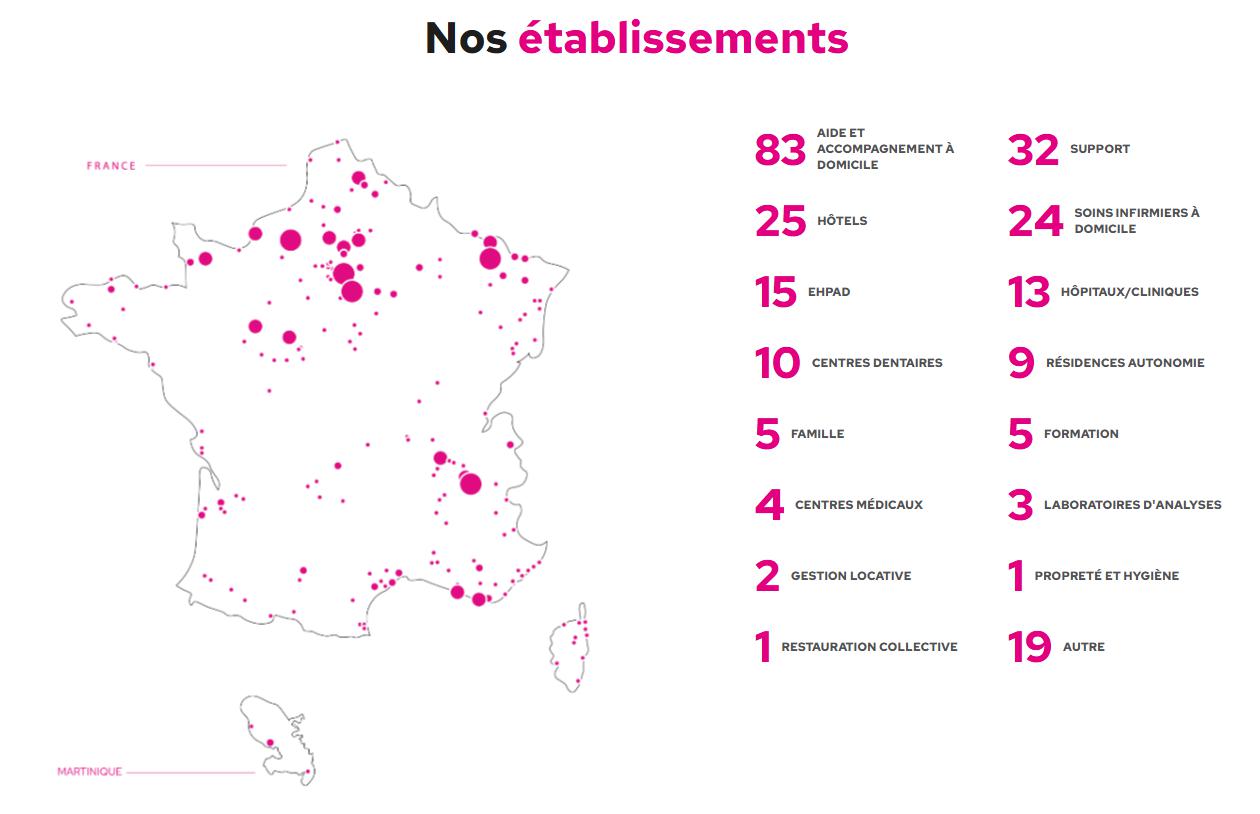Choisir un logement adapté à ses besoins en vieillissant n’est pas toujours simple. Entre le désir de rester autonome, le besoin de sécurité et l’envie de maintenir un lien social, les seniors et leurs familles doivent naviguer parmi de nombreuses options. En 2025, les maisons partagées et les dispositifs de cohabitation intergénérationnelle émergent comme des alternatives innovantes aux maisons de retraite traditionnelles. Ces nouvelles formes d’habitat promettent plus de convivialité, de flexibilité et souvent, un meilleur rapport qualité-prix. Mais en quoi consistent-elles vraiment ? Quels sont leurs avantages et leurs limites ? Cet article vous guide pour y voir plus clair et faire un choix éclairé.
Publié le 1 septembre 2025 15:40 Les maisons partagées et les dispositifs de cohabitation intergénérationnelle sont des alternatives innovantes aux maisons de retraite traditionnelles
Les maisons partagées et les dispositifs de cohabitation intergénérationnelle sont des alternatives innovantes aux maisons de retraite traditionnellesActualités du secteur
Ce que les maisons partagées changent vraiment pour les seniors
Sommaire
Les maisons partagées pour seniors : une alternative conviviale aux EHPADRésidences autonomie et autres alternatives : quelles différences ?
Cohabitation intergénérationnelle : quels bénéfices psychologiques et sociaux ?
Quels critères pour choisir son logement senior ?
FAQ : Vos questions sur les maisons partagées et alternatives
Vers un habitat senior plus humain et flexible
Partager cet article
Les maisons partagées pour seniors : une alternative conviviale aux EHPAD
Les maisons partagées pour seniors, aussi appelées habitats partagés ou colocations intergénérationnelles, sont des logements où plusieurs personnes âgées (ou des seniors et des jeunes) cohabitent sous le même toit. Ces structures permettent de rompre l’isolement tout en conservant une grande autonomie. Contrairement aux EHPAD, elles offrent un cadre plus informel, souvent plus économique et centré sur la vie communautaire.
Comment marchent les maisons partagés ?
- Un logement adapté : Les maisons sont généralement aménagées pour faciliter l’accessibilité (salles de bain sécurisées, espaces communs ergonomiques, etc.).
- Une vie sociale enrichie : Les résidents partagent des moments de vie (repas, activités, sorties), ce qui limite la solitude et favorise les échanges.
- Un coût maîtrisé : Le partage des charges (loyer, courses, services) rend cette solution souvent plus abordable qu’une résidence classique. Pour en savoir plus sur le concept de maison partagée pour senior tarif, découvrez les options disponibles.
Exemple concret : Certaines maisons partagées intègrent des étudiants ou des jeunes actifs, créant ainsi un équilibre entre entraide et dynamisme. Les seniors bénéficient d’une présence rassurante, tandis que les plus jeunes profitent d’un logement à moindre coût.

A qui s'adressent les maisons partagées ?
Ces dispositifs conviennent particulièrement aux seniors autonomes ou légèrement dépendants, qui souhaitent éviter l’institutionnalisation tout en restant entourés. Ils sont aussi une solution intéressante pour les personnes atteintes de troubles légers (comme les premiers stades d’Alzheimer), à condition que l’encadrement soit adapté.
Résidences autonomie et autres alternatives : quelles différences ?
Les résidences autonomie
Anciennement appelées « logements-foyers », les résidences autonomie sont des ensembles de studios ou d’appartements indépendants, situés dans un même bâtiment. Elles proposent des services collectifs (restauration, animations, sécurité) tout en laissant une grande liberté aux résidents. Contrairement aux maisons partagées, elles sont gérées par des professionnels et offrent un niveau de sécurité plus élevé.
- Avantages : Sécurité 24h/24, accès à des soins si besoin, vie sociale organisée.
- Inconvénients : Coût plus élevé qu’une colocation, cadre parfois moins « familial ».
Les villages seniors et écohameaux
Inspirés des modèles nord-européens, ces villages regroupent des logements individuels autour d’espaces communs (jardins, salles d’activités). L’accent est mis sur l’écologie, la solidarité et l’autogestion.
A qui s'adressent les villages seniors ?
Seniors autonomes en quête d’un projet de vie communautaire et écologique.

Cohabitation intergénérationnelle : quels bénéfices psychologiques et sociaux ?
Vivre avec des personnes d’âges différents présente de nombreux atouts :
- Stimulation cognitive : Les échanges intergénérationnels maintiennent l’esprit actif et ouvert.
- Réduction de l’isolement : Le sentiment d’utilité (aider un étudiant, partager son expérience) renforce l’estime de soi.
- Sécurité affective : La présence de jeunes rassure les familles et crée un climat de confiance.
Témoignage : « Depuis que je vis en colocation avec deux étudiants, je me sens rajeunie. On cuisine ensemble, on discute… Je ne me sens plus seule ! » — Marie, 72 ans.
À noter : Certaines associations, comme 1Toit2Ages, facilitent la mise en relation entre seniors et jeunes.
Quels critères pour choisir son logement senior ?
Voici les questions à se poser avant de se lancer :
- Niveau d’autonomie : La structure propose-t-elle un accompagnement médical si besoin ?
- Budget : Quels sont les coûts cachés (charges, services optionnels) ?
- Localisation : Le logement est-il proche des commodités et des proches ?
- Ambiance : Préférez-vous un cadre intimiste (maison partagée) ou plus structuré (résidence autonomie) ?
- Flexibilité : Pouvez-vous quitter les lieux facilement si vos besoins évoluent ?
Conseil : Visitez plusieurs structures et discutez avec les résidents pour vous faire une idée précise.
FAQ : Vos questions sur les maisons partagées et alternatives
Q : Quel est le coût moyen d’une maison partagée pour senior ?
R : Comptez entre 500 € et 1 200 € par mois, selon la localisation et les services inclus. Certaines aides (APA, APL) peuvent réduire la facture.
Q : Peut-on essayer avant de s’engager ?
R : Oui ! Beaucoup de structures proposent des séjours découverts de quelques jours.
Q : Et si la dépendance augmente ?
R : Certaines maisons partagées sont reliées à des services d’aide à domicile ou à des EHPAD partenaires pour une transition en douceur.
Q : Comment trouver une maison partagée près de chez moi ?
R : Des plateformes répertorient les offres par région.
Vers un habitat senior plus humain et flexible
Les maisons partagées et les dispositifs intergénérationnels redéfinissent le vieillissement en misant sur le lien social, l’autonomie et la solidarité. En 2025, ces alternatives séduisent de plus en plus de seniors et leurs familles, à la recherche d’un équilibre entre sécurité et qualité de vie. Pour aller plus loin, découvrez notre article sur les aides financières pour l’aménagement du logement senior.
Et vous, quel type de logement envisagez-vous pour vos proches ou pour vous-même ? N’hésitez pas à partager vos questions ou expériences en commentaire !
Partager cet article :
Commentaires
Il n'y a pas de commentaires pour le moment
Nos ressources pour les professionnels

Comment recruter rapidement des profils intéressants ?
Témoignage - Adhap Poitiers
Voir le témoignage
EHPAD : Comment faire face aux problématiques de recrutement ?
Témoignage - EHPAD Résidence L'Adagio
Voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros