Une reconnaissance juridique enfin actée pour les infirmières coordinatrices
C’est une victoire discrète mais hautement symbolique : depuis le 10 juin 2025, les infirmières coordinatrices (IDEC) disposent enfin d’un statut reconnu par le Code de l’action sociale et des familles. Jusque-là, leur rôle pivot dans les EHPAD n’était défini que par voie de circulaire. Désormais, leur fonction est juridiquement encadrée, avec une fiche métier, un positionnement hiérarchique et des responsabilités officiellement identifiées.
Pour les principales intéressées, c’est une avancée majeure. L’IDEC est souvent le point de convergence entre soins, logistique, ressources humaines, relation avec les familles, et pilotage d’équipe. Sans statut clair, cette polyvalence reposait largement sur l’implication personnelle de chacune, sans protection statutaire ni reconnaissance salariale adaptée.
"Cela faisait 20 ans qu’on attendait ce moment. Cette reconnaissance va permettre de mieux définir notre place, de clarifier nos marges de manœuvre et, on l’espère, d’attirer de nouvelles IDE vers les fonctions de coordination", explique Julie, IDEC dans un EHPAD public du Loir-et-Cher.
La loi du 10 juin, soutenue par la majorité des fédérations du secteur, est aussi un signal envoyé à l’ensemble des soignants : celui d’un début de revalorisation structurelle, au-delà des primes ponctuelles ou des annonces symboliques.
Dans un contexte budgétaire encore tendu, ces dispositifs suscitent des attentes fortes. Comme nous le rappelions récemment dans notre article sur le financement des EHPAD en 2025, les hausses annoncées ne suffisent souvent pas à compenser l’inflation et les besoins en personnel.
Autre levier mis en œuvre à l’échelle nationale : Perf’EHPAD, un programme lancé par la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) pour soutenir les établissements dans leur transformation organisationnelle et managériale.
L’idée ? Offrir un accompagnement ciblé aux EHPAD qui souhaitent améliorer leur fonctionnement interne, développer la qualité de vie au travail ou renforcer l’autonomie des résidents. Concrètement, 200 EHPAD ont été retenus pour bénéficier d’un appui stratégique, d’ateliers collectifs, de journées thématiques et d’un budget dédié pour initier des projets pilotes.
"Perf’EHPAD est conçu comme un accélérateur de bonnes pratiques. Il s’agit de mettre en réseau les établissements, de casser les logiques de silos, et de valoriser l’innovation de terrain plutôt que les réponses descendantes", détaille un cadre de la DGCS.
Les thématiques abordées dans le programme vont de l’amélioration du dialogue social à la refonte des organisations de travail, en passant par le partage du pouvoir décisionnel avec les résidents. Le tout avec un fil conducteur : inscrire durablement les EHPAD dans une logique de qualité de vie, et non plus seulement de gestion de la dépendance.
Des dynamiques locales qui poussent à l’optimisme
En parallèle, des expérimentations plus souples émergent pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées. C’est notamment le cas de l’accueil de nuit en EHPAD, testé dans plusieurs établissements depuis 2024.
Au-delà de ces dispositifs nationaux, plusieurs initiatives locales illustrent la vitalité du secteur et sa capacité d’innovation. En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS a lancé un appel à projets pour équiper les EHPAD de rails plafonniers motorisés, dans une logique de prévention des troubles musculosquelettiques pour les soignants. Objectif : améliorer la sécurité des résidents tout en réduisant la pénibilité physique du personnel.
À Clermont-Ferrand, le Centre Hospitalier porte un projet EHPAD 2025-2029 centré sur les soins palliatifs, le handicap psychique vieillissant et la transition écologique. Un projet qui fait de la qualité d’accompagnement un fil rouge, au même titre que la réduction de l’empreinte environnementale.
Dans d’autres établissements, la notion de tiers-lieu gérontologique émerge. Elle consiste à faire de l’EHPAD un espace ouvert, connecté au tissu associatif et culturel local, où se croisent résidents, proches, bénévoles et partenaires extérieurs.
Le numérique au service de l’autonomie et du lien social
La transition numérique des EHPAD est également en marche, parfois à petits pas, mais dans une direction claire :
- Télémédecine pour éviter des transferts inutiles,
- Tablettes connectées pour communiquer avec les familles,
- Applications pour le suivi des soins et la traçabilité des prescriptions,
- Immersions en réalité virtuelle pour stimuler la mémoire ou l’imaginaire des résidents.
Ces outils, lorsqu’ils sont bien intégrés et non imposés, permettent d’améliorer l’accompagnement sans alourdir la charge mentale des équipes. Ils favorisent aussi l’individualisation du projet de vie, en rendant visible ce qui, jusque-là, échappait aux indicateurs traditionnels.
"Avec la réalité virtuelle, j’ai pu revoir les plages de Biarritz où j’allais enfant. Je ne pensais pas revivre ça un jour", raconte Gisèle, 91 ans, résidente à Bayonne.
Une approche plus humaine et participative
Des groupes comme Emera, que nous avons interviewé dans cet article, explorent de nouvelles manières d’aborder la vieillesse. Leur approche conjugue design, autonomie, et expression de soi au sein même de leurs établissements, démontrant que les EHPAD peuvent aussi être des lieux de vie inspirants.
Plusieurs établissements expérimentent une gouvernance partagée. Certains ont mis en place des conseils de vie sociale renforcés, où les résidents ont un réel pouvoir d’initiative. D’autres testent des démarches d’auto-organisation des équipes, sur le modèle des "villages Alzheimer" néerlandais.
Ces démarches vont souvent de pair avec une évolution du regard porté sur le vieillissement : on ne parle plus seulement de dépendance, mais de capacité, de désir, d’individualité. C’est un virage culturel, encore discret, mais porteur d’un changement de fond.
Des EHPAD à repenser, pas à supprimer
Comme nous le soulignions dans notre dossier sur les alternatives au modèle EHPAD traditionnel, la crise actuelle a le mérite de relancer le débat sur la diversité des modes d’accompagnement. De nouveaux modèles hybrides voient le jour, entre habitat partagé, maintien à domicile renforcé et structures intermédiaires.
Oui, les EHPAD ont encore des défis immenses à relever. Oui, les scandales passés et les difficultés actuelles sont bien réelles. Mais l’écho médiatique des mauvaises nouvelles ne doit pas faire oublier les efforts considérables de transformation à l’œuvre.
Les récentes avancées juridiques, managériales et technologiques laissent entrevoir un autre visage possible des EHPAD : celui d’un lieu de soin mais aussi de vie, d’attention, et même de plaisir.
Pour cela, il faut un engagement politique fort, mais aussi une écoute sincère de ceux qui vivent et travaillent dans ces établissements. C’est en valorisant les réussites, même modestes, que l’on changera progressivement le regard sur les EHPAD.
Pour mieux comprendre les enjeux de transformation profonde, nous avons également publié un livre blanc dédié aux EHPAD de demain, dans lequel chercheurs, dirigeants et acteurs de terrain partagent leur vision d’un modèle durable, humain et résolument tourné vers la qualité de vie.
Et si l’année 2025 était le début d’une nouvelle ère pour la prise en charge du grand âge ?
Dans cet épisode du podcast "Servez-vous", nous explorons le sujet de l’innovation technologique en EHPAD avec un focus sur les assistants vocaux intelligents, et leur impact sur le quotidien des soignants.







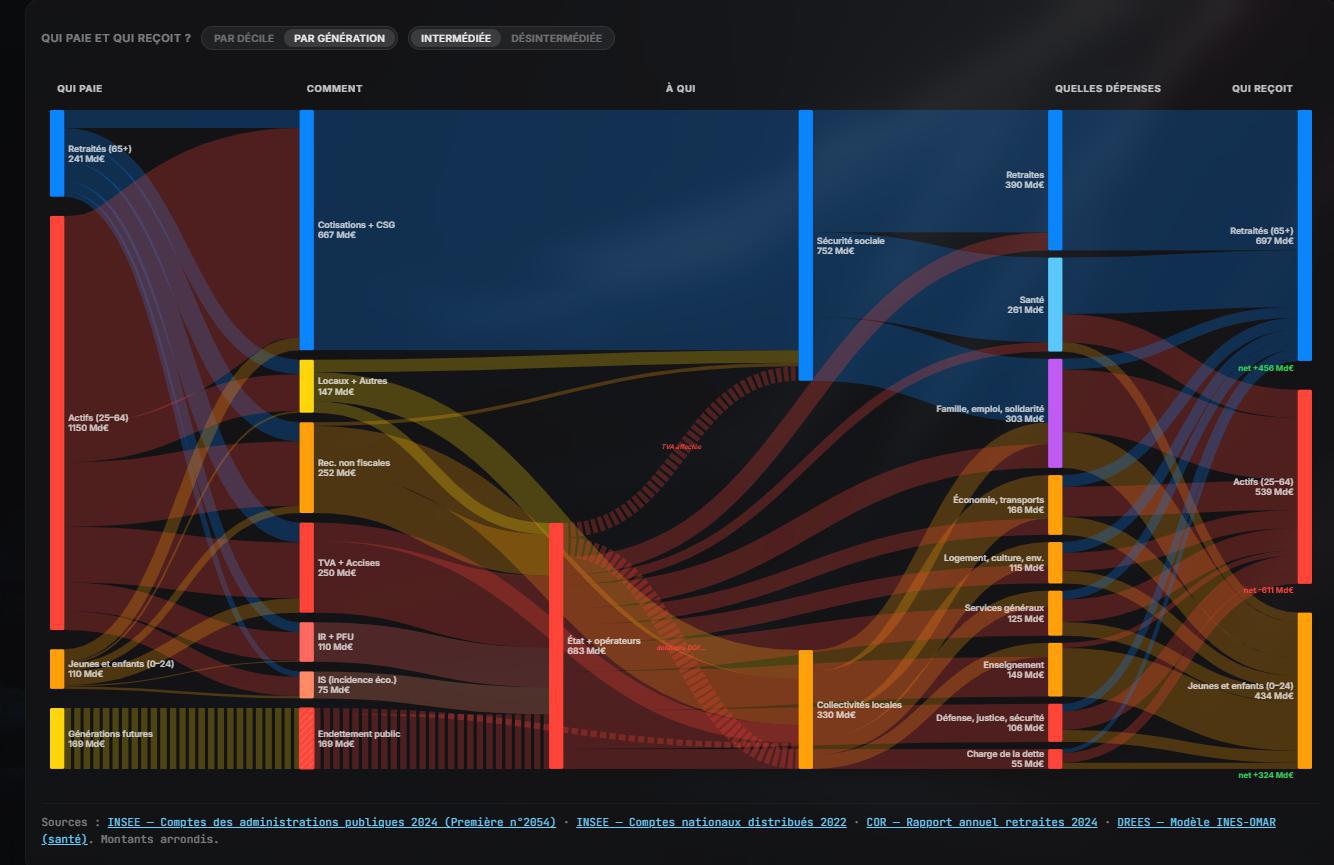
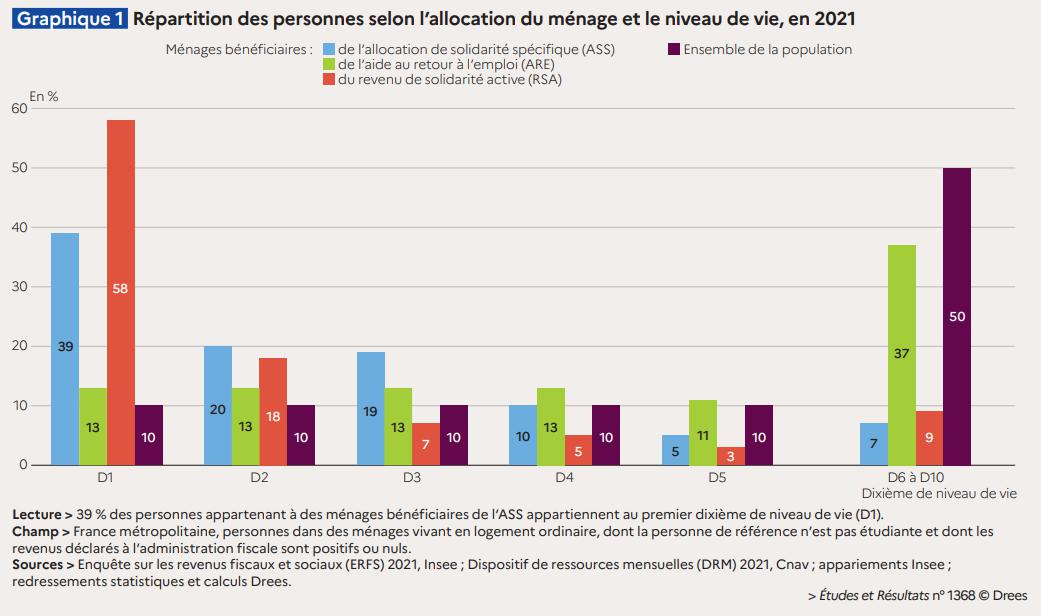



Anticiper sur le réchauffement climatique en installant des climatiseurs réversibles dans toutes les chambres ou logements, aujourd'hui seulement la salle commune est climatisée dans la majorité des cas. La responsable d'un EPAD m'a répondu que je pouvais installer une climatisation à mes frais et qui restera acquise à l'établissement à mon départ, où est la notion de confort dans votre réforme ?