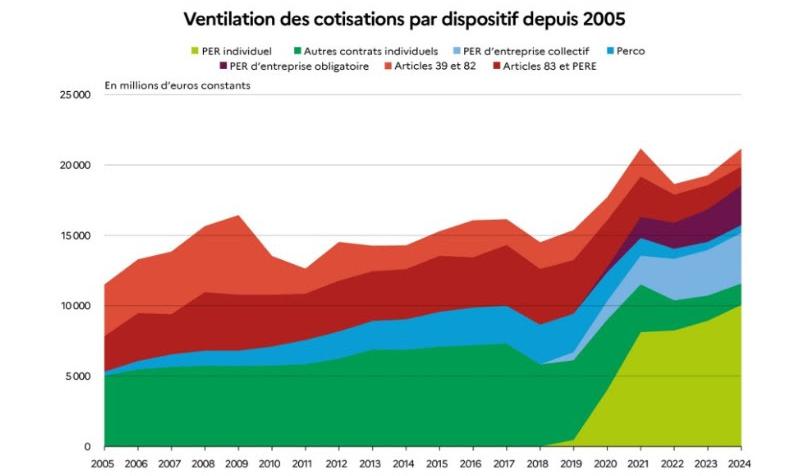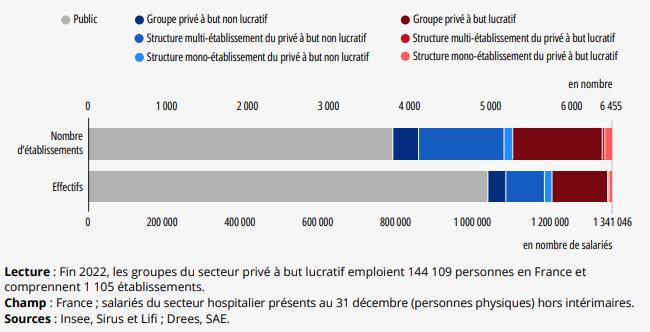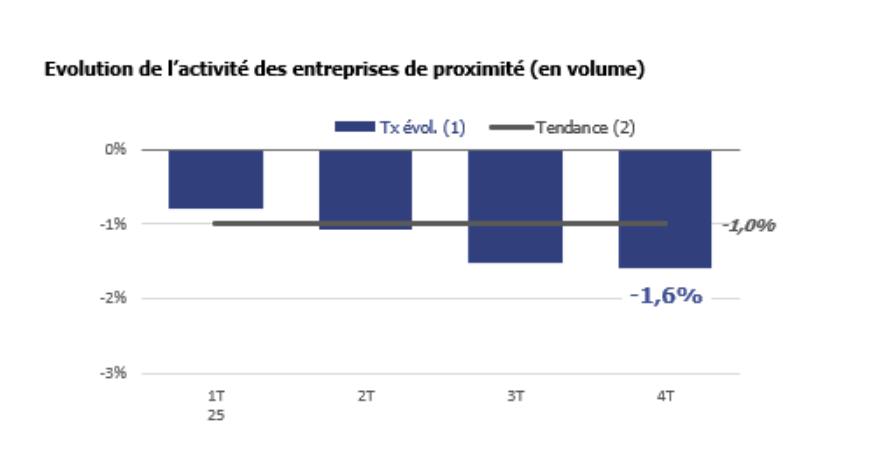Une carte pour reconnaître les professionnels du domicile
Depuis le 8 avril 2024, la loi "Bien vieillir" a officiellement créé une carte professionnelle destinée aux intervenants à domicile. Sa mise en œuvre effective est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Cette carte vise à répondre à une double problématique : mieux reconnaître le statut des aides à domicile, souvent invisibilisées, et sécuriser leurs interventions.
Valable cinq ans, cette carte se présente sous format numérique via le dispositif e-CPS, déjà utilisé par d’autres professionnels de santé. Elle est également imprimable pour un usage facilité sur le terrain. Concrètement, elle permet :
- d’attester de l’identité et des compétences de l’intervenant,
- de faciliter les déplacements et le stationnement pendant les interventions,
- d’accéder à des services numériques sécurisés (messagerie, annuaire professionnel, etc.).
Une avancée qui entend renforcer la professionnalisation du secteur, encore largement confronté à un manque de reconnaissance sociale et économique.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les services d’aide à domicile, les métiers concernés et les offres disponibles dans leur région, découvrez notre page dédiée à l’aide à domicile.
Qui est concerné ?
La carte professionnelle est désormais obligatoire pour tous les intervenants à domicile employés par une structure disposant d’un numéro FINESS (numéro d’identification des établissements médico-sociaux).
Cela concerne notamment :
- les aides à domicile,les auxiliaires de vie sociale (AVS),
- les accompagnants éducatifs et sociaux (AES),
- et plus largement les personnels intervenant au domicile de personnes âgées ou en situation de handicap.
Les structures doivent impérativement inscrire leurs salariés dans le répertoire RPPS+ (Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le champ de la santé), qui permet de générer la carte.
Quelles sont les conditions pour l’obtenir ?
Deux voies sont possibles :
- Par la qualification: il faut détenir une certification de niveau 3 (CAP ou équivalent) inscrite au RNCP dans les domaines sanitaire, social ou médico-social.
- Par l’expérience: justifier d’au moins trois ans d’expérience à mi-temps dans les cinq dernières années dans l’accompagnement à domicile.
- le DEAES (Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social),
- le Bac pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne),
- le CAP Accompagnant éducatif petite enfance,
- le titre professionnel Assistant de vie aux familles (ADVF),
- d’autres diplômes spécifiques au secteur.
Une démarche portée par l’employeur
L’enregistrement au RPPS+ est effectué par l’employeur, qui doit vérifier que le salarié remplit les conditions (qualification ou expérience).
C’est donc à la structure de :
- créer un compte sur le portail e-CPS,
- saisir les informations de ses salariés,
- et gérer le renouvellement de la carte (à anticiper trois mois avant son expiration).
Les structures mandataires ou les particuliers employeurs qui n’ont pas de numéro FINESS ne peuvent pas encore utiliser ce dispositif. Un mécanisme alternatif est en cours d’élaboration pour couvrir ces professionnels, nombreux dans le secteur.
Une mesure saluée, mais pas sans zones d’ombre
Du côté des professionnels, la carte est généralement perçue comme une avancée symbolique. "On se sent enfin considérés. C’est un vrai outil d’identification, surtout quand on intervient dans des quartiers où il peut y avoir des tensions ou de la méfiance", témoigne Chantal, auxiliaire de vie à Marseille.
Mais cette reconnaissance pose aussi de nombreuses questions :
- Que faire des intervenants expérimentés mais non diplômés ?
- Les structures auront-elles les moyens humains pour gérer l’inscription RPPS+ ?
- Quel accompagnement pour les particuliers employeurs ?
Dans un secteur déjà frappé par des pénuries de personnel, certains craignent que la carte ne devienne un nouveau frein au recrutement.
Le secteur en mutation
Cette réforme intervient alors que l’ensemble du secteur du domicile connaît de profondes évolutions. La généralisation des Services autonomie à domicile (SAD), qui doivent regrouper SAAD, SSIAD et SPASAD d’ici fin 2025, participe d’un mouvement de structuration globale.
Mais selon un récent rapport de la Banque des Territoires, les professionnels alertent sur un manque de lisibilité, des charges administratives lourdes, et un niveau de financement insuffisant. À titre d’exemple, la dotation socle fixée à 23,50 euros de l’heure reste bien en deçà du coût réel des prestations, estimé à 30 ou 35 euros de l’heure dans de nombreuses régions.
En parallèle, les tensions sur le recrutement ne faiblissent pas. On estime à 60 000 le nombre de postes non pourvusdans l’aide à domicile, selon France Travail. Et ce, alors que la demande explose avec le vieillissement de la population.
Une réponse partielle à un besoin plus large
La carte professionnelle ne réglera pas à elle seule les problèmes d’attractivité du métier. Mais elle marque une étape importante vers la reconnaissance de ces professionnels de l’ombre, trop souvent perçus comme des "petites mains" alors qu’ils sont au cœur du quotidien de milliers de Français.
Conclusion : une carte, et après ?
La carte professionnelle des aides à domicile s’inscrit dans une dynamique de structuration et de reconnaissance du secteur. Elle apporte une visibilité bienvenue à des métiers souvent précaires, tout en posant les bases d’un encadrement plus rigoureux.
Mais pour qu’elle soit réellement efficace, elle devra s’accompagner d’un soutien fort des pouvoirs publics : simplification des démarches, accompagnement des structures, revalorisation salariale et reconnaissance sociale. Sans cela, elle risque de rester un symbole, utile mais insuffisant.
La carte professionnelle s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur. De plus en plus de seniors cherchent à bien vieillir autrement, en dehors des modèles institutionnels classiques. Découvrez les alternatives explorées par les seniors.
Découvrez aussi notre podcast "Le futur de l’aide à domicile : quels défis, quelles solutions ?". On y parle recrutement, qualité de vie au travail, formation et reconnaissance.
⮕ Écouter l’épisode