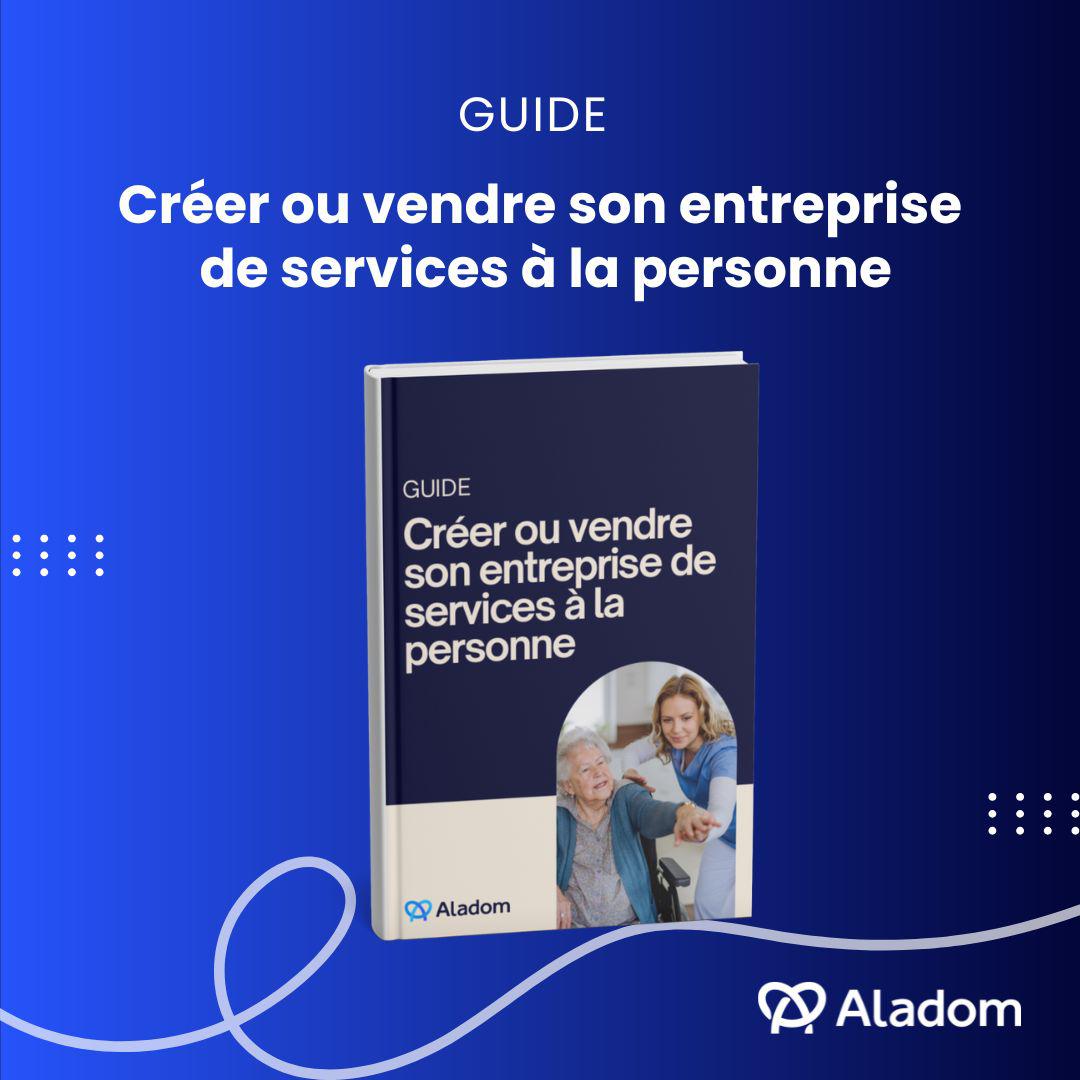Bilan positif de l’expérimentation selon Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail
D’après le
ministère des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes, la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 porte l’ambition d’une amélioration substantielle de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des entreprises grâce à l’implication collective et coordonnée de tous les acteurs du secteur de l’emploi afin d’atteindre les objectifs de plein emploi. Dès 2023, des territoires pilotes se sont donc engagés afin de tester un accompagnement rénové des allocataires du RSA. Ces nouvelles modalités d’accompagnement renforcé consistent notamment en une gestion du parcours des allocataires conjointe par France Travail et les départements, un accompagnement renforcé des allocataires vers l’emploi. Cet accompagnement s’appuie notamment sur des immersions professionnelles et une mobilisation des acteurs de l’insertion.
Durant la première phase d’expérimentation débutée au printemps 2023,
18 territoires pilotes ont testé les nouvelles modalités d’accompagnement rénové. A partir de mars 2024,
l’expérimentation a été étendue à 47 départements. Cette initiative vise non seulement à introduire une
obligation d’activité de 15 heures par semaine pour les allocataires, mais également à inscrire systématiquement les bénéficiaires à France Travail. Après un peu plus d’un an de test, les premiers résultats semblent encourageants, bien qu’ils ne concernent qu’une petite poignée de personnes sur près de 2 millions d’allocataires recensés en France.
Lors d’une
interview accordée à France Info le vendredi 25 octobre, Thibault Guilluy, directeur de France Travail, a salué les résultats de l’expérimentation, qui sera généralisée à partir du 1er janvier 2025. Il a rappelé que le RSA avait longtemps laissé les bénéficiaires dans une situation de marginalisation, plus de la moitié restant inscrits au dispositif pendant plus de quatre ans sans réel suivi. La réforme vise à briser cet isolement en instaurant un accompagnement intensif de 15 heures d’activité hebdomadaires minimum, "qui a déjà bénéficié à près de 55 000 personnes" indique le directeur de France Travail. "Parce qu'on apprend dans chaque territoire comment apporter le meilleur accompagnement à chacune de ces personnes (...) 92% sont très satisfaits de cet accompagnement.” précise Thibault Guilluy, ajoutant : “Les résultats sont là puisqu'
au bout de six mois, on est à 42% de retour à l'emploi. Au bout de douze mois, on enregistre même des taux de retour à l'emploi de 54%. Et cette sortie durable du RSA, c'est bon pour les personnes qui sortent de l'exclusion, c'est bon parce qu'on apporte des réponses très concrètes aussi aux entreprises qui ont des difficultés à recruter, et cela fait moins d'allocations à financer et plus de cotisants pour soutenir notre modèle social.” Cette réussite est donc le fruit d’une meilleure connaissance des bénéficiaires mais aussi d’une coopération accrue entre les acteurs locaux (départements, Etat, caisses d’allocations familiales, régies de transport, etc.).
Les associations expriment leurs préoccupations face au dispositif
La réforme du RSA suscite des inquiétudes quant à ses conséquences potentielles sur la précarité des ménages les plus vulnérables. Plusieurs associations, dont le Secours catholique, Aequitaz et ATD Quart-Monde, ont demandé la suspension de la réforme et formulé 4 alertes dans un
bilan des expérimentations publié le lundi 14 octobre.
Dans le bilan intitulé "Premier bilan des expérimentations RSA : 4 alertes pour répondre à l’inquiétude des allocataires”, le Secours catholique rapporte une
augmentation significative du non-recours au RSA dans les départements testant la réforme, où ce taux a crû de 10.8% en un an, contrairement aux autres départements, où il a diminué de 0.8%. Ce phénomène pourrait découler de l’alourdissement des conditions d’accès au RSA et du durcissement des sanctions, qui dissuaderaient certains bénéficiaires potentiels de faire une demande.
Les activités obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, non spécifiées dans la loi, suscitent des interrogations.
Il existe un risque que certaines de ces activités constituent un véritable travail, sans rémunération adéquate. Un exemple est donné dans le département de l’Eure, où le maire d’une commune envisage de confier l’entretien du cimetière, normalement pris en charge par des employés municipaux, à des allocataires du RSA, sans compensation financière. Ce type de pratique pourrait tirer le marché du travail vers le bas et créer une main-d'œuvre gratuite.
Le système repose sur un algorithme qui évalue la distance des allocataires à l’emploi à partir de leur dossier, ce qui détermine l’organisme de suivi (France Travail ou le département) ainsi que le parcours d’accompagnement et le nombre d’heures d’activité obligatoires. Cette automatisation pourrait réduire l’autonomie des bénéficiaires en limitant leur choix de parcours d’insertion et en ignorant des facteurs humains essentiels, tels que leur état psychologique. Le risque est de générer des parcours inadaptés, avec des exigences difficiles à respecter, pouvant mener jusqu’à des sanctions, voire la radiation.
La réforme semble orientée vers un retour à l’emploi rapide, notamment dans les métiers en tension, mais beaucoup d’allocataires ne sont pas en état de remplir ces emplois exigeants, souvent en raison de leur état de santé. Par ailleurs, les emplois retrouvés sont pour la plupart précaires, avec des contrats de moins de six mois, insuffisants pour ouvrir des droits au chômage, ce qui conduit souvent à un retour au RSA.
Les associations redoutent un piège de précarité, où les bénéficiaires se retrouveraient dans une boucle sans fin entre emploi de survie et aides sociales, et regrettent que l’objectif de retour à l’emploi prime sur la lutte contre la pauvreté.
Les associations espèrent ainsi que les pouvoirs publics entendront ces préoccupations et tiendront compte des conclusions du bilan d’expérimentation pour garantir que le RSA demeure un dispositif de soutien efficace, sans augmenter la précarité des personnes déjà en difficulté.

La CFTC se questionne sur 3 axes
Axe 1 : un accompagnement renforcé
Dans
un article publié sur son site internet le 4 septembre 2024, la CFTC a exprimé des préoccupations sur la nature de ces heures d'activité. Le syndicat craint que cette mesure se traduise par du travail gratuit au bénéfice des entreprises, au lieu de viser un véritable accompagnement vers l’emploi. Toutefois, l’expérimentation de ces 15 heures obligatoires, en cours dans 47 départements, semble répondre à ces préoccupations, comme l’indique Frédéric Belouze, responsable CFTC pour les questions d’emploi et de chômage : bien que la CFTC ne s’opposait pas à l’idée d’un test, elle insistait sur la nécessité que cette obligation soit avant tout un renforcement des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle. Après plusieurs mois de mise en place,
les activités obligatoires se concentrent principalement sur l’accompagnement : les bénéficiaires du RSA participent à des formations, des ateliers ou des salons professionnels, ce qui les prépare mieux à leur retour à l’emploi.
De plus, les 15 heures d’activité sont appliquées de manière adaptable aux spécificités de chaque territoire et aux besoins individuels des bénéficiaires. Selon Sylvie Amblot, présidente de la CFTC Emploi, ce nombre d’heures ne doit pas être interprété littéralement comme une obligation fixe, mais comme un système flexible de forfait. Par exemple, répondre à une offre d’emploi peut valider trois heures d’activité. En fonction de l’employabilité de l’allocataire et des choix de chaque département, l’objectif de 15 heures est modulable, permettant une application plus souple selon les profils. Ainsi, tous les allocataires ne sont pas automatiquement contraints d’accomplir 15 heures d’activité par semaine, mais sont encouragés à progresser vers cet objectif en fonction de leur situation.
Axe 2 : le financement sera-t-il à la hauteur ?
Si la nature des heures d’activité obligatoires, établies pour encourager le retour à l’emploi, a été clarifiée et sécurisée par la CFTC, des questions subsistent quant à la faisabilité d’une généralisation réussie au 1er janvier 2025.
Les chiffres avancés par France Travail (environ 42% des 28 000 allocataires du RSA entrés dans ces parcours de retour à l’emploi dans les premiers territoires expérimentaux ont pu retrouver un poste entre le printemps 2023 et avril 2024) sont certes prometteurs, toutefois, ces résultats ont été rendus possibles grâce à un renforcement conséquent des moyens financiers et humains dans les départements pilotes, permettant aux allocataires d’être suivis de manière intensive et plus personnalisée. Comme le souligne Sylvie Amblot, présidente de la CFTC Emploi, les conseillers chargés d’accompagner ces allocataires dans ces territoires expérimentaux étaient principalement des salariés de France Travail en CDI, tandis que des fonds supplémentaires permettaient de recruter des CDD pour suivre les autres demandeurs d’emploi. "On verra ce qui sera inscrit au prochain projet de loi de finances, mais on sait qu’il est prévu de soustraire plusieurs millions d’euros de budget à France Travail.”poursuit Sylvie Amblot. Selon elle, la suppression de plusieurs millions d’euros du budget de France Travail pourrait limiter la possibilité d’embaucher en CDD, compromettant ainsi l’accompagnement intensif qui a été la clé des succès observés jusqu’ici.
En outre, cette mise en place a également généré des inégalités de suivi entre les bénéficiaires du RSA et les autres catégories de demandeurs d’emploi. Dans les départements expérimentaux, les conseillers France Travail s’occupant des allocataires du RSA ont vu leurs portefeuilles réduits à 50-70 personnes, ce qui leur permet d’offrir un suivi de qualité. En revanche, les conseillers des autres demandeurs d’emploi - notamment les chômeurs de longue durée ou les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique - doivent encore gérer des portefeuilles de 200 à 400 personnes. Cette situation crée, selon Sylvie Amblot, un "effet de vases communicants" qui met en lumière une difficulté fondamentale de la réforme : si elle cible efficacement les allocataires du RSA, elle ne répond pas aux besoins des autres catégories de demandeurs d’emploi, qui risquent d’être mis de côté en raison de la redistribution des moyens.
Axe 3 : des différences marquées selon les territoires
La CFTC a bien saisi que l’expérimentation d’un accompagnement harmonisé pour les demandeurs d’emploi vise à renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l’insertion, de la formation et de l’emploi, tels que les missions locales, les associations, ainsi que les conseils départementaux et régionaux. Les antennes locales de France Travail dépendent souvent des décisions des conseils départementaux concernant l'orientation des allocataires du RSA. Sylvie Amblot indique que, dans des départements comme le Nord, la coopération entre acteurs est très efficace. Cependant, la gestion des parcours sociaux varie considérablement d'un département à l'autre. Par exemple, le département de la Somme se concentre principalement sur les personnes proches du retour à l'emploi, tandis que d'autres, ayant des freins importants (comme des problèmes de logement, de santé ou d'addictions), sont redirigées vers France Travail, dont les conseillers ne sont pas nécessairement formés pour traiter ces problématiques sociales.
Pour Frédéric Belouze, les imperfections de cette expérimentation ne constituent pas forcément des obstacles insurmontables, bien que la généralisation du dispositif au 1er janvier 2025 puisse lui sembler un peu trop hâtive : "Je pense qu’il nous faudrait notamment un retour d’expérience des bénéficiaires du RSA, pour mieux jauger l’ensemble et corriger ce qui doit l’être. A mon sens, il aurait fallu continuer d’expérimenter, avant d’éventuellement globaliser ce procédé.” affirme t-il. "Ainsi que des moyens budgétaires à la hauteur des ambitions d’une réforme qui a semble-t-il ses mérites, comme ses limites.", conclut l’article de la CFTC.

 © Canva
© Canva