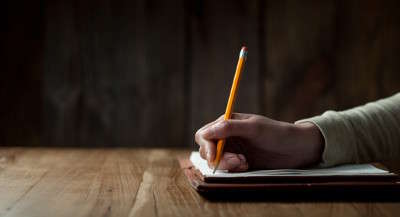La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) a publié le jeudi 17 octobre 2024 une étude qui analyse l'impact d'une augmentation salariale sur le revenu disponible d'un salarié du secteur privé. Elle met en évidence l'influence des prélèvements sociaux, fiscaux, ainsi que des prestations sociales sur cette augmentation. L'étude montre que, pour une personne seule, salariée au Smic à temps plein et locataire, il est nécessaire d'augmenter le coût du travail de 442€ pour que son revenu disponible augmente de 100€. Cela s'explique par la hausse des cotisations sociales, en partie due à la réduction des allégements de cotisations, et par le fait que la hausse du salaire net doit dépasser 100€ du fait que la prime d’activité diminue.
Publié le 23 octobre 2024 18:46 © Canva
© CanvaActualités du secteur
Un employeur doit débourser 442€ pour augmenter de 100€ le revenu disponible d’un salarié au Smic
Mis à jour le 28 août 2025 14:51
Sommaire
Coût du travail et revenu disponible : quelle différence ?Mieux comprendre sa fiche de paie : un barème pour financer la protection sociale et alléger le coût du travail
En 2024 : pour 100€ de revenu disponible en plus, 442€ de superbrut sont nécessaires pour un salarié au Smic
Les différences selon la situation familiale
Partager cet article
Coût du travail et revenu disponible : quelle différence ?
Quand le salaire d'un salarié augmente, le coût du travail pour l'employeur et le revenu disponible du salarié augmentent également, mais ces hausses sont souvent très différentes. Cela s'explique par la différence entre ce que l’employeur paie (appelé salaire "superbrut") et ce que le salarié reçoit réellement (le revenu disponible).
Cette différence, appelée "coin socio-fiscal", comprend :
Cette différence, appelée "coin socio-fiscal", comprend :
- Les prélèvements sociaux : les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu.
- Les prestations sociales : comme le RSA, les aides au logement, la prime d’activité et les allocations familiales. Ces aides diminuent lorsque les revenus augmentent, ce qui réduit l’écart entre le coût du travail et le revenu disponible.
Ainsi, lorsqu’un salarié voit son salaire ou ses heures de travail augmenter, son revenu disponible (ce qu’il peut dépenser) ne grimpe pas autant que le coût du travail pour l'employeur. C’est parce que la hausse de salaire entraîne des prélèvements plus élevés et une réduction des aides sociales. L’étude menée par la DREES compare différents cas pour illustrer ces effets.
Mieux comprendre sa fiche de paie : un barème pour financer la protection sociale et alléger le coût du travail
Les cotisations et contributions sociales financent les différentes branches de la Sécurité sociale (maladie, retraite, famille, chômage, etc.). Elles sont prélevées directement sur le salaire, et le salarié reçoit son salaire net après déduction de ces cotisations. En échange, ces cotisations donnent droit à des prestations, comme des indemnités en cas de chômage ou une pension de retraite.
L'employeur calcule et déclare les cotisations sociales pour chacun de ses salariés, soit auprès de l'Urssaf, soit de la Mutualité sociale agricole (MSA pour le secteur agricole). Ces cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié.
Les prélèvements sociaux sont proportionnels aux revenus, mais certains allègements existent pour réduire le coût du travail, notamment pour les bas salaires. Ces allègements, en place depuis 1993, visent à encourager l'emploi des personnes moins qualifiées en réduisant les cotisations de l’employeur pour les salaires inférieurs à 1.6 fois le Smic (soit environ 2 827€ brut à plein temps au 1er juillet 2024).
Depuis 2019, deux dispositifs réduisent également les cotisations sociales pour des salaires plus élevés :
L'employeur calcule et déclare les cotisations sociales pour chacun de ses salariés, soit auprès de l'Urssaf, soit de la Mutualité sociale agricole (MSA pour le secteur agricole). Ces cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié.
Les prélèvements sociaux sont proportionnels aux revenus, mais certains allègements existent pour réduire le coût du travail, notamment pour les bas salaires. Ces allègements, en place depuis 1993, visent à encourager l'emploi des personnes moins qualifiées en réduisant les cotisations de l’employeur pour les salaires inférieurs à 1.6 fois le Smic (soit environ 2 827€ brut à plein temps au 1er juillet 2024).
Depuis 2019, deux dispositifs réduisent également les cotisations sociales pour des salaires plus élevés :
- Une baisse de 1.8 point des cotisations pour les salaires inférieurs à 3.5 fois le Smic ;
- Une réduction de 6 points des cotisations employeur pour l’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2.5 fois le Smic.
Au final, pour un salaire au Smic, ces allègements réduisent considérablement les prélèvements, avec un taux de cotisations sociales effectif de seulement 4.8% du salaire brut pour l'employeur.
En 2024 : pour 100€ de revenu disponible en plus, 442€ de superbrut sont nécessaires pour un salarié au Smic
Pour augmenter le revenu disponible d'un ménage de 100€, le coût du travail doit augmenter bien plus que cette somme, à cause des cotisations sociales et des impôts. Le montant exact dépend du niveau de salaire et de la situation familiale. Plus l'augmentation du revenu disponible est proche de 100€, plus le gain est effectif pour le salarié.
Sans réduction des aides sociales ou augmentation des cotisations et impôts, une hausse de 100€ du coût du travail se traduirait par une augmentation équivalente du revenu disponible. Cependant, pour un salarié célibataire sans enfant au Smic à plein temps en juillet 2024, le coût du travail doit augmenter de 442€ pour que son revenu disponible augmente de 100€. Cette somme inclut la hausse des cotisations patronales (+212€), des cotisations salariales (+48€), des impôts (+12€), et la baisse de la prime d’activité (-71€). Cela représente 25% de son salaire brut, soit près de 4.5 fois la hausse de revenu souhaitée.
Dans le cas d'une personne seule sans enfant travaillant à mi-temps au Smic, pour gagner 100€ de revenu disponible en travaillant plus d'heures, l'employeur doit augmenter son coût du travail de 249€, faisant passer son salaire de 914 à 1 162€ par mois. Si cette augmentation provient uniquement d'une hausse du salaire horaire, l'employeur devrait débourser 455€ supplémentaires, car la hausse du salaire horaire abaisserait le taux des allègements généraux et majorerait donc les cotisations sociales.
Pour les salaires au-dessus de 1.6 du Smic, les aides sociales et les réductions de cotisations n’ont plus d’effet, ce qui fait que l'augmentation du coût du travail pour gagner 100€ de revenu disponible est beaucoup plus faible. Par exemple, pour un salarié à 2 Smic, cette hausse ne représente que 7% du salaire brut (contre 25% pour un salarié au Smic).
Sans réduction des aides sociales ou augmentation des cotisations et impôts, une hausse de 100€ du coût du travail se traduirait par une augmentation équivalente du revenu disponible. Cependant, pour un salarié célibataire sans enfant au Smic à plein temps en juillet 2024, le coût du travail doit augmenter de 442€ pour que son revenu disponible augmente de 100€. Cette somme inclut la hausse des cotisations patronales (+212€), des cotisations salariales (+48€), des impôts (+12€), et la baisse de la prime d’activité (-71€). Cela représente 25% de son salaire brut, soit près de 4.5 fois la hausse de revenu souhaitée.
Dans le cas d'une personne seule sans enfant travaillant à mi-temps au Smic, pour gagner 100€ de revenu disponible en travaillant plus d'heures, l'employeur doit augmenter son coût du travail de 249€, faisant passer son salaire de 914 à 1 162€ par mois. Si cette augmentation provient uniquement d'une hausse du salaire horaire, l'employeur devrait débourser 455€ supplémentaires, car la hausse du salaire horaire abaisserait le taux des allègements généraux et majorerait donc les cotisations sociales.
Pour les salaires au-dessus de 1.6 du Smic, les aides sociales et les réductions de cotisations n’ont plus d’effet, ce qui fait que l'augmentation du coût du travail pour gagner 100€ de revenu disponible est beaucoup plus faible. Par exemple, pour un salarié à 2 Smic, cette hausse ne représente que 7% du salaire brut (contre 25% pour un salarié au Smic).
Les différences selon la situation familiale
Une hausse de salaire augmente le revenu disponible, seulement l'importance de cette augmentation dépend aussi de la situation familiale et du logement du salarié. Les salariés modestes qui sont locataires gagnent souvent moins que ceux qui sont propriétaires. Par exemple, pour une personne seule sans enfant, travaillant à mi-temps au Smic et étant locataire, il faut augmenter son temps de travail (de 50% à 63% d’un temps plein) pour que son revenu disponible augmente de 100€, ce qui coûte 249€ à l'employeur. Cette hausse réduit aussi les aides au logement. Si cette personne est propriétaire, elle n’a pas de baisse d’aide au logement, donc elle n’aura besoin d'augmenter son temps de travail que de 50% à 59%, et l'employeur ne devra débourser que 152€.
La situation familiale influe aussi sur le gain et le coût. Une famille monoparentale avec deux enfants, locataire, où le parent gagne un Smic, reçoit 213€ de prime d’activité et 294€ d’aide au logement, contre seulement 257€ de prime d’activité pour une personne seule. Pour chaque euro gagné, la prime d’activité baisse de 39 centimes, et les aides au logement diminuent de 34 centimes pour les familles monoparentales. Obtenir une augmentation de 100€ de revenu disponible pour ces familles nécessite une forte hausse de salaire, car il faut compenser la baisse des aides. Par exemple, pour une famille monoparentale, une hausse du coût du travail de 770€ (augmentation de 22% du salaire net) permet d'obtenir 100€ de revenu disponible, tandis que pour une personne seule au Smic, une augmentation de seulement 13% suffit pour atteindre le même résultat.
Pour un adulte vivant en couple avec deux enfants et payé au Smic, une augmentation de 23% du salaire est nécessaire pour gagner 100€ de plus si son conjoint ne travaille pas, mais seulement 12% si son conjoint travaille aussi à temps plein au Smic.
Ainsi, l'étude de la Drees montre que les augmentations de salaire ne se traduisent pas directement par une hausse équivalente du revenu disponible pour le salarié, en raison des prélèvements sociaux et fiscaux, ainsi que de la diminution des prestations sociales. Cela varie selon le niveau de salaire, la situation familiale et le logement du salarié.
Source : Drees - Etudes et Résultats - octobre 2024.
La situation familiale influe aussi sur le gain et le coût. Une famille monoparentale avec deux enfants, locataire, où le parent gagne un Smic, reçoit 213€ de prime d’activité et 294€ d’aide au logement, contre seulement 257€ de prime d’activité pour une personne seule. Pour chaque euro gagné, la prime d’activité baisse de 39 centimes, et les aides au logement diminuent de 34 centimes pour les familles monoparentales. Obtenir une augmentation de 100€ de revenu disponible pour ces familles nécessite une forte hausse de salaire, car il faut compenser la baisse des aides. Par exemple, pour une famille monoparentale, une hausse du coût du travail de 770€ (augmentation de 22% du salaire net) permet d'obtenir 100€ de revenu disponible, tandis que pour une personne seule au Smic, une augmentation de seulement 13% suffit pour atteindre le même résultat.
Pour un adulte vivant en couple avec deux enfants et payé au Smic, une augmentation de 23% du salaire est nécessaire pour gagner 100€ de plus si son conjoint ne travaille pas, mais seulement 12% si son conjoint travaille aussi à temps plein au Smic.
Ainsi, l'étude de la Drees montre que les augmentations de salaire ne se traduisent pas directement par une hausse équivalente du revenu disponible pour le salarié, en raison des prélèvements sociaux et fiscaux, ainsi que de la diminution des prestations sociales. Cela varie selon le niveau de salaire, la situation familiale et le logement du salarié.
Source : Drees - Etudes et Résultats - octobre 2024.
Partager cet article :
Commentaires
Il n'y a pas de commentaires pour le moment
Nos ressources pour les professionnels

Petite équipe, grand volume de candidatures : comment garder la qualité ?
Témoignage - Tout à Dom Services Saint-Genis-Laval
voir le témoignage
Comment développer sa clientèle rapidement et durablement ?
Témoignage - Melior Services
Voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros