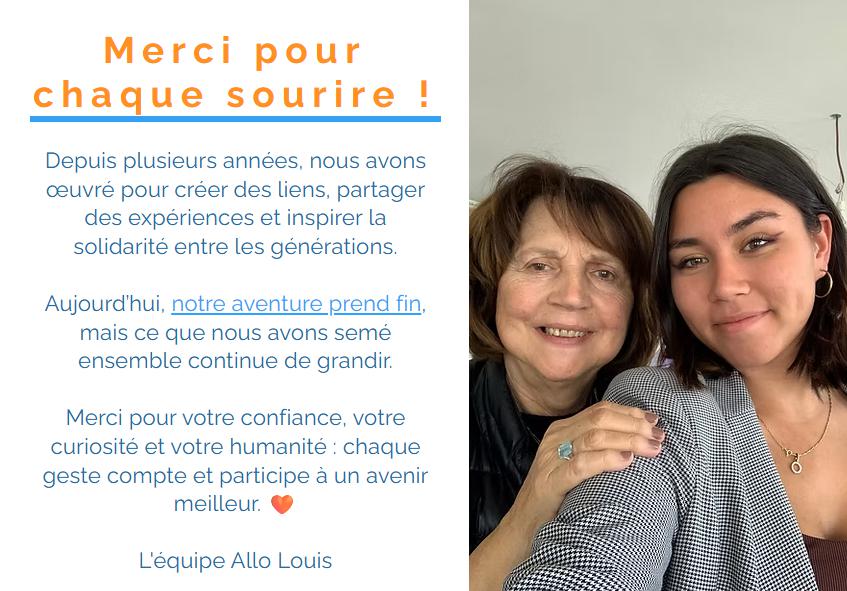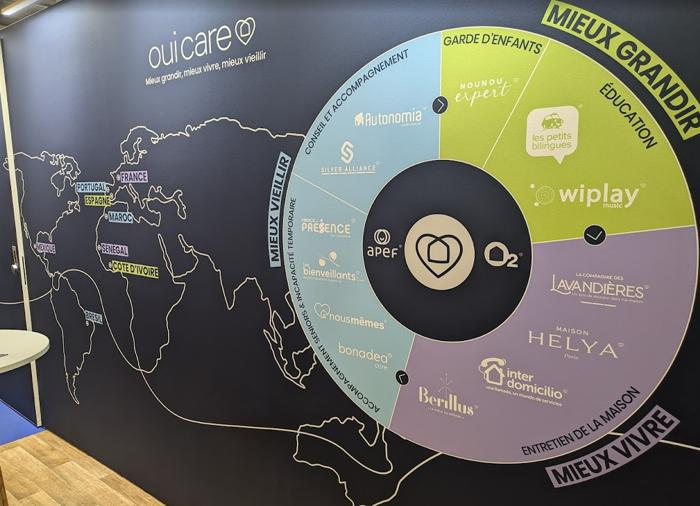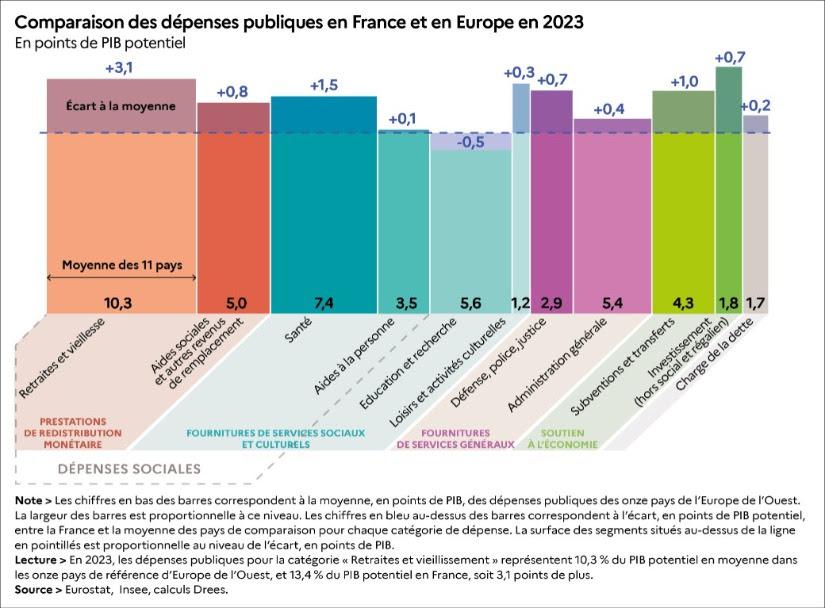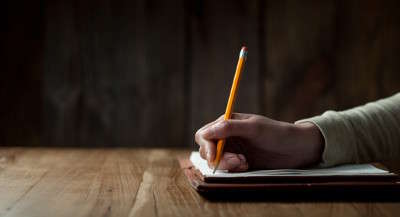L'Académie nationale de médecine a publié un rapport, adopté le 17 septembre 2024, qui résulte d’une analyse approfondie sur le niveau d’activité physique des enfants et adolescents français, incluant ceux en situation de handicap. Ce rapport met en évidence une insuffisance notable dans la pratique d'activités physiques, tandis que la sédentarité s'accroît dangereusement. En effet, seulement 20% des garçons et 10% des filles en situation de handicap respectent les recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en matière d’activité physique. En parallèle, la sédentarité devient un comportement de plus en plus préoccupant, les enfants passant en moyenne entre 3 heures et 4h30 par jour devant un écran, ce qui constitue un risque majeur pour leur santé.
Publié le 18 octobre 2024 18:03 © Canva
© CanvaActualités du secteur
Promouvoir l'activité physique à l'école : un enjeu de santé publique
Mis à jour le 28 août 2025 14:51
Sommaire
Etat des lieux : des adolescents trop sédentaires Le Covid-19 et ses conséquences sur l’activité physique et la sédentarité
La technologie de plus en plus omniprésente
Les conséquences de la sédentarité : surpoids et obésité
L’importance de l’EPS
Les programmes d’activité physique qui existent déjà
Le cas particulier des enfants et des adolescents en situation de handicap
Les 4 principales préconisations de l’Académie nationale de médecine
Partager cet article
Un récent rapport de l’UNESCO souligne que les deux-tiers des collégiens et lycéens, ainsi que plus de la moitié des élèves du primaire dans le monde, ne bénéficient pas du nombre minimal d’heures d’éducation physique. Ce constat est encore plus alarmant pour les élèves en situation de handicap, dont deux-tiers sont privés d'accès à cette éducation. Face à cette situation, la présidente de l'UNESCO a lancé un appel aux 194 États membres, les incitant à faire de l’éducation physique une priorité essentielle dans leurs politiques éducatives. Par ailleurs, dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le président de la République a décrété la promotion de l’activité physique et sportive comme la "Grande Cause Nationale 2024".
Etat des lieux : des adolescents trop sédentaires
Le rapport de l’Académie nationale de médecine alerte. En effet, parmi les 25 pays les plus riches, la France occupe le 22ème rang en matière d’activité physique des adolescents. Les données épidémiologiques les plus récentes en France proviennent d’enquêtes réalisées entre 2014 et 2016 (étude INCA-3 menée en 2014-2015 et étude ESTEBAN mise en place de 2014 à 2016). Les résultats de ces enquêtes montrent que 50.7% des garçons et seulement 33.3% des filles âgés de 6 à 17 ans atteignent les recommandations de 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée par jour. Le niveau d’activité physique spontanée diminue avec l’âge, avec en particulier une baisse franche au moment de la puberté. Si 70% des garçons et 56% des filles âgés de 6 à 10 ans atteignent les recommandations de l’OMS, seuls 40% des garçons et 16% des filles atteindront les recommandations à l’âge de 15 à 17 ans. L’augmentation de la prévalence de l’inactivité avec l’âge est plus importante chez les filles que chez les garçons.
Par ailleurs, le rapport ajoute que la proportion d’adolescents ayant de faibles niveaux d’activité physique est plus importante dans les établissements scolaires situés en zones défavorisées que dans ceux en zones mixtes, ou en zones favorisées (respectivement 41%, 21% et 19.5%). À l’inverse, le niveau d’activité physique d’intensité modérée à élevée est plus important dans les établissements favorisés.
L’enseignement de l’EPS constitue une part importante de l’activité physique des élèves. Interrogés dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques, approximativement 80% des enfants et adolescents déclarent avoir eu un cours d’EPS la semaine qui précède. La pratique sportive en club ou au sein d’une association est plus importante chez les jeunes dont le ou les parents ont un niveau scolaire élevé. Il a été estimé que 40% seulement des enfants âgés de 6 à 10 ans déclaraient utiliser un mode de transport actif (à pied, en vélo, trottinette, rollers) pour se déplacer du domicile familial à l’établissement scolaire (approximativement 35% des garçons et 45% des filles). Les déplacements actifs domicile-école sont majoritairement effectués à pied (37.6%) et très peu souvent à vélo (2.4%). Mais la majorité des déplacements vers les lieux d’enseignement (60%) sont effectués avec un moyen motorisé, dont 31.7% en voiture.
Par ailleurs, le rapport ajoute que la proportion d’adolescents ayant de faibles niveaux d’activité physique est plus importante dans les établissements scolaires situés en zones défavorisées que dans ceux en zones mixtes, ou en zones favorisées (respectivement 41%, 21% et 19.5%). À l’inverse, le niveau d’activité physique d’intensité modérée à élevée est plus important dans les établissements favorisés.
L’enseignement de l’EPS constitue une part importante de l’activité physique des élèves. Interrogés dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques, approximativement 80% des enfants et adolescents déclarent avoir eu un cours d’EPS la semaine qui précède. La pratique sportive en club ou au sein d’une association est plus importante chez les jeunes dont le ou les parents ont un niveau scolaire élevé. Il a été estimé que 40% seulement des enfants âgés de 6 à 10 ans déclaraient utiliser un mode de transport actif (à pied, en vélo, trottinette, rollers) pour se déplacer du domicile familial à l’établissement scolaire (approximativement 35% des garçons et 45% des filles). Les déplacements actifs domicile-école sont majoritairement effectués à pied (37.6%) et très peu souvent à vélo (2.4%). Mais la majorité des déplacements vers les lieux d’enseignement (60%) sont effectués avec un moyen motorisé, dont 31.7% en voiture.
Le Covid-19 et ses conséquences sur l’activité physique et la sédentarité
L’étude souligne que la pandémie de Covid-19 a indéniablement affecté la pratique de l’activité physique et les comportements sédentaires des enfants et adolescents. Pendant la pandémie, le niveau d’activité physique a considérablement diminué, tandis que l’isolement social a accru l’utilisation des outils numériques. Ces derniers sont devenus l’un des seuls moyens de communication, entraînant ainsi une augmentation significative du temps passé devant les écrans. L’augmentation de la sédentarité a été plus marquée chez les enfants que chez les adultes (+2 h 40 min par jour chez les enfants, en comparaison à +2 h 06 min chez les adultes).
Plus encore, la baisse de l’activité physique liée à la pandémie semble se prolonger après la période des restrictions, les enfants de 10-11 ans conservant un déficit de 13 minutes par jour des activités d’intensité modérée à élevée.
Il a aussi été observé une augmentation du temps quotidien passé en comportements sédentaires de 56% à 62% les jours de semaine, et de 48% à 56% pendant les weekends. Ceci est cohérent avec une autre étude ayant montré que chez des enfants de 8-11 ans, seuls 15% d’entre eux baissent leur temps de sédentarité un an après la pandémie de COVID, ce qui explique une augmentation de 50 mn du temps quotidien de sédentarité par rapport à la période pré-Covid.
Plus encore, la baisse de l’activité physique liée à la pandémie semble se prolonger après la période des restrictions, les enfants de 10-11 ans conservant un déficit de 13 minutes par jour des activités d’intensité modérée à élevée.
Il a aussi été observé une augmentation du temps quotidien passé en comportements sédentaires de 56% à 62% les jours de semaine, et de 48% à 56% pendant les weekends. Ceci est cohérent avec une autre étude ayant montré que chez des enfants de 8-11 ans, seuls 15% d’entre eux baissent leur temps de sédentarité un an après la pandémie de COVID, ce qui explique une augmentation de 50 mn du temps quotidien de sédentarité par rapport à la période pré-Covid.
La technologie de plus en plus omniprésente
Le rapport met en avant le fait que le temps passé devant un écran est considéré comme l'un des indicateurs principaux du comportement sédentaire. L'évolution rapide des technologies et l'omniprésence des médias numériques affectent la façon dont les enfants et les adolescents se divertissent. Ce qui fait qu’en moyenne, les enfants et les adolescents français passent 3 à 4 heures par jour devant un écran. Seuls 34.6% des enfants de 6-10 ans, 17% des 11-14 ans et 8.4% des 15-17 ans passent moins de 2 heures par jour devant un écran. Les deux tiers des adolescents de 13-15 ans regardent un écran de télévision plus de 2 heures par jour. Des données plus récentes du Centre National d’appui au Déploiement en Activité Physique et lutte contre la Sédentarité (CNDAPS) collectées de 2020 à 2021 sur 283 collégiens ont montré qu’en moyenne, les collégiens déclarent passer 4 h 27 min par jour devant un écran.
L’interprétation du temps passé devant un écran demeure cependant complexe, nuance le rapport de l’Académie nationale de médecine, car affectée par de nombreux facteurs confondants comme le contexte d’utilisation (enseignement, loisir, échanges sur les réseaux sociaux), le contenu (violence, jeux, contenu pédagogique), le comportement devant l’écran (actif ou passif), les facteurs socio-économiques, etc. De plus, l’usage des écrans évolue rapidement avec un passage des écrans de télévision aux ordinateurs personnels, puis aux jeux vidéos, et actuellement aux smartphones.
L’interprétation du temps passé devant un écran demeure cependant complexe, nuance le rapport de l’Académie nationale de médecine, car affectée par de nombreux facteurs confondants comme le contexte d’utilisation (enseignement, loisir, échanges sur les réseaux sociaux), le contenu (violence, jeux, contenu pédagogique), le comportement devant l’écran (actif ou passif), les facteurs socio-économiques, etc. De plus, l’usage des écrans évolue rapidement avec un passage des écrans de télévision aux ordinateurs personnels, puis aux jeux vidéos, et actuellement aux smartphones.
Les conséquences de la sédentarité : surpoids et obésité
Chez les enfants âgés de 4 à 12 ans, la prévalence du surpoids et de l’obésité est plus élevée chez les filles que chez les garçons. Le rapport affirme que l’inactivité physique et le temps passé en position sédentaire sont associés à un risque accru de surpoids, d’obésité et d’autres facteurs de risque cardio-métabolique. Chez les adolescents, il a été noté une altération de certains marqueurs de santé dont l’adiposité, dès 3-4 h par jour passées devant un écran pour des activités de loisir. Le rôle joué par le temps passé devant les écrans est important à prendre en compte chez les enfants car : 71% des élèves de 11 ans étant équipés d’un smartphone et 83% des élèves de 12 ans. En favorisant un environnement “obésogène” sans précédent, la pandémie de COVID-19 a aggravé la crise de l'obésité infantile, ce qui est déjà perceptible dans certains pays.
Même si le rôle des parents est fondamental, l’école et l’environnement périscolaire tiennent une place importante pour changer le comportement des enfants et adolescents.
Même si le rôle des parents est fondamental, l’école et l’environnement périscolaire tiennent une place importante pour changer le comportement des enfants et adolescents.
L’importance de l’EPS
Selon le rapport de l’Académie, l’EPS est un levier efficace pour sensibiliser les élèves à la pratique régulière d’une activité physique. Les horaires sont en moyenne de 3 heures hebdomadaires en école primaire et au collège, et de 2 heures au lycée. Il est cependant difficile d’évaluer la quantité et l’intensité de l’activité physique moyenne effectuée réellement lors des séances d’EPS. Une enquête réalisée par l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS) auprès de parents et d’enfants d’âge scolaire montre que l’EPS est considérée par les élèves comme une discipline attrayante, permettant de pratiquer du sport et de découvrir des activités physiques.
En toute logique, les capacités physiques individuelles sont un des déterminants du niveau de pratique spontanée d’activités physiques. Ainsi, les enfants qui ont les meilleurs niveaux de coordination motrice et les plus faibles valeurs d’IMC (donc de capacités physiques potentielles), maintiennent plus facilement bon niveau d’activité physique. Pour le rapport, ces données doivent être prises en considération dans les interventions en milieu scolaire, soulignant qu’une attention toute particulière devait être accordée aux enfants et adolescents aux valeurs élevées d’IMC, à ceux ayant les moins bonnes habilités et coordinations motrices, et ce tout particulièrement chez les jeunes filles.
En toute logique, les capacités physiques individuelles sont un des déterminants du niveau de pratique spontanée d’activités physiques. Ainsi, les enfants qui ont les meilleurs niveaux de coordination motrice et les plus faibles valeurs d’IMC (donc de capacités physiques potentielles), maintiennent plus facilement bon niveau d’activité physique. Pour le rapport, ces données doivent être prises en considération dans les interventions en milieu scolaire, soulignant qu’une attention toute particulière devait être accordée aux enfants et adolescents aux valeurs élevées d’IMC, à ceux ayant les moins bonnes habilités et coordinations motrices, et ce tout particulièrement chez les jeunes filles.
Les programmes d’activité physique qui existent déjà
En cette année olympique, le rapport rappelle que différents programmes ont été mis en place dans les établissements à savoir :- A l’école, 30 minutes d’activités physiques quotidiennes doivent être pratiquées en complément des 3 heures de cours d’EPS obligatoires dans les collèges. Les jours où les élèves ne bénéficient pas de ces cours d’EPS, les professeurs des écoles doivent trouver les moyens d’amener leurs élèves à avoir une activité corporelle de 30 minutes. Cependant, de nombreux établissements scolaires ne se sont pas encore emparés de cette mesure gouvernementale. Les raisons invoquées sont multiples, dont le manque de moyens matériels ou de formation.
- La Journée nationale du sport scolaire : la promotion du sport dans les établissements scolaires du premier et du second degré se fait aussi grâce à la Journée nationale du sport scolaire dont l’objectif principal est de faire connaître et de promouvoir les activités organisées par les fédérations sportives scolaires (USEP, UNSS et UGSEL).
- Savoir rouler à vélo : le savoir rouler à vélo est un programme d’apprentissage du vélo qui s’adresse aux enfants de 6-11 ans. L’intention est double, éduquer les jeunes à la sécurité routière d’une part et les sensibiliser aux déplacements actifs d’autre part. Il s’intègre parfaitement dans la politique de promotion de l’activité physique chez les jeunes.
- Savoir-nager en sécurité : dans cette même logique sécuritaire, l’Education nationale met en avant le savoir-nager en sécurité avec un parcours de progression de l’école au lycée. La fédération française de natation participe à atteindre cet objectif.
Il ne fait aucun doute, comme le souligne le rapport, que promouvoir l’activité physique chez les jeunes a des effets bénéfiques sur la réussite scolaire et le développement cognitif. L’amélioration des performances scolaires se manifeste notamment dans la lecture, l’expression orale et les mathématiques, et elle est principalement médiée par une meilleure mémoire de travail, un contrôle inhibiteur accru et une flexibilité cognitive. Bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour clarifier les mécanismes qui expliquent les liens entre l’activité physique et les performances scolaires, les conclusions des récentes méta-analyses justifient pleinement l’instauration d’une politique proactive pour développer l’EPS et le sport à l’école.
Pour en savoir plus sur les mesures qui ont été prises pour favoriser le sport à l’école, rendez-vous sur le site du ministère de l’Education nationale.
Le cas particulier des enfants et des adolescents en situation de handicap
Le rapport révèle qu’en France en 2020, on estimait que 450 000 Enfants ou Adolescents étaient en Situation de Handicap (EASH), soit approximativement 3.7% de la population de cette tranche d’âge. Chez les enfants et adolescents en situation de handicap, seuls 16% à 22% des garçons de 11 à 15 ans et 7 à 13.7% des filles atteignent les recommandations émises par l’OMS.
Dans les faits, les EASH sont souvent exclus d’activités physiques organisées en milieu scolaire ou extra-scolaire pour des raisons d’accessibilité, ce qui contribue à expliquer leurs faibles niveaux d’activité physique. En 2020, 4 000 EASH de 1 à 19 ans étaient licenciés dans un club de la fédération française de handisport, et 11 000 étaient licenciés dans un club affilié à la fédération française de sport adapté. Ce sont donc 3% seulement des EASH qui pratiquent un sport dans un environnement spécialisé.
Les Enfants ou Adolescents en Situation de Handicap (EASH) sont donc à haut risque de sédentarité avec en particulier un temps important passé devant des écrans. Bien que les activités sur écran offrent la possibilité aux jeunes adolescents handicapés de se sentir moins isolés, leur utilisation excessive peut avoir des conséquences négatives sur leur santé mentale. Chez les EASH, les temps moyens passés devant les différents types d’écran sont supérieurs à ceux des enfants et adolescents sans handicap de la même classe d’âge. En moyenne, les garçons passent 6.37 heures / jour devant un écran les jours de semaine (contre 5.63 heures chez les filles).
Pourtant relève l’étude, chez ces enfants et adolescents, la pratique de l’activité physique est reconnue pour avoir de nombreux effets positifs sur la santé physique, cognitive et mentale, c’est pourquoi promouvoir l’activité physique est un objectif de première importance. Les recommandations actuelles reposent sur 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue, associées à des exercices de renforcement musculaire au moins 3 jours par semaine.
Dans les faits, les EASH sont souvent exclus d’activités physiques organisées en milieu scolaire ou extra-scolaire pour des raisons d’accessibilité, ce qui contribue à expliquer leurs faibles niveaux d’activité physique. En 2020, 4 000 EASH de 1 à 19 ans étaient licenciés dans un club de la fédération française de handisport, et 11 000 étaient licenciés dans un club affilié à la fédération française de sport adapté. Ce sont donc 3% seulement des EASH qui pratiquent un sport dans un environnement spécialisé.
Les Enfants ou Adolescents en Situation de Handicap (EASH) sont donc à haut risque de sédentarité avec en particulier un temps important passé devant des écrans. Bien que les activités sur écran offrent la possibilité aux jeunes adolescents handicapés de se sentir moins isolés, leur utilisation excessive peut avoir des conséquences négatives sur leur santé mentale. Chez les EASH, les temps moyens passés devant les différents types d’écran sont supérieurs à ceux des enfants et adolescents sans handicap de la même classe d’âge. En moyenne, les garçons passent 6.37 heures / jour devant un écran les jours de semaine (contre 5.63 heures chez les filles).
Pourtant relève l’étude, chez ces enfants et adolescents, la pratique de l’activité physique est reconnue pour avoir de nombreux effets positifs sur la santé physique, cognitive et mentale, c’est pourquoi promouvoir l’activité physique est un objectif de première importance. Les recommandations actuelles reposent sur 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue, associées à des exercices de renforcement musculaire au moins 3 jours par semaine.
Les 4 principales préconisations de l’Académie nationale de médecine
Il convient de rappeler le rôle fondamental des parents dans l’éducation à la santé, en particulier pour encourager les enfants et les adolescents à être plus actifs et à réduire leur sédentarité. Par ailleurs, le rapport propose plusieurs recommandations à mettre en œuvre dans les établissements scolaires, dans le cadre périscolaire et pour les trajets entre le domicile et l’école :
1. Pérenniser des mesures déjà mises en place : toutes les mesures qui renforcent la place de l’EPS à l’école (30 minutes d’activités physiques quotidiennes), favorisent les déplacements actifs (savoir rouler à vélo), incitent à la pratique du sport (savoir nager en sécurité, dispositif Pass’Sport qui permet de lisser les inégalités socio-économiques d’accès aux clubs sportifs), doivent absolument être pérennisées.
2. Faire plus pour renforcer la place de l’EPS et du sport extra-scolaire : il est recommandé d’augmenter à 4h le volume hebdomadaire de l’EPS dans tous les établissements, d’encourager la participation de tous, surtout des jeunes filles, enfants et adolescents en surpoids ou obèses, et des élèves ayant les moins bonnes habilités motrices.
Tout en préservant les préférences des élèves, inciter à la pratique de sports qui développent la réactivité et les fonctions cognitives exécutives, comme les sports collectifs ou les arts martiaux.
3. Innover pour rendre les élèves plus actifs et moins sédentaires en : limitant les comportements sédentaires à l’école, cela passe par la réduction du temps passé en position assise pendant les cours ; intégrant des exercices et des activités physiques ludiques de groupe pendant les récréations et les pauses repas ; sensibilisant tous les enseignants à l’importance de l’activité physique pour la santé et la réussite scolaire, ainsi qu’à la réduction des comportements de sédentarité ; développant le transport actif vers et au retour de l’école. Pour ce faire : proposer des itinéraires de déplacements actifs sûrs, et les signaler ; améliorer l’accessibilité à pied et à vélo des établissements scolaires et périscolaires ; organiser avec la participation active des parents des “bus scolaires” pédestres (pédibus) ou à vélo (vélibus).
1. Pérenniser des mesures déjà mises en place : toutes les mesures qui renforcent la place de l’EPS à l’école (30 minutes d’activités physiques quotidiennes), favorisent les déplacements actifs (savoir rouler à vélo), incitent à la pratique du sport (savoir nager en sécurité, dispositif Pass’Sport qui permet de lisser les inégalités socio-économiques d’accès aux clubs sportifs), doivent absolument être pérennisées.
2. Faire plus pour renforcer la place de l’EPS et du sport extra-scolaire : il est recommandé d’augmenter à 4h le volume hebdomadaire de l’EPS dans tous les établissements, d’encourager la participation de tous, surtout des jeunes filles, enfants et adolescents en surpoids ou obèses, et des élèves ayant les moins bonnes habilités motrices.
Tout en préservant les préférences des élèves, inciter à la pratique de sports qui développent la réactivité et les fonctions cognitives exécutives, comme les sports collectifs ou les arts martiaux.
3. Innover pour rendre les élèves plus actifs et moins sédentaires en : limitant les comportements sédentaires à l’école, cela passe par la réduction du temps passé en position assise pendant les cours ; intégrant des exercices et des activités physiques ludiques de groupe pendant les récréations et les pauses repas ; sensibilisant tous les enseignants à l’importance de l’activité physique pour la santé et la réussite scolaire, ainsi qu’à la réduction des comportements de sédentarité ; développant le transport actif vers et au retour de l’école. Pour ce faire : proposer des itinéraires de déplacements actifs sûrs, et les signaler ; améliorer l’accessibilité à pied et à vélo des établissements scolaires et périscolaires ; organiser avec la participation active des parents des “bus scolaires” pédestres (pédibus) ou à vélo (vélibus).
4. Recommandations destinées plus particulièrement aux enfants et adolescents en situation de handicap : il s’agit de soutenir les activités physiques adaptées pour les EASH dans le contexte scolaire et sportif en augmentant les ressources en personnel formé et en équipements adaptés, accessibles aux enfants handicapés. Les activités proposées doivent être inclusives (tenant compte des besoins et des capacités physiques, motrices et cognitives individuelles) et répondre aux intérêts des élèves aux capacités physiques altérées.
Source : Rapport de l’Académie nationale de médecine : Améliorer la pratique des activités physiques, du sport et réduire la sédentarité à l’École, un enjeu de Santé Publique.
Partager cet article :
Commentaires
Il n'y a pas de commentaires pour le moment
Nos ressources pour les professionnels

Recrutement : Comment recruter des profils ciblés ?
Témoignage - Les 3 Forêts
Voir le témoignage
EHPAD : Comment faire face aux problématiques de recrutement ?
Témoignage - EHPAD Résidence L'Adagio
Voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros