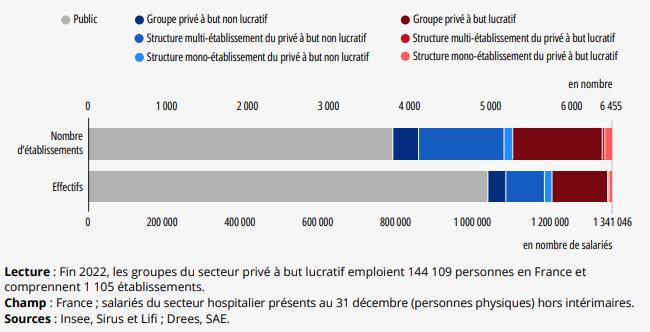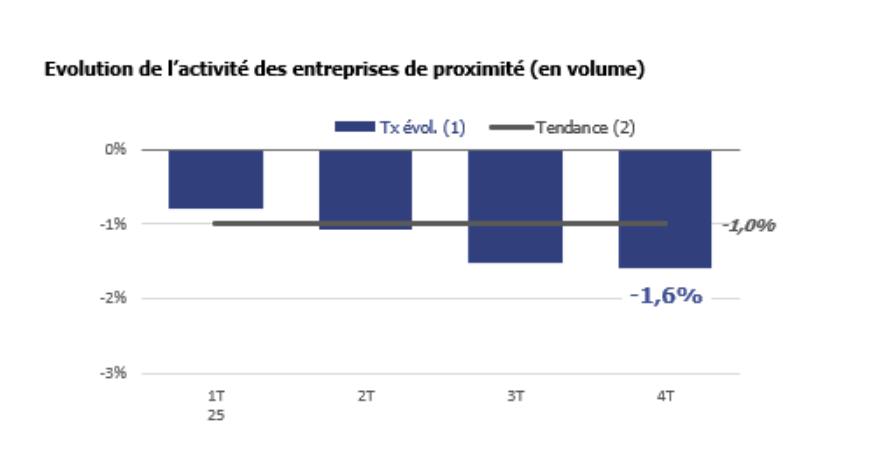Dans un contexte de vieillissement de la population et de soutien accru au maintien à domicile, les besoins d’aide vont fortement augmenter dans les années à venir. Cette aide repose largement sur les proches des personnes en perte d’autonomie, avec des répercussions significatives sur leur vie. L’étude de la Drees met l'accent sur les effets sur leur santé, en s'appuyant sur l'enquête Vie quotidienne et santé (VQS) réalisée par l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) en 2014, ainsi que sur les enquêtes CARE-Ménages menées par la Drees en 2015, auprès des personnes de 60 ans ou plus vivant à domicile.
Vieillir à domicile : une volonté de plus en plus prégnante des seniors
En préambule,
l’étude de la Drees souligne que la société française connaît une augmentation rapide du nombre de personnes âgées, liée au vieillissement des générations nombreuses du baby-boom. Elle insiste sur le fait que les politiques publiques actuelles, en France comme à l'échelle internationale, visent à respecter la volonté des personnes âgées en perte d’autonomie concernant leur lieu de prise en charge, en favorisant une démarche de désinstitutionnalisation. Ce mouvement, appelé
"virage domiciliaire”, a pour objectif à la fois de réduire les coûts de prise en charge et de permettre un libre choix aux individus. Cependant, cela implique de faire reposer une part significative de la responsabilité de l’aide sur les proches, qui deviennent des aidants.
Dans le même temps, les aidants sont devenus une priorité pour les politiques publiques. Ils bénéficient d'une reconnaissance croissante de la part de l'Etat, illustrée par les différentes stratégies nationales “Agir pour les aidants”. Il est donc essentiel de comprendre les répercussions que l’aide à un proche peut avoir sur les aidants eux-mêmes. Les recherches en sciences sociales ont notamment mis en évidence deux conséquences majeures : l’impact sur l’activité professionnelle des aidants et sur leur santé.
Des aidants sous pression
L’étude de la Drees révèle qu’un grand nombre d’aidants sont exposés à des niveaux élevés de stress et de fatigue. Qu’ils apportent un soutien pour les tâches ménagères, l’hygiène quotidienne, ou encore pour la gestion des soins médicaux, ces aidants se retrouvent souvent confrontés à des journées harassantes, avec peu de répit.
Selon l'enquête CARE-Ménages, parmi les 3.9 millions de personnes qui aident un proche de 60 ans ou plus à son domicile, 47% (près de la moitié) de ces proches aidants déclarent au moins une conséquence de l’aide apportée sur leur santé : 19% déclarent au moins une conséquence sur leur santé physique (fatigue physique, trouble du sommeil, problème de dos ou palpitations) et 37% déclarent au moins une conséquence sur leur santé mentale (fatigue morale, solitude, se sentir dépressif, anxieux).
Les aidants déclarent plus de conséquences si le lien avec la personne aidée est proche (conjoints ou enfants), si la personne aidée a des troubles cognitifs et s’ils cohabitent avec elle. Plus de conséquences sont également citées par les aidants qui effectuent des tâches variées auprès du senior et qui ont l’impression de faire des sacrifices, de manquer de temps, de répit et de formation. Enfin, les femmes déclarent plus de conséquences sur leur santé, en particulier les conjointes et, dans une moindre mesure, les filles aidantes.

Les aidants seniors se déclarent en meilleur état de santé que les personnes qui n’aident pas…
Pour apprécier si les proches aidants sont en moins bonne santé que les non-aidants, la Drees a utilisé l’enquête VQS menée par l’Insee en 20214, qui permet de distinguer, au sein des personnes âgées de 60 ans ou plus, celles qui déclarent aider régulièrement une personne de leur entourage pour les tâches de la vie quotidienne. Il apparaît que les seniors aidants (âgés de 60 ans ou plus) se déclarent en moyenne en meilleure santé que les autres personnes de même âge et du même genre. Ainsi, 8% se déclarent en mauvaise ou en très mauvaise santé, contre 14 % des autres seniors, soit au total 6 points d’écart.
Ce paradoxe apparent pourrait s’expliquer par un effet de comparaison avec la personne aidée, mais aussi et surtout par un effet de sélection : les personnes en bonne santé sont plus susceptibles d’aider.
… Mais les seniors qui cohabitent avec une personne en perte d’autonomie ont une santé plus dégradée
L’étude s’est intéressée aux personnes de 60 ans ou plus qui cohabitent avec une personne en perte d’autonomie. D’après la Drees, les seniors qui cohabitent avec une personne en perte d’autonomie, qu’ils déclarent ou non l’aider, ont deux fois plus de chance de se déclarer en mauvaise ou en très mauvaise santé que les autres seniors (24% contre 12%). Cet écart demeure lorsqu’on les compare aux non-aidants du même âge et genre (- 9 points). Les seniors qui cohabitent avec une personne en perte d’autonomie ont également des scores de santé mentale nettement inférieurs à ceux des autres seniors et ils consomment davantage de médicaments psychotropes.
Ainsi, l’enquête relève que 35% des seniors qui cohabitent avec une personne en perte d’autonomie pourraient présenter des syndromes dépressifs et 39% d’entre eux ont consommé au moins une fois un médicament anxiolytique ou antidépresseur dans l’année. Les autres seniors ne sont que 14% à être à risque de syndromes dépressifs et 27% à consommer des médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques.
En tenant compte de l’âge et du genre, on constate que cohabiter avec une personne en perte d’autonomie est associé à un risque de symptômes dépressifs deux fois plus élevé et à une probabilité d’environ un tiers plus élevée de consommer au moins un antidépresseur ou anxiolytique pour les personnes de 60 ans ou plus. Selon la Drees, ces résultats ne permettent pas d’établir de lien de cause à effet à proprement parler, mais ils suggèrent qu’avoir un proche en perte d’autonomie non seulement pourrait affecter la santé des aidants, mais aussi celle de tous ceux qui vivent avec elle, quand bien même ils ne déclarent pas lui apporter d’aide.
Aider un proche pèse davantage sur la santé des femmes que celle des hommes
L’aide semble avoir des répercussions plus négatives sur la santé des femmes que sur celle des hommes. Les analyses de la Drees révèlent que les femmes déclarent en moyenne un nombre significativement plus élevé de conséquences négatives sur leur santé en raison de l’aide qu’elles apportent à un senior en perte d’autonomie, comparativement aux hommes aidants.
De plus, le fait d’aider semble même être associé à un meilleur état de santé pour les hommes, selon certains indicateurs de santé. Les experts de la Drees n'ont pas encore trouvé d'explication claire à ce phénomène, affirmant : “Nous explorons diverses hypothèses pour expliquer ces différences de genre (nature de l'aide fournie, plus grande difficulté à concilier aide et tâches domestiques, biais de déclaration), mais aucune ne semble convaincante pour le moment.”
Renforcer les structures de soutien aux aidants
Si de nombreuses initiatives publiques ont été lancées pour améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie, la reconnaissance et l’accompagnement des aidants demeurent encore insuffisants. Beaucoup d'entre eux ignorent encore l’existence d’aides financières, de dispositifs de répit ou de formations spécialisées pour les aider dans leur rôle. Cette méconnaissance ou difficulté d'accès à ces dispositifs contribue à l'isolement des aidants, ce qui les rend plus vulnérables face aux conséquences de leur engagement.
Malgré les efforts déployés pour améliorer la condition des aidants, il est essentiel d'élargir et de renforcer les dispositifs de soutien. Le développement des services d’aide à domicile, comme les Services Autonomie à Domicile (SAD), permettrait de réduire la charge quotidienne des aidants en offrant une aide professionnelle plus accessible. Le
baluchonnage, une pratique venue du Canada, qui propose un relais de plusieurs jours à domicile pour permettre à l'aidant de souffler, pourrait également être étendu en France. Les
structures de répit, telles que les
haltes relais France Alzheimer ou les séjours temporaires en
maison de retraite, devraient être multipliées et rendues plus accessibles. Enfin, une meilleure communication autour des aides existantes et une simplification de leur accès sont nécessaires pour que les aidants puissent bénéficier des ressources disponibles et alléger leur fardeau. Ce renforcement des dispositifs est essentiel pour améliorer leur qualité de vie et leur permettre de continuer à soutenir leurs proches dans de bonnes conditions.
Source des informations :
Perte d'autonomie : quels effets sur la santé des proches aidants ? - Les dossiers de la Drees.

 © Canva
© Canva