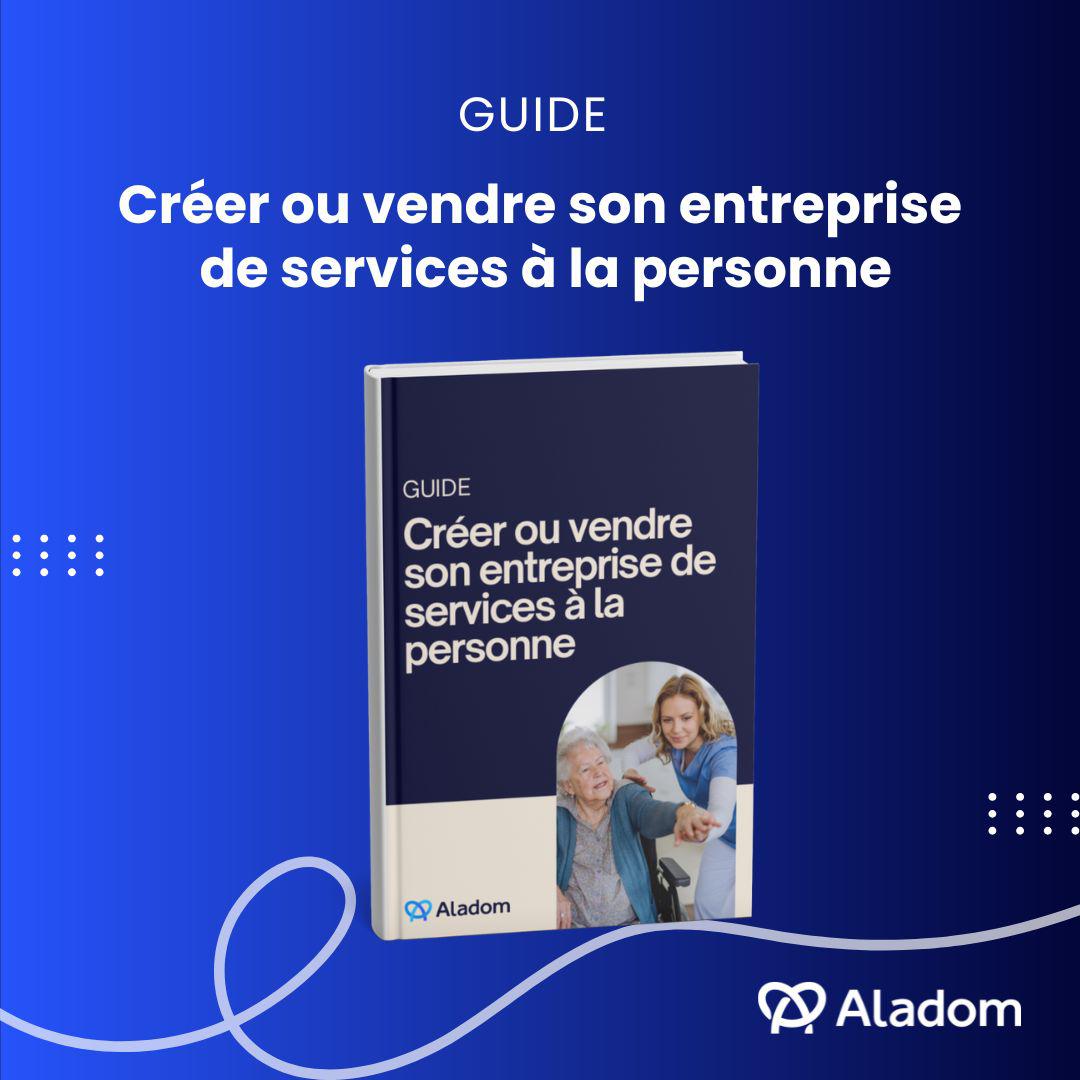Crise de la démographie médicale : les médecins de moins en moins nombreux
L’étude de la DREES rapporte que dans le contexte actuel de baisse de la démographie médicale, en particulier pour les médecins généralistes, la problématique de l’accès aux soins sur tous les territoires constitue un véritable défi.
Les dynamiques de réorganisation de l’offre en soins primaires et l’exercice coordonné sont ainsi fortement encouragés par les politiques publiques. La mutualisation de la permanence des soins entre confrères et consœurs d’un même groupe, le partage des dossiers médicaux et, plus largement, d’un système d’information, ou encore le fait d’avoir élaboré un projet de santé constitutif d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) et comptant le plus souvent un volet sur l’accès aux soins, sont autant de moyens favorisant une amélioration des conditions d’accès aux soins pour les patients. Pourtant, malgré le constat aujourd’hui établi d’une généralisation de l’exercice regroupé au sein des médecins généralistes et d’un développement rapide des structures d’exercice coordonné telles que les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP), l’effet de ces dynamiques quant à la disponibilité des médecins pour les patients du territoire reste peu documenté.
La vague d’enquête menée par la DREES a été conduite entre octobre 2018 et avril 2019. À cette date, 38% des médecins généralistes exerçaient seuls et 62% en groupe dont : 32% en groupe monodisciplinaire (avec d’autres médecins généralistes) et 30% en groupe avec des paramédicaux (avec ou sans autres médecins). Parmi ces derniers, 12% exercent en Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), tandis que 18% relèvent de groupes pluri-professionnels non MSP.
Des refus plus fréquents de nouveaux patients de la part des médecins en groupe monodisciplinaire
L’étude de la DREES montre que face à l’évolution de la démographie médicale, une majorité de médecins sont amenés à adapter leurs pratiques pour mieux répondre aux sollicitations de leurs patients. Une première modification peut passer par le refus de nouveaux patients en tant que médecin traitant (54% des médecins en 2019). Il semble, à première vue, exister des différences de pratiques entre les modèles d’exercice en groupe, puisque 49% des médecins exerçant seuls, contre 59% de ceux exerçant dans un groupe monodisciplinaire et 58% de ceux exerçant dans un groupe pluriprofessionnel (hors MSP), refusent de nouveaux patients en tant que médecin traitant.
Toutefois, en étudiant les caractéristiques des médecins exerçant dans chacun de ces modèles d’exercice, il s’avère que ces différences sont essentiellement liées à des variations de profils des médecins eux-mêmes. En particulier, les médecins généralistes exerçant en groupe pluriprofessionnel sont à la fois plus jeunes et plus fréquemment installés dans des territoires sous-dotés en soins généralistes. Or 59% des 30-40 ans déclarent refuser des patients en tant que médecin traitant, contre 51% de ceux de 60 à 70 ans, et 63% des généralistes pratiquant en zone sous-dotée déclarent refuser des nouveaux patients en tant que médecin traitant, contre 47 % dans les zones les mieux dotées.
En prenant en compte toutes ces spécificités, les analyses montrent que seul l’exercice en groupe monodisciplinaire est significativement associé à une probabilité plus élevée que le médecin déclare être amené à refuser des nouveaux patients en tant que médecin traitant.

Un rallongement des délais de rendez-vous
Selon l’étude de la DREES, presque la moitié des médecins (46%) déclarent être amenés à refuser de recevoir des patients occasionnels (dont ils ne sont pas le médecin traitant). Si cela ne concerne qu’un peu plus du tiers des médecins généralistes exerçant seuls (37%), c’est le cas de 59% de ceux exerçant en groupe pluriprofessionnel. Par ailleurs, plus de la moitié des médecins (55%) déclarent être contraints d’allonger les délais de rendez-vous avec, là encore, des différences qui semblent apparaître selon le modèle d’exercice (45% pour les médecins seuls et 63% pour ceux exerçant en groupe pluriprofessionnel non MSP).
Les caractéristiques des médecins s’avèrent là encore déterminantes pour bien appréhender leurs disponibilités pour la patientèle occasionnelle et l’évolution de leurs délais de rendez-vous. Se dégagent en particulier 2 effets principaux : un effet générationnel et un effet de l’offre de soins du territoire. D’une part, les médecins les plus âgés, exerçant plus fréquemment seuls, refusent moins souvent les patients occasionnels (35% des 60 ans ou plus, contre 61% chez les moins de 39 ans). D’autre part, les médecins exerçant dans les territoires moins bien dotés en soins généralistes, où sont concentrés les médecins en groupe pluriprofessionnel (en MSP ou non), refusent plus fréquemment des patients occasionnels et déclarent également plus souvent être amenés à augmenter leurs délais de rendez-vous.
Par exemple, 57% des médecins exerçant dans les zones les moins dotées en médecins généralistes déclarent refuser des patients occasionnels, contre 42% de ceux exerçant dans les zones les plus dotées. Ces différences traduisent probablement des disparités dans l’intensité des sollicitations faites aux généralistes plus que de réels écarts de pratiques ou de comportements. En effet, les médecins exerçant dans les zones avec une moins bonne offre en médecine générale peuvent être sollicités par davantage de patients disposant de moins d’alternatives que dans des territoires mieux dotés.
En complément, les médecins exerçant dans des communes disposant d’un service d’urgence refusent plus souvent de se déclarer médecin traitant pour un nouveau patient et de recevoir un patient occasionnel, comparativement aux médecins n’ayant pas de service d’urgence ni dans leur commune ni sur leur territoire de vie-santé.
Une meilleure prise en charge des soins non-programmés
Selon la DREES, les médecins en groupe, quelle que soit la nature du groupe, sont moins d’un tiers à déclarer être en mesure de prendre en charge systématiquement les demandes de Soins Non Programmés (SNP : ils sont définis comme étant des demandes de consultations pour le jour même ou pour le lendemain) via une organisation individuelle soit, un écart de plus de 10 points avec les médecins exerçant seuls (32% pour les médecins en groupe contre 44% pour les médecins exerçant seuls). Ils semblent plutôt s’appuyer sur le collectif pour mutualiser cette responsabilité en mettant en place une organisation à l’échelle du groupe : 49% d’entre eux déclarent qu’une organisation collective permet la prise en charge des SNP de façon systématique, de sorte, in fine, que 58% des médecins généralistes en groupe déclarent être disposés à proposer systématiquement une prise en charge des SNP via leur organisation individuelle ou collective.
Si près de la moitié des médecins en groupe exercent dans une structure disposant d’une organisation collective pour prendre en charge systématiquement les SNP, c’est significativement plus fréquent quand cette structure est une MSP : 61% contre 45% des médecins en groupe monodisciplinaire et 48% des groupes pluri-professionnels. Cette organisation plus systématique peut s’expliquer à la fois par les exigences du cahier des charges liées aux soins non programmés des MSP ayant signé un Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI), et plus largement du projet de santé des MSP qui contient souvent un volet dédié.
Ces organisations peuvent prendre différentes formes : plages horaires vacantes dans les agendas des médecins, prise en charge coordonnée avec les professions paramédicales, en particulier pour le volet des visites à domicile non programmées, embauche d’un remplaçant dédié aux SNP, formation du secrétariat à la régulation des urgences…
Quelles évolutions depuis la crise sanitaire du Covid-19 ?
Au cours de l’enquête de la DREES,
la réinterrogation des médecins entre janvier et avril 2022 a permis d’éclairer sur l’évolution des indicateurs de disponibilité. En effet, en 2022, deux médecins sur trois déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecin traitant ; ils étaient un peu plus d’un sur deux en 2019 (65% contre 53%). Cette évolution n’est pas associée à un modèle d’exercice en particulier. Il apparaît que les pratiques en termes de disponibilité envers les patients des médecins exerçant en MSP continuent de correspondre le plus à celles des médecins seuls.
Ces résultats sur leur disponibilité font d’ailleurs fortement écho aux résultats concernant le temps de travail, qui montrent une offre de travail hebdomadaire similaire entre les médecins seuls et les médecins en groupe pluriprofessionnel. Toutefois, si le temps de travail est très proche selon l’exercice pluriprofessionnel en MSP et hors MSP, l’appartenance à une structure d’exercice coordonnée, destinée à faciliter la collaboration et la coordination, semble jouer un rôle favorable sur la disponibilité des médecins.
Source des informations :
Etudes et Résultats de la DREES.

 © Pexels
© Pexels