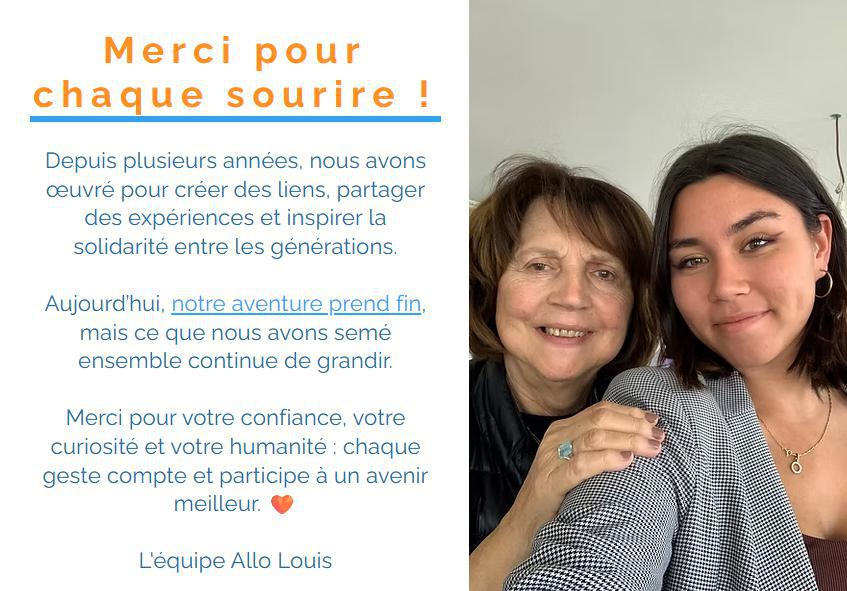La journée de solidarité, également appelée journée de solidarité envers les personnes âgées et handicapées, symbolise l'engagement de la société française envers les plus vulnérables. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Mais, saviez-vous que la journée de solidarité n’était pas la seule source de financement de la prise en charge des personnes âgées et handicapées ? 20 ans après sa création, elle fait partie d’un panier de recettes qui constituent un budget global de plus de 41 milliards d’euros en 2024, celui de la branche autonomie de la Sécurité sociale.
Publié le 15 mai 2024 12:12 © Pexels
© PexelsActualités du secteur
Que représente la journée de la solidarité ?
Mis à jour le 28 août 2025 14:51
Depuis le 1er janvier 2021, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) gère la branche Autonomie de la Sécurité sociale. Elle soutient l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en contribuant au financement des aides individuelles versées aux personnes, ainsi qu’au financement des établissements et des services qui les accompagnent, en veillant à l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national.
À ce titre, elle pilote le réseau des acteurs locaux de l’autonomie (maisons départementales des personnes handicapées, conseils départementaux et agences régionales de santé) et leur propose un appui technique. Elle participe à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Enfin, elle contribue à la recherche, à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie, et à la réflexion sur les politiques de l’autonomie. En 2024, la CNSA consacre plus de 40 milliards d’euros à l’aide à l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. C’est le cinquième budget de la Sécurité sociale et le premier financeur du soutien à l’autonomie.
À ce titre, elle pilote le réseau des acteurs locaux de l’autonomie (maisons départementales des personnes handicapées, conseils départementaux et agences régionales de santé) et leur propose un appui technique. Elle participe à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Enfin, elle contribue à la recherche, à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie, et à la réflexion sur les politiques de l’autonomie. En 2024, la CNSA consacre plus de 40 milliards d’euros à l’aide à l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. C’est le cinquième budget de la Sécurité sociale et le premier financeur du soutien à l’autonomie.
Qu’est-ce que la journée de solidarité ?
Instituée par la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité a été mise en place après l’épisode tragique de la canicule, survenue en 2003, en France métropolitaine. Cette année-là, la France a connu la vague de chaleur la plus forte depuis le début des mesures des températures (1947), ce qui a entraîné une surmortalité chez les personnes âgées et les malades principalement (de 15 000 à 19 000 décès, selon les estimations).
Au départ établie le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est un jour de travail supplémentaire pour les employés, non rémunéré, qui permet de financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Suite à la loi du 16 avril 2008, le dispositif a été modifié, la référence par défaut au lundi de Pentecôte étant supprimée. Le jour de solidarité est désormais fixé par accord d’établissement ou unilatéralement par l’employeur après consultation du Comité Social et Economique (CSE). Elle peut être instaurée n’importe quel jour de l’année, à l’exception d’un dimanche ou du 1er mai (jour de la fête du Travail). Toutefois, par tradition, de nombreuses entreprises la fixent toujours à la Pentecôte.
Cette journée, de 7 heures de travail non rémunérées et effectuées sur un jour férié, est définie dans l’article L. 3133-7 du Code du travail. L’employeur, de son côté, est redevable de la Contribution Solidarité Autonomie (CSA), une contribution patronale qui participe au financement des actions mises en place pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, à hauteur de 0.30 % de la masse salariale brute. Collectée par la caisse nationale de l’URSSAF, cette contribution patronale est obligatoire. Du côté des employés, la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire annuelle qui n’implique aucune rémunération, ni heures supplémentaires ou contrepartie sous forme de repos. Les collaborateurs peuvent choisir de décompter une journée de RTT ou un jour de congé.
A savoir : vous ne travaillez pas réellement gratuitement. En effet, comme votre salaire est mensualisé, le montant sera le même que les mois précédents. Ces heures spécifiques ne feront toutefois pas l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Au départ établie le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est un jour de travail supplémentaire pour les employés, non rémunéré, qui permet de financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Suite à la loi du 16 avril 2008, le dispositif a été modifié, la référence par défaut au lundi de Pentecôte étant supprimée. Le jour de solidarité est désormais fixé par accord d’établissement ou unilatéralement par l’employeur après consultation du Comité Social et Economique (CSE). Elle peut être instaurée n’importe quel jour de l’année, à l’exception d’un dimanche ou du 1er mai (jour de la fête du Travail). Toutefois, par tradition, de nombreuses entreprises la fixent toujours à la Pentecôte.
Cette journée, de 7 heures de travail non rémunérées et effectuées sur un jour férié, est définie dans l’article L. 3133-7 du Code du travail. L’employeur, de son côté, est redevable de la Contribution Solidarité Autonomie (CSA), une contribution patronale qui participe au financement des actions mises en place pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, à hauteur de 0.30 % de la masse salariale brute. Collectée par la caisse nationale de l’URSSAF, cette contribution patronale est obligatoire. Du côté des employés, la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire annuelle qui n’implique aucune rémunération, ni heures supplémentaires ou contrepartie sous forme de repos. Les collaborateurs peuvent choisir de décompter une journée de RTT ou un jour de congé.
A savoir : vous ne travaillez pas réellement gratuitement. En effet, comme votre salaire est mensualisé, le montant sera le même que les mois précédents. Ces heures spécifiques ne feront toutefois pas l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Qui est concerné par la journée de solidarité ?
Les salariés du secteur privé qui travaillent à temps plein doivent obligatoirement effectuer une journée de solidarité une fois par an. En cas de changement d’employeur au cours de l’année civile, le salarié n’est pas tenu de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité. Les salariés à temps partiel sont concernés par la journée de solidarité, mais ils n’ont pas à accomplir le même nombre d’heures que les salariés à temps plein. Le temps de travail pour cette journée est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle. Un salarié à mi-temps, par exemple, doit réaliser 3.5 heures de travail pour la journée de solidarité.
En revanche, les heures de travail effectuées au-delà de la limite de 7 heures doivent être normalement rémunérées (ou, pour les salariés à temps partiel, au-delà de la limite des heures proratisées).
Les salariés non mensualisés (les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires, les intermittents ou les travailleurs à domicile) doivent aussi effectuer une journée de solidarité. Cependant, ils sont rémunérés au taux normalement appliqué pour les heures de travail réalisées durant cette journée.
Les stagiaires ne touchant pas de rémunération, mais des gratifications, ne sont pas considérés comme des salariés. Ils ne sont donc pas soumis au Code du travail ni à la journée de solidarité. Les apprentis et les alternants ne sont pas non plus soumis à la journée de solidarité. De la même manière, les employeurs n’ont pas à verser la CSA pour les personnes en contrat d’apprentissage ou d’alternance.
La journée de solidarité concerne aussi l’ensemble des salariés et des travailleurs de la Fonction publique, qu’ils soient en CDD ou en CDI. Pour les agents travaillant à temps partiel ou à temps non complet, les 7 heures de cette journée sont réduites en proportion de leur durée de travail.
En revanche, les heures de travail effectuées au-delà de la limite de 7 heures doivent être normalement rémunérées (ou, pour les salariés à temps partiel, au-delà de la limite des heures proratisées).
Les salariés non mensualisés (les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires, les intermittents ou les travailleurs à domicile) doivent aussi effectuer une journée de solidarité. Cependant, ils sont rémunérés au taux normalement appliqué pour les heures de travail réalisées durant cette journée.
Les stagiaires ne touchant pas de rémunération, mais des gratifications, ne sont pas considérés comme des salariés. Ils ne sont donc pas soumis au Code du travail ni à la journée de solidarité. Les apprentis et les alternants ne sont pas non plus soumis à la journée de solidarité. De la même manière, les employeurs n’ont pas à verser la CSA pour les personnes en contrat d’apprentissage ou d’alternance.
La journée de solidarité concerne aussi l’ensemble des salariés et des travailleurs de la Fonction publique, qu’ils soient en CDD ou en CDI. Pour les agents travaillant à temps partiel ou à temps non complet, les 7 heures de cette journée sont réduites en proportion de leur durée de travail.
La journée de solidarité en chiffres
Depuis 20 ans, la journée de solidarité est une contribution des salariés au financement de la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle a été étendue aux retraités depuis 2015. Les retraités imposables reversent 0.3% de leurs pensions de retraite et d’invalidité ou de leurs allocations de préretraite. C’est la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA). Les sommes récoltées au titre de la journée de solidarité représentent, pour 2024, 8.2% du montant global des recettes affectées de la branche Autonomie de la Sécurité sociale.
Elles contribuent au financement :
Elles contribuent au financement :
- du fonctionnement et de la modernisation des établissements et services médico-sociaux qui accueillent les personnes âgées et les personnes handicapées ;
- de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), versées par les conseils départementaux aux personnes âgées et aux personnes handicapées vivant à domicile ou en établissement ;
- du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), lieux d’information et d’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches ;
- d’actions de prévention de la perte d’autonomie (ateliers collectifs sur l’équilibre, le sommeil ou la mémoire, sensibilisation à la prévention des chutes, aide à l’acquisition de matériel adapté…) ;
- de nouvelles formes d’habitat pour les personnes âgées et les personnes handicapées : l’habitat inclusif ;
- de l’accompagnement des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ;
- du développement de l’accueil familial (une solution d’hébergement pour les personnes âgées ou les personnes handicapées qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre chez elles).
En 2023, la journée de solidarité a rapporté 3.2 milliards d’euros. Cette année, en 2024, plus de 41 milliards d’euros sont consacrés à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Sources des informations : CNSA, DemarchesAdministratives.fr.
Partager cet article :
Commentaires
Il n'y a pas de commentaires pour le moment
Nos ressources pour les professionnels

Recrutement : Comment gérer son flux de candidats au quotidien ?
Témoignage - Ensemble Autrement
Voir le témoignage
Recrutement : Comment recruter des profils ciblés ?
Témoignage - Les 3 Forêts
Voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros