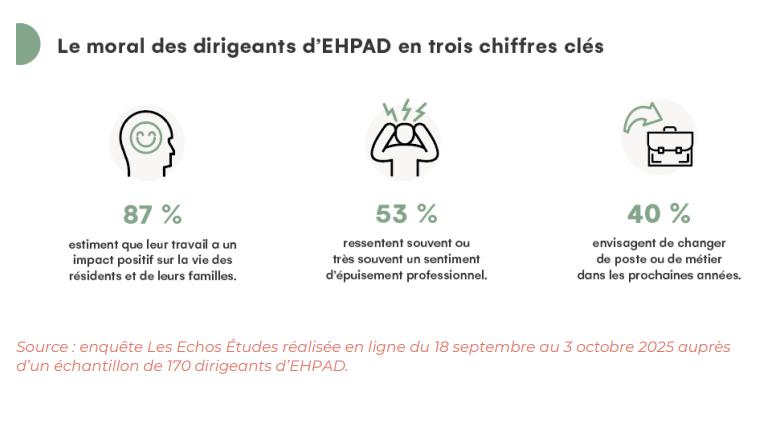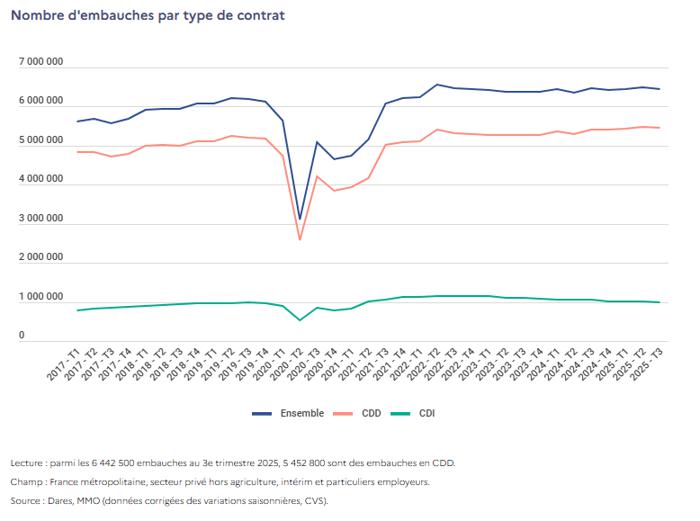Dans le cadre de la stratégie gouvernementale “Agir pour les aidants 2020-2022”, l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) a été missionnée par la ministre déléguée à l’Autonomie et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées pour rédiger un rapport portant sur l’évolution du cadre juridique et financier de l’offre de répit pour les aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes malades. Publié au mois de février 2023, l’étude pointe du doigt les failles et les freins des solutions de répit offertes aux aidants.
Le rapport de l’IGAS souligne que dans le prolongement des plans de santé publique, la stratégie nationale “Agir pour les aidants” (lancée le 23 octobre 2019, la stratégie “Agir pour les aidants” a été mise en place pour assurer la pleine reconnaissance que les aidants méritent : le gouvernement mettant en œuvre depuis 2020 de nombreuses actions qui leur sont destinées) prévoyait en 2019 un renforcement des Plateformes d’Accompagnement et de Répit (PFR) financées via les Agences Régionales de Santé (ARS). Initialement conçues pour les aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, elles ont été élargies à l’ensemble des aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes malades en 2021.
En 2022, on compte plus de 250 plateformes ou lieux d'accueil pour les aidants, relève l’IGAS. Mais leur maillage territorial est inégal (5 départements sans PFR et 10% des PFR sont dans les Hauts-de-France) et leur activité est très variable : certaines sont centrées sur le conseil, l’information et l’orientation des aidants, quand d’autres dispensent aussi des services, par exemple du soutien psychologique, ou développent elles mêmes des solutions de répit, comme des prestations dites de “temps libéré” (relai de quelques heures à domicile).
Selon l’IGAS, une des principales limites du développement des PFR tient à leur articulation très limitée avec les politiques des conseils départementaux. Or, les départements ont des compétences vis-à-vis des publics “aidés” ciblés par les PFR (personnes âgées et personnes en situation de handicap), et certains d’entre eux ont développé des politiques à destination des aidants. De plus, leurs équipes médico-sociales interviennent à domicile des personnes âgées pour évaluer la situation de l’aidant en même temps que celle de la personne aidée.
Le statut juridique des PFR constitue également une limite au développement de PFR en dehors du champ médico-social. Le cahier des charges des PFR précise qu’elles doivent être adossées à un établissement ou service médico-social (ESMS) financé par l’assurance maladie.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a instauré un droit au répit pour
proches aidants. Ce droit signifie que tout aidant peut demander pour son proche un soutien et une place d’accueil temporaire en établissement, en accueil de jour, en séjour de vacances, etc. Selon l’enquête de l’IGAS, l’accès à des solutions de répit n’est toutefois pas la première demande des aidants, qui insistent en premier lieu sur l’importance d’un accompagnement soignant et médico-social approprié pour les personnes aidées. Cependant, ils peuvent exprimer le besoin de temps de répit, au sens d’un relai pour s’occuper d’eux.
Le rapport de l’IGAS souligne que, si
la suppléance à domicile est expérimentée sous de nombreuses formes, sa généralisation et son développement, très attendus par les aidants, requièrent des financements plus soutenus et un cadre juridique stable pour structurer l’offre.
La stratégie “Agir pour les aidants” prévoyait une expérimentation de dérogation au droit du travail pour
développer le relayage à domicile sur le modèle du baluchonnage québécois. L’offre de suppléance à domicile développée dans ce cadre est restée très modeste alors que de nombreuses autres formules de suppléance de domicile se sont développées ces toutes dernières années pour les aidants de personnes âgées sans pour autant recourir à ce cadre dérogatoire.
Pour les aidants de personnes en situation de handicap,
l’offre de suppléance à domicile reste encore embryonnaire, sous réserve d’un soutien spécifique aux parents d’enfants handicapés porté par certaines CAF (Caisses d'Allocations Familiales). Pour les aidants de personnes malades de moins de 60 ans, et notamment pour les parents d’enfants malades, l’offre est encore quasi inexistante, sauf dans certains cas de sortie d’hospitalisation (comme avec le programme de retour à domicile de l’assurance maladie- PRADO).
Les freins au développement de l’offre de suppléance à domicile tiennent principalement, du côté de la demande, à des financements qui restent encore très ponctuels, largement méconnus et complexes à mobiliser, et, du côté de l’offre, aux difficultés de recrutement du secteur, et à un modèle juridique et économique encore indéterminé, en particulier en termes de tarification et de qualifications.
Pour l’IGAS,
l’offre d’accueil temporaire en établissement doit être adaptée en fonction des attentes des aidants. L’épuisement des aidants ou leur indisponibilité – pour cause notamment d’hospitalisation – sont parmi les principaux motifs de recours à l’accueil temporaire.
L’offre d’accueil temporaire reste toutefois largement minoritaire dans l’offre des établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap et n’est pas toujours adaptée aux attentes des publics.
Sur le champ des personnes âgées, l’offre d’accueil de jour et d’hébergement temporaire est relativement sous-utilisée. Cette sous-utilisation contraste avec des demandes d’accueil temporaire qui ne peuvent être satisfaites, notamment pour certains publics (ceux présentant des troubles du comportement, les profils “atypiques” comme les patients jeunes…), ou pour certaines modalités d’accueil (accueil en urgence, séjours très courts, ...). Sur le champ du handicap et des malades chroniques, les besoins exprimés par les acteurs relèvent surtout de carences de l’offre de prise en charge médico-sociale.
Par exemple, de nombreuses demandes de répit portent sur l’accueil des enfants pendant le week-end ou les vacances scolaires, soulignant en creux l’inadaptation de l’offre proposée par les établissements pour enfants. Un frein très important à la demande de répit en établissement tient à la réglementation de l’accueil temporaire, qui conditionne l’accès en établissement à une décision administrative, avec des pratiques des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) très variables entre départements.
Les autres freins sont liés au reste à charge de l’hébergement temporaire ou de l’accueil de jour et au coût des transports, en dépit d’une réglementation qui prévoit leur prise en charge dans certaines conditions.
D’ailleurs,
l’étude repère intitulée “Le répit des aidants en Nouvelle-Aquitaine” réalisée par le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine, à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants, va dans le même sens. Elle a entre autres permis d'identifier les principaux freins au recours à l’accueil temporaire qui sont : la communication, l’image négative des
Ehpad, le financement, le transport, l’organisation RH.
Pour l’IGAS,
les séjours de vacances-répit, pour l’aidant comme l’aidé, méritent d’être soutenus. Les séjours de vacances-répit peuvent s’adresser aux aidés seuls, aux aidants seuls ou encore simultanément aux aidants et aux aidés.
Le développement de cette dernière offre, encore limitée, est plus particulièrement souhaité par les aidants qui, à l’image du reste de la société, préfèrent les séjours en famille et en milieu ordinaire, dans une logique d’inclusion. Ils peuvent être organisés par des acteurs touristiques, souvent issus du tourisme social, ou par des établissements médico-sociaux, mais très rarement conjointement par ces deux secteurs.
D’après l’IGAS,
le principal frein au développement des séjours de vacances-répit tient au coût élevé des séjours adaptés. Il existe pourtant plusieurs modalités de financements individuels permettant de prendre en charge une partie des coûts des séjours de vacances-répit pour les aidants et/ou les aidés, mais les aides financières sont très diverses, ce qui rend leur mobilisation complexe, et très souvent méconnues. Le bilan de la stratégie "Agir pour les aidants" est peu concluant en matière de séjours de vacances et de répit. Fin 2021, les crédits consommés par les ARS étaient quasi nuls, ce qui s’explique notamment par leurs réticences au financement de séjours portés par des acteurs touristiques et à la création d’établissements médico-sociaux dédiés aux séjours de vacances.
Paradoxalement, note le rapport de l'IGAS, alors que le développement des solutions de répit est d’abord freiné par un manque de financement, les financements existants sont peu mobilisés, car dispersés et méconnus, ce qui appelle à clarifier les aides existantes.
Les possibilités d’aides individuelles pour des solutions de répit sont nombreuses mais complexes à mettre en œuvre et laissent à la charge du bénéficiaire une participation financière parfois importante :

 © Pexels
© Pexels