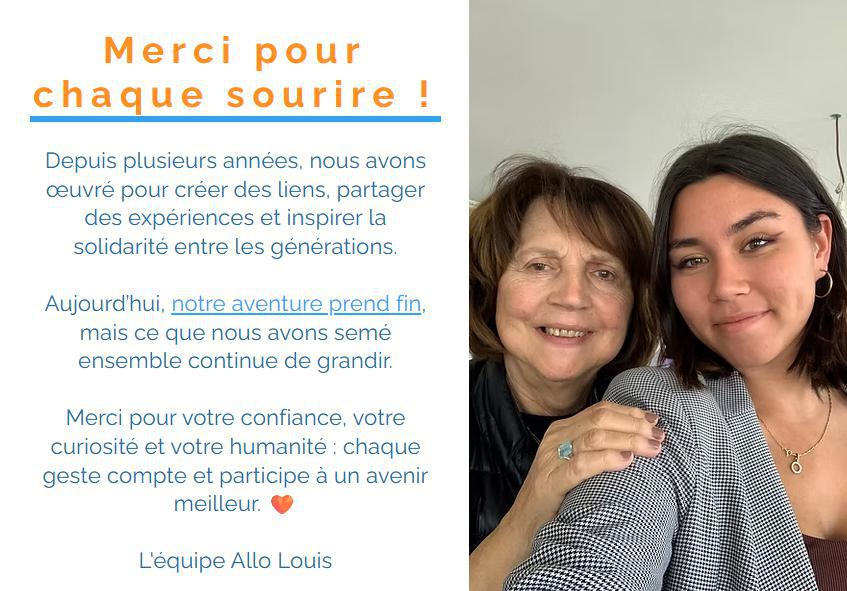La DREES, le service statistique public du Ministère des solidarités et de la santé, a publié ce jeudi 24 août, une étude basée sur 30 ans d'observation (de 1989 à 2019), qui révèle que près d’une infirmière sur deux quitte l’hôpital après seulement 10 ans d’exercice. Pour les syndicats infirmiers, il n’y a rien de nouveau. Ils n’ont de cesse d'expliquer que ces démissions, de plus en plus nombreuses, sont les conséquences d’un manque de personnel et d’une dégradation graduelle des conditions de travail.
Publié le 25 août 2023 10:54 © Pexels
© PexelsActualités du secteur
La grande démission : près d’une infirmière sur deux quitte l’hôpital ou change de métier après 10 ans de carrière
Mis à jour le 8 avril 2024 18:00
Sommaire
Des démissions qui s’accélèrent au fil des années Les résultats d’une étude qui ne surprend guère la profession
Partager cet article
Des démissions qui s’accélèrent au fil des années
Le secteur libéral attire les infirmières hospitalières
L’étude de la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques) révèle que les proportions d’infirmières hospitalières exerçant toujours la même profession 5 et 10 ans après le début de leur carrière ont varié au fil des générations.
Les personnes entrées dans la profession d’infirmière entre 1989 et 2019 sont de moins en moins nombreuses à occuper, au cours des années, un emploi salarié, hospitalier ou non. Au bout de 5 ans de carrière, elles ne sont plus que 87% à occuper un emploi salarié. Le pourcentage descend à 79% au bout de 10 ans. Entre 1989 et 2019, sur les 79% de personnes qui ont encore un emploi salarié 10 ans après leur premier poste d’infirmière hospitalière, 54% exercent toujours cette profession à l’hôpital, 11% sont toujours infirmières salariées mais pour un autre type d’employeur (par exemple un Ehpad - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), une administration publique ou en intérim, 7% ont changé de métier mais sont restées dans le secteur hospitalier (par exemple dans un emploi administratif) et 7 % ont changé de profession et de secteur.
Pour les infirmières, les sorties de l’emploi salarié peuvent se faire vers le libéral, sous certaines conditions d’expérience en termes d’exercice salarié. Ainsi, 13% d’entre elles ont un emploi indépendant 5 ans après leurs débuts comme infirmière hospitalière, et 17% après 10 ans. Cela s’explique principalement par le choix d’exercer comme infirmière libérale, qui concerne 5% d’entre elles à titre exclusif et 4% à titre mixte après cinq ans, puis 10% à titre exclusif et 2 % à titre mixte après 10 ans. L’exercice mixte correspond ici au fait d’avoir à la fois un emploi indépendant d’infirmière libérale et un emploi salarié la même année civile.
L’étude souligne que l’emploi indépendant dans d’autres professions est nettement plus rare. En effet, au bout de 5 ans d’exercice, seul 1% des effectifs occupent un emploi indépendant d’une autre profession, et 2% en même temps qu’un emploi salarié. Les proportions correspondantes s’élèvent à 3% et 2% après 10 ans.
Enfin, la part des infirmières ayant démissionné qui n’ont aucun emploi en France métropolitaine (chômeuses, inactives ou ayant quitté le champ de l’étude en partant à l’étranger par exemple) augmente au cours du temps. Cinq ans après le premier poste d’infirmière hospitalière, cette part s’élève à 5% et 10 ans après, à 11%.
Les personnes entrées dans la profession d’infirmière entre 1989 et 2019 sont de moins en moins nombreuses à occuper, au cours des années, un emploi salarié, hospitalier ou non. Au bout de 5 ans de carrière, elles ne sont plus que 87% à occuper un emploi salarié. Le pourcentage descend à 79% au bout de 10 ans. Entre 1989 et 2019, sur les 79% de personnes qui ont encore un emploi salarié 10 ans après leur premier poste d’infirmière hospitalière, 54% exercent toujours cette profession à l’hôpital, 11% sont toujours infirmières salariées mais pour un autre type d’employeur (par exemple un Ehpad - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), une administration publique ou en intérim, 7% ont changé de métier mais sont restées dans le secteur hospitalier (par exemple dans un emploi administratif) et 7 % ont changé de profession et de secteur.
Pour les infirmières, les sorties de l’emploi salarié peuvent se faire vers le libéral, sous certaines conditions d’expérience en termes d’exercice salarié. Ainsi, 13% d’entre elles ont un emploi indépendant 5 ans après leurs débuts comme infirmière hospitalière, et 17% après 10 ans. Cela s’explique principalement par le choix d’exercer comme infirmière libérale, qui concerne 5% d’entre elles à titre exclusif et 4% à titre mixte après cinq ans, puis 10% à titre exclusif et 2 % à titre mixte après 10 ans. L’exercice mixte correspond ici au fait d’avoir à la fois un emploi indépendant d’infirmière libérale et un emploi salarié la même année civile.
L’étude souligne que l’emploi indépendant dans d’autres professions est nettement plus rare. En effet, au bout de 5 ans d’exercice, seul 1% des effectifs occupent un emploi indépendant d’une autre profession, et 2% en même temps qu’un emploi salarié. Les proportions correspondantes s’élèvent à 3% et 2% après 10 ans.
Enfin, la part des infirmières ayant démissionné qui n’ont aucun emploi en France métropolitaine (chômeuses, inactives ou ayant quitté le champ de l’étude en partant à l’étranger par exemple) augmente au cours du temps. Cinq ans après le premier poste d’infirmière hospitalière, cette part s’élève à 5% et 10 ans après, à 11%.
La maternité joue-t-elle un rôle dans la profession d’infirmière ?
Les auteurs de l’étude s’interrogent : dans la mesure où il s’agit d’une profession extrêmement féminisée et parce que de nombreuses femmes réduisent leur activité professionnelle sur le marché du travail en devenant mère, on peut se demander si cette arrivée d’enfant explique au moins partiellement les flux de sortie de la profession.
Les conclusions de l’enquête de la DREES ne laissent aucune place au doute. Le fait de devenir mère ne conduit pas les femmes qui ont occupé un poste d’infirmière hospitalière à se retirer de l’emploi salarié. De même, il n’influe pas sur la décision de rester infirmière hospitalière. En revanche, devenir mère conduit bien les femmes qui ont exercé la profession d’infirmière hospitalière à diminuer leur volume de travail salarié. Plus précisément, elle conduit à diminuer de 0.14 EQTP (Équivalent Temps Plein) leur volume de travail salarié 5 ans après la naissance de leur premier enfant et de 0.22 EQTP 10 ans après.
Cette diminution s’explique essentiellement par des passages à temps partiel. La fréquence de ces passages à temps partiel est comparable à celle qu’on peut mesurer sur la totalité de l’emploi salarié.
Les conclusions de l’enquête de la DREES ne laissent aucune place au doute. Le fait de devenir mère ne conduit pas les femmes qui ont occupé un poste d’infirmière hospitalière à se retirer de l’emploi salarié. De même, il n’influe pas sur la décision de rester infirmière hospitalière. En revanche, devenir mère conduit bien les femmes qui ont exercé la profession d’infirmière hospitalière à diminuer leur volume de travail salarié. Plus précisément, elle conduit à diminuer de 0.14 EQTP (Équivalent Temps Plein) leur volume de travail salarié 5 ans après la naissance de leur premier enfant et de 0.22 EQTP 10 ans après.
Cette diminution s’explique essentiellement par des passages à temps partiel. La fréquence de ces passages à temps partiel est comparable à celle qu’on peut mesurer sur la totalité de l’emploi salarié.
Les résultats d’une étude qui ne surprend guère la profession
Le SNPI en appelle à un “plan Marshall”
En réponse à l’étude de la DREES, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI), ne mâche pas ses mots, faisant mine de s’interroger dans son communiqué de presse : Comment s’étonner que des infirmières sous-payées, en sous-effectif, agressées par des patients et leurs familles, et souvent victimes de maltraitance institutionnelle ne restent pas à l’hôpital ?
Pour le SNPI, face à la pénurie et pour rendre l’hôpital attractif, il est nécessaire voire salutaire pour la santé des patients comme des infirmières, de mettre en place un “plan Marshall” en 3 points.
Le premier point concerne les ratios de patients par infirmière. En France, c’est un fait, les infirmières sont en sous-effectif. Thierry Amouroux, le porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) constate : “Alors que les normes internationales sont de 6 à 8 patients par infirmière, en France c’est souvent le double. Ces conditions de travail indignes font fuir les soignants. Malgré les Power Point sur le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, la bienveillance etc., à l’hôpital la réalité est très noire. Alors qu’il y a déjà 60 000 postes infirmiers vacants et que 10% des soignants sont en maladie, épuisement, dépression, burn-out, il y a urgence à agir. Nous avons besoin d’un plan Marshall sur sauver l’hôpital, avec des ratios compatibles avec la qualité des soins, une revalorisation des salaires, et une amélioration des conditions de travail."
Certains pensent qu’en raison de la pénurie, il n’est pas possible d’implanter des ratios de patients par infirmière. Au contraire, ces derniers donneront l’impulsion nécessaire pour attirer et retenir les soignants.
À la suite de l’implantation des ratios en Californie, les postes vacants ont diminué de 69%, les accidents de travail ont diminué de 31.6% chez les infirmières. De plus, le nombre d’infirmières a augmenté en moyenne de 10 000 par an, constate le communiqué de presse du syndicat. Ce sont les conditions de travail et de pratique professionnelle qui font fuir les professionnels infirmiers ou qui les obligent à quitter leur profession. Les ratios professionnels en soins / patients sont la mesure structurante pour attirer et retenir le personnel soignant.
Le deuxième point évoqué touche aux conditions de travail qui n’ont cessé de se dégrader au cours des décennies. Rappels sur repos, heures supplémentaires, refus de temps partiel, changements d’horaires, etc. Et mise en insécurité professionnelle : "Pour pallier une absence, un infirmier peut passer du jour au lendemain de la cardio à la neuro. Pour la direction c’est la polyvalence. Les soignants déjà débordés n’ont pas le temps de nous former et une erreur de soins est possible. Pour une infirmière c’est du stress, de l’insécurité professionnelle et un mépris des compétences : nous ne sommes pas des pions. On ne peut plus arriver au boulot la boule au ventre avec la crainte de faire un mauvais geste et de mettre en danger les patients." avance Thierry Amouroux. Il parle également de perte de sens : "Chaque patient est unique et doit être traité comme tel. Mais on a transformé l’hôpital en usine à soins. Cela nie tout ce qui fait le cœur du métier. Le patient n’est pas un objet de soins : il a des peurs, il a des questions. Nous devons expliquer la maladie et le traitement. Ce travail d’éducation, de relation d’aide, d’accompagnement ne rentre pas dans les cases de l’administration.”
Le communiqué de presse souligne que : le système de santé souffre de dysfonctionnements importants. Les équipes de soins sont surchargées et épuisées depuis de nombreuses années. Cette situation fait en sorte qu’elles se retrouvent, bien malgré elles, dans l’obligation de prioriser des soins lorsqu’elles ne sont pas en mesure de tous les donner. Au bout du compte, ce sont les patients et les personnes proches aidantes qui en souffrent. La crise du COVID-19 a levé le voile sur une situation inacceptable qui perdure depuis trop longtemps.
35 infirmières sont agressées chaque jour dans les hôpitaux, selon L’Observatoire National des Violences en milieu de Santé (ONVS). Pour le SNPI, il n’est pas admissible que des soignants soient insultés et maltraités. Les infirmières mettent également en avant un sentiment d’insécurité lorsqu’elles prennent ou quittent leur poste.
Le troisième et dernier point touche aux salaires. Le communiqué de presse du SNPI met en avant les bas salaires des infirmiers français : “Le Ségur de la santé nous a fait passer de moins 20% sous le salaire infirmier européen à moins 10%. Nous restons exploitées, d’où la tentation d’aller travailler en Belgique (+30%) ou en Suisse (salaire brut doublé). Les soignants, qui travaillent sans relâche pour offrir les meilleurs soins à la population, réclament une rémunération à la hauteur de l’importance vitale de leur travail, de leur niveau de compétence, de formation et de responsabilité." déclare Thierry Amouroux. "Il faut également revoir le financement des contraintes (travail de nuit, le week-end,..) : un euro l’heure de nuit, c’est méprisant. Nous ne demandons pas l’aumône." ajoute t-il.
Pour le SNPI, face à la pénurie et pour rendre l’hôpital attractif, il est nécessaire voire salutaire pour la santé des patients comme des infirmières, de mettre en place un “plan Marshall” en 3 points.
Le premier point concerne les ratios de patients par infirmière. En France, c’est un fait, les infirmières sont en sous-effectif. Thierry Amouroux, le porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) constate : “Alors que les normes internationales sont de 6 à 8 patients par infirmière, en France c’est souvent le double. Ces conditions de travail indignes font fuir les soignants. Malgré les Power Point sur le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, la bienveillance etc., à l’hôpital la réalité est très noire. Alors qu’il y a déjà 60 000 postes infirmiers vacants et que 10% des soignants sont en maladie, épuisement, dépression, burn-out, il y a urgence à agir. Nous avons besoin d’un plan Marshall sur sauver l’hôpital, avec des ratios compatibles avec la qualité des soins, une revalorisation des salaires, et une amélioration des conditions de travail."
Certains pensent qu’en raison de la pénurie, il n’est pas possible d’implanter des ratios de patients par infirmière. Au contraire, ces derniers donneront l’impulsion nécessaire pour attirer et retenir les soignants.
À la suite de l’implantation des ratios en Californie, les postes vacants ont diminué de 69%, les accidents de travail ont diminué de 31.6% chez les infirmières. De plus, le nombre d’infirmières a augmenté en moyenne de 10 000 par an, constate le communiqué de presse du syndicat. Ce sont les conditions de travail et de pratique professionnelle qui font fuir les professionnels infirmiers ou qui les obligent à quitter leur profession. Les ratios professionnels en soins / patients sont la mesure structurante pour attirer et retenir le personnel soignant.
Le deuxième point évoqué touche aux conditions de travail qui n’ont cessé de se dégrader au cours des décennies. Rappels sur repos, heures supplémentaires, refus de temps partiel, changements d’horaires, etc. Et mise en insécurité professionnelle : "Pour pallier une absence, un infirmier peut passer du jour au lendemain de la cardio à la neuro. Pour la direction c’est la polyvalence. Les soignants déjà débordés n’ont pas le temps de nous former et une erreur de soins est possible. Pour une infirmière c’est du stress, de l’insécurité professionnelle et un mépris des compétences : nous ne sommes pas des pions. On ne peut plus arriver au boulot la boule au ventre avec la crainte de faire un mauvais geste et de mettre en danger les patients." avance Thierry Amouroux. Il parle également de perte de sens : "Chaque patient est unique et doit être traité comme tel. Mais on a transformé l’hôpital en usine à soins. Cela nie tout ce qui fait le cœur du métier. Le patient n’est pas un objet de soins : il a des peurs, il a des questions. Nous devons expliquer la maladie et le traitement. Ce travail d’éducation, de relation d’aide, d’accompagnement ne rentre pas dans les cases de l’administration.”
Le communiqué de presse souligne que : le système de santé souffre de dysfonctionnements importants. Les équipes de soins sont surchargées et épuisées depuis de nombreuses années. Cette situation fait en sorte qu’elles se retrouvent, bien malgré elles, dans l’obligation de prioriser des soins lorsqu’elles ne sont pas en mesure de tous les donner. Au bout du compte, ce sont les patients et les personnes proches aidantes qui en souffrent. La crise du COVID-19 a levé le voile sur une situation inacceptable qui perdure depuis trop longtemps.
35 infirmières sont agressées chaque jour dans les hôpitaux, selon L’Observatoire National des Violences en milieu de Santé (ONVS). Pour le SNPI, il n’est pas admissible que des soignants soient insultés et maltraités. Les infirmières mettent également en avant un sentiment d’insécurité lorsqu’elles prennent ou quittent leur poste.
Le troisième et dernier point touche aux salaires. Le communiqué de presse du SNPI met en avant les bas salaires des infirmiers français : “Le Ségur de la santé nous a fait passer de moins 20% sous le salaire infirmier européen à moins 10%. Nous restons exploitées, d’où la tentation d’aller travailler en Belgique (+30%) ou en Suisse (salaire brut doublé). Les soignants, qui travaillent sans relâche pour offrir les meilleurs soins à la population, réclament une rémunération à la hauteur de l’importance vitale de leur travail, de leur niveau de compétence, de formation et de responsabilité." déclare Thierry Amouroux. "Il faut également revoir le financement des contraintes (travail de nuit, le week-end,..) : un euro l’heure de nuit, c’est méprisant. Nous ne demandons pas l’aumône." ajoute t-il.
Un constat alarmant et bien amer
Le jeudi 24 août, sur les ondes de la station publique franceinfo, le porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI), Thierry Amouroux, poursuivait dans la même lignée, explicitant ses propos. Il parle de nouveau de maltraitance institutionnelle vis-à-vis des infirmières car selon lui, l’insécurité professionnelle est réelle chez les infirmières dans la mesure où elles peuvent être confrontées à des changements de planning (constant) et de services sans en être averties.
Mal-payées, surmenées, et victime de violence de la part de certains patients, les infirmières n’ont pas d’autre choix que de quitter une profession qu’elles aiment et qu’elles ont choisie par vocation. Beaucoup d’entre-elles vont dans le privé ou s’arrêtent et entament une reconversion professionnelle à mille lieues de leur métier d’origine. Thierry Amouroux déplore un véritable gâchis. Ces démissions ne sont profitables à personne. Et qui dit baisse du personnel soignant, dit augmentation de la mortalité des patients puisque ces derniers ne peuvent être correctement soignés et pris en charge.
Un cas concret, celui de Charlène, une infirmière trentenaire démissionnaire. Elle parle au micro de Franceinfo des difficultés auxquelles elle a dû faire face durant ses 11 années d’exercice : “On est sollicité de tous les côtés, entre les médecins, les patients... On n'a pas le temps de boire, d'aller aux toilettes. J'ai travaillé enceinte jusqu'à huit mois de grossesse, avec des patients qui râlaient parce que je n'allais pas assez vite (...)" Aujourd’hui, Charlène a quitté les couloirs d’un grand hôpital parisien (pour un salaire mensuel de 1900€). Elle travaille désormais dans une crèche.
Retrouvez sur Aladom.fr, des offres d'emplois d'infirmiers.
Partager cet article :
Commentaires
Il n'y a pas de commentaires pour le moment
Nos ressources pour les professionnels

Comment appréhender les problématiques de recrutement dans la conjoncture actuelle ?
Témoignage - EHPAD Résidence Les Jardins des Sens
Voir le témoignage
Recrutement : Comment gérer son flux de candidats au quotidien ?
Témoignage - Ensemble Autrement
Voir le témoignageSur le même thème
Consultez les annonces en lien avec cette actualité
Professionnels du secteur
VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE
Découvrir les offres pour les pros